

Sommaire
Prolégomènes : « trouvé dans un
bocal »
1) Premiers résultats d’une recherche
II - Les
acteurs du terrain : présentation et implications méthodologiques
1) Maltraitance et protection des enfants
1. De la cruauté sur enfants à la maltraitance
2. La difficulté de faire l’histoire de France sur ce sujet
3. Histoires de la maltraitance et de la protection de l’enfance en France
2) La protection de l’enfance aujourd’hui : un domaine vaste et une mosaïque d’intervenants
1. Les services qui dépendent de l’Etat
3. La réforme récente occasionnée par la loi du 5 mars 2007
4. Organisation de la Protection de l’Enfance aujourd’hui dans le département du Rhône
5. Le rôle et la place des associations de lutte contre la maltraitance des enfants
3. Le stigmate et la Science, ou de Charybde en Scylla ?
2) Premières tentatives de prises de contact : autour des maisons du Rhône
3) Des aiguillages bien aléatoires ?
4) Les pédopsychiatres : non concerné/e/s
5) L’importance des relations personnelles
6) Anciennes connaissances, ancienne histoire …
IV - Quand
le silence s’effrite : communiquer le secret
1) Diversité des professionnel/le/s
3) Révéler, communiquer l’inceste ?
1. Les caractéristiques des communications faites durant l’enfance des incesté/e/s
2. La communication par des jeunes, juste après les faits ou pendant les faits
4. La communication par des adultes, au fil de leur vie
4) Caractéristiques des professionnel/le/s qui suscitent des communications
2. Penser qu’il y a quelque chose, mais pas ça
5. Quant le/la professionnel/le ne peut être qu’un passeur
V - L’impact
de la communication
1) La sidération et ses suites
5) La mise à distance ébranlée : inquiétante proximité, effroyable réalité
6) Toujours plus près de soi : aperçu sur l’inceste communiqué hors contexte professionnel
7) Toujours plus près de soi : quand c’est soi, la victime
VI - Le sort
de la communication
2) Garder le secret, garder la famille
1. Quand des professionnel/le/s veillent sur la paix familiale
2. Perdre son statut d’enfant ?
3. Quand des incesté/e/s veillent sur la paix familiale
3) Des mères honteuses ou des mères menteuses ?
4. Gregory Bateson, 2 : des mères coupables, coupables, ou bien coupables
5. Du syndrome d’aliénation parentale au sacrifice à la famille indissoluble.
Prolégomènes :
« trouvé dans un bocal »

L'inceste : consistance du silence
France, 20e - 21e siècle
J’ai réalisé le dessin de cette feuille de garde le soir de Noël 2006.
C’était le fruit enfin mûr d’une douleur jusque-là innomée
Ensuite, j’ai fait un rêve
Ensuite, j’ai tenté de suivre la voie ouverte par ce rêve
La voie est amère
Ce n’était pas dit dans le rêve …
L’enfant héroïque
C’est un matin comme
tous les matins.
Gris.
Il faut se lever, vivre hélas. Vivre : se lever est si lourd. Le réel, le
poids du réel, le poids d’une vie. Une vie de quoi ? huit ans d’âge,
peut-être, ou neuf.
L’enfant héroïque prend son courage à deux mains et, puisqu’il le faut bien, se
lève.
Puisqu’il le faut bien, va jusqu’à la cuisine et fait ses tartines. Mais Dieu,
que les tartines sont lourdes à faire ! Le moindre effort est un poids
incommensurable. Si encore les tartines étaient là, toutes prêtes … mais
en ce lieu lugubre où est condamnée à vie l’enfant héroïque, il faut faire ses
tartines. Puis y aller. Y aller comme tous les jours, dans le lieu où vont les
enfants : l’école. C’est bien l’école, on y apprend des choses.
L’école. Un lieu aussi lourdingue que le reste. Un lieu qui pue.
Sur le chemin de l’école, le saule pleureur, qui jouxte l’immeuble de huit
étages peint en rose.
Sur le chemin de l’école, l’enfant héroïque
passe toujours sous les branches du saule pleureur, qui tombent si bas par
terre, formant comme un rideau entre ce monde et un autre : franchir les branches,
c’est changer de monde. Entrer dans un monde fabuleux, l’espace d’un instant,
où aucun de ces méchants qui peuplent le monde quotidien ne peut gagner, parce
que l’enfant héroïque y est le héros des livres qu’elle lit. Dans les livres,
le héros est toujours plus fort que les méchants qui lui veulent du mal. Dans
les livres, le héros gagne le combat.
Le combat. L’espace du saule franchit, le rideau de branches se referme
derrière elle sur le monde du rêve, et il faut, de nouveau, marcher dans le
monde du cauchemar. Quotidien. A vie. Mener le combat. En espérant quoi ?
Peut-être un jour retrouver le monde d’avant, d’avant le cauchemar ?
L’enfant héroïque a oublié que le cauchemar a toujours été là dans sa vie, et,
peut-être, cette mythification lui permet de tenir sans avaler la ciguë fatale.
Mais, n’empêche, que ces matins sont lourds, chaque matin, lourds comme la vie
qui m’est promise, ne pense même pas l’enfant.
Les tartines sont de plomb, à porter pour les
faire …
Et l’enfant héroïque, ses tartines calées
dans le ventre, s’en va au combat, comme tous les matins. Bizarrement, depuis
quelques temps, les matins sont tellement lourds qu’elle arrive à l’école après
les autres. Pas fait exprès. Ils sont déjà tous montés : il est 8h30 bien
passé, de dix minutes au moins. De cette époque datent les retards, pas faits
exprès : juste le poids des pieds à traîner jusqu’au lieu du combat
quotidien, après le poids des tartines à faire et le poids de l’éveil du matin.
Le retour quotidien au monde réel est si lourd …
8h40, tous les matins : dix minutes
quotidiennes gagnées, involontairement, sur le combat, par la grâce des pieds
qui traînent. Le combat, dont la première manche commence véritablement à la
récréation de 10h : crachats, insultes, parfois coups. L’enfant héroïque
est la délectation de cette bande de garçons qui l’encercle à chaque fois, dans
la cour, malgré la présence des maîtresses juste à côté. Elles ont beau les
punir, ils s’en fichent, ils recommencent toujours. Telle est la place de
l’enfant héroïque dans la cour : la sorcière à stigmatiser, à marquer de
ses crachats. Pourquoi ? Juste parce qu’elle est l’enfant héroïque, on
dirait.
C’est à tel point problématique que maman a dû emmener l’enfant héroïque voir
une psychiatre, qu’elle voit depuis toutes les semaines, pour l’aider dans ses
« problèmes relationnels avec les autres ». Pour l’enfant héroïque,
c’est un stigmate de plus, dont elle ne parle à personne : le/la
psychiatre, c’est l’endroit où l’on emmène les fous, non ?
Mais elle y va, par devoir puisque maman
veut, comme elle va à l’école par devoir puisque les adultes veulent, puisque
c’est là sa place dans le monde. Au milieu des crachats.
La récréation autour du repas est plus longue
…
Et puis arrive 16h30 : fin de la journée
pour l’enfant héroïque ?
Elle ne fait pourtant que commencer.
Avant de rentrer, l’enfant héroïque s’attarde en chemin, si ce n’est pas le
même chemin, ce soir-là, que les garçons méchants, auquel cas elle devient leur
proie jusqu’au pied de son immeuble..
Sur le chemin, il y a Titounette, la vieille
chatte de 15 ans. Et peut-être d’autres encore. L’enfant héroïque a appris à
parler à Titounette et aux autres, en s’approchant petit à petit. Un peu plus
chaque jour, précautionneusement, sans entrer dans l’espace qui fera fuir le
chat. Elle se maintient à la distance où le dilemme entre la peur et la
curiosité se fait le plus aigu pour l’animal. Juste là. Au-delà, il fuirait et
il faudrait tout recommencer à zéro… Alors, petit à petit, sur le chemin du
retour, l’enfant héroïque construit des amitiés sans paroles, sans langage,
avec ces êtres doux que sont les chats du quartier. Le langage lui sert pour
partir ailleurs, lorsqu’elle franchit le rideau du saule pleureur. Le langage
lui sert pour fuir le monde des humains réels.
Mais il faut rentrer et, comme tous les
soirs, quitter Titounette. Monter les escaliers de l’immeuble rose qui est
après le saule. Ouvrir la porte où il est marqué « Mr Dupont », comme
s’il n’y avait que lui qui comptait, « Monsieur ». Et rentrer dans un
autre enfer, pour un autre combat, plus désespérant encore.
Le combat du soir, c’est de supporter la guerre entre eux. Les insultes de l’un
envers l’autre. La violence qui ne laisse pas de traces. La violence
omniprésente mais qui ne sera jamais nommée comme telle. Parfois un verre
cassé, une assiette, un objet cher à l’autre, substitut de la chair et des os
qu’on ne cassera pas … violence sans traces. Guerre patricide et matricide.
Il n’est pas question de divorce,
pourtant : il y a « les enfants », ce ne serait pas bien pour
« les enfants », pense maman. Elle le dit parfois. Mais tout est mort
pourtant.
Et la mort continue au quotidien, d’instiller
son poison. Tous les matins, Dieu, que ces tartines sont lourdes à faire …
Dieu, qu’il est lourd de vivre. Où trouve-t-on cette satanée ciguë ?
Je voudrais arrêter là l’histoire, mais
l’enfant héroïque prend la plume et veut écrire elle-même la suite, plus noire
encore.
Je me souviens, le soir parfois, c’est sur le
canapé, ce sont ces moments que commente maman : « oh, tu vis ton
complexe d’Œdipe ! ». Je me souviens de quoi ? De rien. Trou
noir de la mémoire, de ma mémoire, à chaque fois. Seule la nuit se souvient
pour moi.
La nuit : à la lueur de la lampe
d’au-dessus du lit, s’évader sous le saule, franchir le rideau. Prendre la
matière des rêves du lendemain, dans les livres d’histoires écrits par les
humains.
Jusqu’à ne plus voir les lettres sur le
livre, tant les yeux se ferment. Dormir.
Seule la nuit se souvient pour moi … d’un combat contre un être sans forme et
sans nom, qui ne me veut que du mal, infiniment du mal, rend gris et désespéré
le monde dans lequel je vis. Et mon cauchemar nocturne, toujours, consiste en
ce combat contre lui.
Combat désespéré, inégal. Il me veut tant de
mal, il veut tant me détruire, pourquoi, et je veux juste vivre …
Je me souviens, les week-end
souvent, c’est sur son lit. Ce sont ces moments qu’il commente lui, avec ses
mots-couteaux qui me plantent. J’ai oublié les mots, j’ai oublié les lames. A
chaque fois, chaque week-end, pour continuer à supporter de vivre, la mémoire
du moment juste passé, là, de sa violence, disparaissait dans le trou noir de
ma mémoire. Laissant comme unique trace la grisaille du désespoir.
Parfois pourtant, il était gentil. Parfois
pourtant, il m’expliquait ce qu’il savait : comment luisent les lucioles,
comment marche une voiture, qu’est-ce que la force centrifuge, comment retenir
la table de 11, comment tenir sur un vélo, comment marcher, d’abord … et puis
le tout, entrecoupé des paroles-lames, des mots couteaux qui me plantent, à
chaque fois. Comme des pièges tendus en travers de ma vie, comme des pièges
pour que je tombe dans le gouffre, comme un châtiment pour une faute dont je ne
sais rien.
Les paroles-lames me disent, m’expliquent, ce
qu’est une femme pour un homme, quelle sera ma place dans ce monde, à travers
son regard à lui. Son regard est un couteau qui me plante. Et tous les jours,
le combat reprend entre son intention mortifère, et ma volonté de le changer et
ma haine de lui et ma haine de moi et maman qui ne fera rien parce que c’est le
même que le sien.
Spéciales dédicaces.
Je dédie cette recherche à
la mémoire d’Emilienne Mallet, née en 1893 à Cournon d’Auvergne, employée de
bureau à Paris, veuve de Georges Etienne décédé le 17 mai 1915, durant la
guerre.
Emilienne Mallet a quitté
ville et profession pour épouser Alfred S. en 1922, puis a fui cet époux et sa
violence en lui laissant leurs deux enfants, vers 1928, retournant à Paris,
sans que l’histoire ne dise si elle aurait pu les soustraire eux aussi à cette
violence[1].
Je dédie également cette
recherche à la mémoire de Marguerite, la « domestique » effrayante de
« la marraine ».
La marraine, peut-être
surnommée ainsi parce qu’elle avait été marraine de guerre, a été la nouvelle
compagne d’Alfred S. après le départ d’Emilienne Mallet.
Marguerite était
effrayante car « débile mentale ».
Je dédie un peu cette
recherche à la mémoire d’Yvonne S., cette enfant aperçue sur une photo noir et
blanc prise par son père, le photographe Alfred S.
A côté d’elle, sur la
photo, sa petite sœur, née en 1927.
Sur la photo, toutes deux
sont mignonnes, souriantes : des enfants heureuses.
Mais Yvonne S. n’aurait
pas dû avoir de sœur : Alfred S., du moins c’est ce que raconte l’histoire
qui m’est parvenue, ne voulait pas de cette enfant et aurait donc tenté de
faire avorter, par ses propres moyens, son épouse, Emilienne Mallet. L’enfant
est née tout de même, et sourit sur la photo noir et blanc.
Et devint
« débile ».
Je dédie donc une seconde
fois cette recherche à la mémoire de Marguerite, dont je n’ai pu comprendre
qu’après sa mort qu’elle s’appelait Marguerite S.
Je souhaite à Alfred S.
que les vers s’occupent de sa dépouille avec toute la tendresse qu’il mérite,
sincèrement, afin qu’il renaisse en jolie fleur.
Je dédie cette recherche
aux enfants d’Yvonne S., ainsi qu’à l’enfant héroïque qui est l’enfant de l’une
d’elles.
Enfin,
je dédie cette recherche à tous les hommes partis en 1914, avec la fleur au
fusil ou la mort dans l’âme.
A ceux qui ne sont jamais
revenus, morts fusillés pour désertion ou morts « pour la France »
dans ces tranchées où il n’y avait même plus de vers, pour accueillir leurs
dépouilles.
A ceux qui sont revenus,
portant peut-être avec eux la violence initiée là - à moins qu’à l’inverse,
elle n’ait été portée jusque dans ces tranchées par leurs pas ?
Je dédie également cette
recherche à la mémoire de ceux qui n’ont pas de mémoire car pas de
langage : au chat blanc, alias le lion, Léon, et d’autres noms encore,
dont les yeux vert clairs étaient si tristes ce lundi matin d’avril 2010, un
matin d’adieu
A Osiris, dont j’ai
partagé le toit durant 19 ans (à moins que ce ne soit l’inverse ?), qui a
trompé la mort cent fois avant qu’elle le rattrape, et dont la présence puis
l’absence hantent ce travail.
A Plume, qui a préféré ne
pas revenir, trop ébloui par les phares d’une voiture ou par l’attrait des
souris dans les broussailles, on ne sait.
A Titounette la vieille,
et à tou/te/s les sauvages rencontré/e/s quand les civilisé/e/s pourvu/e/s de
langage me jetaient des pierres, sur le chemin de l’école, me hélant sous les
noms de « Sophie le chat » ou encore « la sorcière »,
cependant qu’au moins les sauvages, eux, ne disaient que « miaou » et
étaient doux avec moi ...
Remerciements
Merci à Laurence, Cécile, Francis, Fabrice,
Hélène, Françoise, Irène, Christine, Micheline, Francine, Patricia, pour leur
participation à cette recherche, ainsi que, pour certain/e/s, à leurs
responsables pour avoir relayé ma demande.
Merci à Paulette, Lydia, Agnès, Danielle et
Aurélie, dont les paroles n’avaient pas tout à fait fini d’être écrites.
Merci au CPE anonyme, pour son aide
aujourd’hui pour ce travail mais aussi hier pour d’autres travaux ...
Merci à Marie-Carmen Garcia et à Olivier
Givre pour avoir encadré cette recherche.
Merci à François Laplantine et Axel Guioux
pour leur présence discrète.
Merci aux constructeurs/trices de
l’université publique accessible à peu près à tous, et plus encore à à peu près
toutes : sans votre œuvre ce mémoire n’aurait pu être.
Merci à celles qui, depuis Olympe de Gouges,
ont continué à se battre et ont permis par leurs luttes, pas si anciennes que
cela, que moi une femme, je trouve normal d’avoir pu faire les études que j’ai
faites et normal d’envisager d’aller plus loin. Même si parfois l’on me
rappelle que je devrais, paraît-il, penser à d’autres priorités.
Merci aux promoteurs du décret n° 85-607 du
14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de
l’Etat, et à ceux/celles qui en 2007, l’ont reconduit en l’état cependant
qu’ils/elles « réformaient » tout le reste. Sans les possibilités de
financement de ma reprise d’études ouvertes par ce décret, je tiens à souligner
que jamais je n’aurais pu envisager de réaliser ce travail de recherche.
Merci à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour son soutien financier en
application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, même s’il fut parfois compliqué à
décrypter, semble-t-il.
Merci à moi-même pour mon entêtement à
réaliser mes rêves malgré les (nombreux) obstacles mis sur ma route.
Merci à Bernard de m’avoir transmis jadis la
bibliographie qui lui avait été transmise par son frère, et aussi pour m’avoir
expliqué, en tant que maçon, la modestie des bâtisseurs de cathédrale qui ne
signent pas leur œuvre, ou si peu, puisqu’elle est collective – et, j’ajoute,
qu’ils n’en voient pas toujours la fin.
Merci au parti d’avoir transmis au frère de
Bernard tous ces livres, mais pas pour la guerre froide, le sectarisme à deux
francs, et leurs ravages indélébiles.
Merci à ceux et celles qui ont semé des
obstacles sur ma route pour avoir été toujours, jusqu’à ce jour, heureusement,
moins têtu/e/s que moi.
Merci à Osiris
d’être resté si longtemps et d’avoir été, durant 19 ans, le seul être dont
j’étais forcée de reconnaître qu’il était plus têtu que moi.
Merci au soleil et
aux plantes pour l’air et la lumière qui nous permettent de vivre.
L’inceste, ce terme polysémique, qui désigne aussi bien une alliance prohibée, que le crime monstrueux de cet autrichien, découvert en 2008, qui séquestrait ses filles depuis des années et des années pour en jouir, à sa convenance, comme propriétés sexuelles.
L’inceste, qui désigne la transgression sulfureuse et le crime abominable … les deux ayant comme point commun d’être exceptionnels.
Selon les résultats de l’enquête CSF (Contextes de la Sexualité en France), réalisée en 2006, environ 20 % des femmes agressées sexuellement, ont eu pour premier agresseur un homme de leur parenté. Ce, sachant qu’environ une femme sur dix déclare avoir subi au moins une agression ou une tentative d’agression sexuelle au cours de sa vie (Bozon et Bajos, 2008). Cela signifie qu’entre une et deux femmes sur cent déclarent avoir subi une tentative d’agression, ou une agression sexuelle aboutie, de la part d’un homme de la parenté, en France[2]. L’inceste, qui désigne peut-être pour l’incesteur une transgression sulfureuse, n’est donc pas si hors du commun que cela.
C’est pourquoi il est possible d’effectuer une étude anthropologique non pas simplement de ce qu’en disent les média par exemple, mais de ce qu’en disent les gens qui l’ont subi, ainsi que leurs interlocuteurs/trices lorsqu’ils/elles en parlent.
En master 1, j’avais ainsi mené un premier volet de recherche basé sur des entretiens longs (entre 3 et 4 heures chacun) avec des femmes adultes[3] ayant été victimes d’inceste(s) durant leur enfance.
Après un retour sur les résultats principaux de ce premier volet, j’exposerai la problématique du présent travail, qui porte essentiellement sur des entretiens avec dix professionnel/le/s travaillant avec des mineur/e/s, et ayant pu être confronté/e/s à des révélations d’incestes dans leur cadre professionnel. Les entretiens menés en master 1 seront toutefois également mobilisés, et mis en dialogue avec ces nouveaux entretiens.
Ensuite, après un historique (période 19e-20e siècle essentiellement) du système de protection de l’enfance en France et de l’émergence de la notion de « maltraitance », je décrirai le système de protection de l’enfance contemporain, dans sa complexité, résultante de cette histoire composite. Cette description mènera à des interrogations, en termes de méthodologie, concernant le choix du terrain. Mais également à questionner l’épistémologie appropriée à une recherche sur un thème « infernal »[4] qui nous implique tou/te/s par sa proximité, géographique et temporelle, puisque les faits ne se déroulent pas au Rwanda ou à Bogota, mais en France métropolitaine. Ils ne se déroulent pas plus dans une Antiquité éloignée, puisque la période dont il est question est la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle.
L’entrée sur le terrain sera alors décrite, telle qu’elle s’est déroulée concrètement, dans ce qu’elle révèle, déjà, du regard des acteurs interrogés, sur l’inceste.
Dans une première partie d’analyse des propos recueillis sur le terrain, il s’agira de décrire quand, comment et à quelles occasions se font les révélations d’abus sexuels incestueux auprès des professionnel/le/s rencontré/e/s. Puis seront décrits les effets, notamment émotionnels, de ces révélations sur les professionnel/le/s. En comparant ces réactions avec celles existant autour des révélations reçues dans l’entourage personnel, et, enfin, avec celles des incestées elles-mêmes, nous verrons l’impact de l’inceste sur les liens sociaux, et la transformation, souvent irréversible, de la vision de ces liens qu’il produit auprès de ceux et celles qu’il touche personnellement.
Enfin, sera bien sûr étudié le sort fait à la révélation reçue dans un cadre professionnel : faut-il « aller aux flics » et comment ? Signaler ? Et/ou œuvrer à reconstruire la famille ainsi blessée ?
Un focus particulier sera alors fait, pour finir, sur la place des mères vis-à-vis des abus, dans la réalité et dans les représentations des professionnel/le/s interviewé/e/s.
En master 1, mon travail, « l’inceste : anthropologie d’une entreprise de démolition systématique de la personne », a consisté en une étude anthropologique de l’inceste en France, tel qu’il est vécu dans la réalité lorsqu’il se produit. Plus précisément, tel qu’il est vécu et décrit par des personnes ayant subi un ou des abus incestueux : il se situe donc clairement dans l’étude des violences intra familiales, sujet peu abordé en sociologie et anthropologie de la parenté[5]. Les violences sexuelles incestueuses, quant à elles, n’ont commencé à être étudiées que très récemment en anthropologie (2004).
Ma recherche s’était effectuée à partir d’entretiens (récits de vie) avec des personnes adultes ayant subi des actes incestueux dans le passé (5 entretiens de 3H30 à 4H chacun). Ma problématique se déployait selon trois axes :
1. Les relations dans la famille d'origine, le fonctionnement de cette famille, à l'époque des violences incestueuses, notamment sous l'angle des rapports de pouvoir et de contrôle (des personnes, de l'espace domestique) et aussi des solidarités quand il en existe.
2. Comment l'empreinte de cette enfance modèle-t-elle l’existence (fondation d'une famille, profession, mobilité géographique …) et le quotidien des incesté/e/s ?
3. Comment ces incesté/e/s décrivent-elles(ils) les regards des interlocuteurs/trices et instances auxquelles elles(ils) ont eu affaire en tant que victimes d’inceste (Justice, santé, entourage) et les possibilités de reconnaissance que ces rencontres leur ont (ou non) apportées ?
Cette recherche a montré comment l’inceste ne correspond que rarement au schéma de l’événement surgissant brutalement de l’extérieur, dans la vie des incesté/e/s (comme une effraction de domicile par exemple). Au contraire, il est préparé, construit par l’abuseur au quotidien, et s’inscrit dans une stratégie plus globale de contrôle, d’emprise, soit par lui-même, soit par une personne en position de pouvoir, qui le soutient de fait et fait corps avec lui (comme la mère d’Aurélie alors qu’Aurélie est incestée par son grand frère). Souvent, ces abus sexuels sont une des faces d’un iceberg plus vaste, qui touche tous les aspects de la vie familiale : l’argent et son utilisation (rétention par l’incesteur, et/ou « cadeaux financiers » en lien avec les abus), le contrôle des relations dans le foyer et avec l’extérieur, en constituent des aspects importants. Finalement, l’inceste apparaît non comme simplement une relation abusive entre une victime et un coupable, mais comme un système relationnel entre tou/te/s les membres de l’entourage familial : un ordre, éminemment destructeur, avec en son sommet l’abuseur, et non un désordre.
Des comparaisons avec la dictature ou le système tortionnaire associé, et pour ce dernier dans ses développements les plus « modernes » : la torture sans traces (« torture blanche » - Sironi, 1999), m’ont alors permis de situer l’inceste dans les pratiques de mise sous terreur et de démolition utilisant la violence par et sur le sexe, plutôt que comme une pratique sexuelle déviante par exemple d’un abuseur qui agirait ainsi par « confusion » entre sa femme et ses filles/fils ou sous l’emprise de quelque autre problème sexuel expliquant ses actes sidérants. Mais ces comparaisons ne permettent néanmoins pas de penser la violence « at home », au foyer. En ce sens, l’étude et la comparaison avec la famille esclavagiste créée au Brésil par des européen/ne/s, « fonctionnant » comme un ordre fondé sur le viol et la violence (voir Freyre, 1974), et ayant existé jusqu’à la fin du 19e siècle, a été questionnée comme pouvant plus probablement permettre de commencer à penser cette violence spécifique.
L’inceste
et la violence intrafamiliale souvent concomitante ont en outre une histoire
intergénérationnelle, une généalogie, et constituent une socialisation à ne
rien valoir, à se détruire, à accepter d’être détruit/e voire à participer à,
ou devenir complice de la destruction d’autres personnes. Il se transmet par le
silence, et celles/ceux qui s’obstinent à refuser de maintenir ce silence se
voient sanctionné/e/s (ostracisation) par la famille de l’abuseur. Silence qui n’est « pas qu’une absence de
paroles. C’est une relation créée et maintenue par des individus selon des
règles implicites. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter
mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque
l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son
père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (S. La Branche,
2003, p 28). Et ainsi l’abuseur peut continuer, sur elle et ensuite d’autres
victimes.
Les dégâts les plus notoires de l’inceste semblent se situer dans les possibilités de relations de couple, souvent spontanément subies par devoir suite à la socialisation incestueuse (« rendre son conjoint heureux », « tenir le coup », etc). Mais il touche aussi le rapport au travail, ainsi que beaucoup d’aspects de la vie quotidienne. Cet impact peut être très différé dans le temps. L’inceste est donc un crime qui n’est jamais archivable, et même des décennies s’étant écoulées, il imprègne fréquemment toute l’existence des incesté/e/s, dans ses moindres replis ... en silence.
Silence sur l’inceste qui constitue véritablement un axe central, et ne se limite pas aux familles incestueuses. Ainsi, certain/e/s psychothérapeutes y participent, en évitant le sujet alors même que les incesté/e/s l’abordent. D’autres psychothérapeutes mettent en doute l’existence même de l’inceste relaté par l’incesté/e. Pour autant, le/la psychothérapeute peut aussi avoir un rôle crucial dans le dévoilement des différents incestes dans la famille … lorsqu’il/elle entend.
Par ailleurs, il existe une hiérarchie des abus à laquelle les incesté/e/s adhèrent souvent. Hiérarchie qui étrangement aide beaucoup d’entre elles(eux) à continuer à rester dans la case « ce qui m’est arrivé n’est pas grave ». Hiérarchie viol/autres violences sexuelles. Hiérarchie selon le lien de parenté avec l’abuseur (différence de génération ou non, famille par le sang ou non, père ou autre abuseur). Hiérarchie inceste/hors inceste parfois, cette dernière démarcation ayant des frontières aux définitions diverses et contradictoires entre elles dans les associations de victimes, et étant entendue à l’inverse dans un sens parfois très restrictif par des incesté/e/s ou leurs proches.
Cette hiérarchisation des abus est reprise (ou créée ?) par la Justice, et l’inceste n’existe pas dans les textes pénaux et civils français[6]. De plus, telle qu’elle est conduite aujourd'hui, cette Justice ne permet qu’à un nombre faible d’incesté/e/s d’obtenir reconnaissance. Ses délais pour déposer plainte ne sont pas adaptés à la temporalité dont ont besoin les ex-incesté/e/s pour imaginer déposer plainte. L’accueil reste très disparate, la minimisation/banalisation du crime (« était-ce un jeu ? »), voire la culpabilisation de sa victime (« cette enfant de 11 ans était-elle aguicheuse ? »), s’ils ne font plus l’unanimité (Vigarello, 1998), restent néanmoins bien vivaces. C’est ainsi que la majorité des ex-incesté/e/s sont renvoyé/e/s au non lieu, au sans suite, qui laisse intacts tous les droits et obligations familiaux, comme si de rien n’était (y compris les droits de visite de l’abuseur sur les futurs enfants de ses victimes …), et leur interdit de fait le témoignage public sur le crime qu’elles ont subi (Thomas, 2004).
La présente recherche, menée en master 2, s’est donnée quant à elle pour objectif de comprendre comment était perçu l’inceste par des personnes pouvant, à titre professionnel, être amenées à rencontrer des mineur/e/s incesté/e/s.
C’est en partant des interrogations posées pour moi par l’extrait d’article suivant, que j’ai construit ma problématique.
« Une bonne campagne contre l’inceste devrait montrer aux parents les
limites de l’intimité de l’enfant, en expliquant par exemple qu’il faut fermer
la porte de la salle de bains pendant la douche », dit Annie Gaudière,
directrice générale de l’organisation Allô enfance maltraitée (le 119), dans
l’édition du Monde du 22 février. Les appels téléphoniques reçus par le 119
révéleraient donc des situations de vie à ce point différentes de ce que
décrivent les victimes d’inceste devenues adultes pour qu’Annie Gaudière
réduise l’abus sexuel intrafamilial à une histoire de porte ouverte ?
L’enquête ethnographique et la consultation en milieu hospitalier permettent
d’établir un constat certain : l’abuseur ouvre la porte, même quand elle
est fermée ; occasionnellement, il la casse. La plupart du temps, il casse
chez sa victime toute velléité éventuelle de fermer la porte. » (Dorothée
Dussy, Marc Shelly, mars 2005).
Dans cet article, ce qui transparaît, c’est un écart important entre la manière de concevoir l’abus incestueux, pour Annie Gaudière par exemple, et ce qui en est audible lorsque des ancien/ne/s incesté/e/s, devenu/e/s adultes, en parlent, par exemple lors d’un entretien avec un/e anthropologue pour un travail de recherche.
D’un côté, Annie Gaudière, directrice de professionnel/le/s de l’enfance en charge du n°119, affirme qu’il faut apprendre aux incesteurs à fermer les portes (donc qu’il peuvent et voudraient bien apprendre). Cela peut sous entendre que l’inceste serait commis, en somme, par ignorance ou par manque de repères concernant les conditions propices à un bon développement de l’enfant.
De l’autre côté, l’anthropologue Dorothée Dussy et le praticien hospitalier Marc Shelly évoquent un incesteur pourvu d’une intention claire, et prêt à toutes formes de violences pour parvenir à ses fins : ouvrir la porte si tel est son désir, abuser l’enfant si tel est son désir.
En tant que personne ayant dû cohabiter durant des années avec mon incesteur, j’ai moi aussi beaucoup de mal à comprendre la vision des choses développée par Annie Gaudière. Elle m’est radicalement étrangère, comme venue d’un autre univers, suscite ma perplexité, m’intrigue beaucoup. Alors que le propos de Dussy et Shelly me semble « évident », et pour cause :
Moi - lorsque j’étais
au lycée, la porte de cette salle de bains-là … si je m’y enfermais pour lui
échapper, « il » l’ouvrait avec un tournevis, qu’il plaçait dans la
serrure côté extérieur, et tournait, tout en vociférant et hurlant. Ensuite, il
y avait des coups, de sa part, plein de coups qui se succédaient, décuplés en
nombre et intensité par la rage d’avoir du affronter un obstacle placé sur sa
route avant de parvenir à me les octroyer. L’obstacle ? la porte,
« insolemment » fermée par mes soins, et mes mains arc-boutées sur la
serrure côté intérieur pour ne pas qu’il parvienne à la faire tourner, peine
perdue hélas car je n’ai jamais su par quel procédé, son tournevis était
toujours le plus fort, transformant cet homme violent en une sorte de superman
invincible à mes yeux, à qui mieux valait ne pas résister pour que ce ne soit
pas pire encore …
Et tout cela, c’était
normal.
Avant
que j’arrive au lycée, cette salle de bains-là a en outre été l’un des lieux de
ses exactions incestueuses. La porte était-elle fermée ? Ouverte ?
Par les bons soins de qui ? Je l’ignore, tant mes souvenirs sont alors
flous, flou que je n’ai aucun désir de lever ici. Il est juste patent que
j’étais alors encore plus petite, et lui encore plus « superman »,
que lorsque j’étais au lycée.
Agissait-il
par simple méconnaissance des bons principes concernant « l’intimité de
l’enfant » ? Je ne saurais le dire. J’ai mon intime conviction. Mais
quelle légitimité pour la dire haut et fort et qu’elle serve ?
Est-elle si difficile à
penser, la haine et la volonté de destruction envers un/e enfant par un/e de
ses propres apparenté/e/s ?
Pour Annie Gaudière et d’autres, certainement, c’est cet univers de haine envers l’enfant ou les enfants ainsi ciblé/e/s, qui est étrange, voire carrément étranger, et heureusement, car cela signifie qu’elles/ils ont vécu dans un monde plus vivable.
Or, dans les propos d’Annie Gaudière, c’est précisément cette haine qui disparaît, qui est passée sous silence.
Passée sous silence, mais en premier lieu pour Annie Gaudière elle-même : l’inceste semble lui apparaître comme quelque chose de « pas fait exprès ». Il est alors réduit à un acte d’atteinte à l’intimité de l’enfant, une atteinte des « limites » de celle-ci. Ce qu’il est, bien sûr, mais pas seulement. Le sadisme de l’incesteur/euse ? Sa perversité ? Sa violence volontaire ? Passés sous silence, car tout simplement non pensés.
Nous trouverions-nous là devant une « violence impensable » pour Annie Gaudière et les personnes qui s’expriment comme elle sur ce sujet, pour reprendre le titre d’un ouvrage[7] ?
La problématique de mon travail
de master 2 s’est, à partir de ces réflexions, déclinée en trois axes, avec
comme fil conducteur central le silence, ainsi que ce qui l’entretient et ce qui permet de le rompre. Je
souhaitais partir du silence tel que le définit Stéphane La
Branche :
« le silence est (…) à la base de la subjugation. Le silence dont
il est question ici est celui des victimes qui ne parlent pas de l’abus, même
si elles en souffrent. La première cause de ce silence est simple :
l’absence de recours. Si un enfant est victime d’abus de la part d’un parent,
vers qui peut-il se tourner pour recevoir de l’aide ? Se taire signifie
pour lui survivre, mais à un prix incroyablement élevé. La deuxième cause est
l’entourage. Lorsque l’enfant demande de l’aide, son discours et son expérience
sont souvent niés par la famille immédiate qui évite de faire face à la
situation. Le silence n’est donc pas qu’une absence de paroles. C’est une
relation créée et maintenue par des individus selon des règles implicites
[souligné par moi]. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter
mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque
l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son
père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (Stéphane La
Branche, 2003, p. 28), ou encore qu’elle reste sans réactions,
indifférente, comme si ce n’était rien de si grave.
Mais comment penser ainsi en termes de « silence » les écarts
entre l’analyse d’Annie Gaudière et le vécu réel des incesté/e/s ? En ce
qu’ils déportent le centre de l’attention sur d’autres points que l’abus sexuel
incestueux : sur des normes jugées « saines » d’intimité, et qui
feraient prophylaxie contre toute dérive incestueuse ?
Ces écarts de description n’agiraient-ils pas pour les
professionnel/le/s, finalement, comme une « théorie écran » telle que
la décrit également Dorothée Dussy concernant l’anthropologie :
« Pour ce qui est de l’inceste, (…) la théorie [anthropologique] de la
prohibition fait fonction d’écran à la dimension empirique de l’inceste »
(Dorothée Dussy, 2009, p 136) ?
Dès lors, étudier le silence, ce qui peut le rompre et ce qui, à l’inverse, l’entretient, revient à étudier la ou les théories, « écran », ou plus proches du réel, qui oeuvrent pour les interlocuteurs/trices des jeunes victimes d’inceste ou de leurs proches.
D’où un questionnement autour
des points suivants :
1.
Comment les professionnel/le/s (ou bénévoles) du champ
social, de la psychologie ou encore de la protection de l’enfance se
représentent-ils/elles, décrivent-ils/elles, mais aussi éprouvent-ils/elles
l’inceste ?
La recherche de master 1 a fait émerger plusieurs sous-axes possibles : la polarisation « faut-il soigner et/ou punir l’abuseur ? » qui recoupe celle entre folie, traumatisme d’une part, et crime, mal et morale, d’autre part ; l’existence d’une hiérarchisation des abus. L’article cité ci-dessus, pose également la question de la violence, de ce qui en est perçu et analysé, ou non, par les professionnel/le/s.
Par delà ces distinguos, mes entretiens de master 2 me conduisent à poser la question d’une polarisation entre une logique d’appréhension des abus en termes d’actes (coups, touchers déplacés, etc), dont on pourrait constater les traces (hématomes, déflorations, séquelles psychologiques), ainsi que déterminer la gravité suivant une échelle (« viols », « simples tripotages », etc), et une logique d’appréhension en termes d’intentions, plus soucieuse des intentions de l’incesteur/euse et de son impact, dans une relation historicisée et globale avec sa ou ses victimes : nous retrouverions là notamment l’écart entre la pensée d’Annie Gaudière et les vécus des victimes d’incestes concernant la violence.
Enfin, les sentiments (dégoût ? Indignation ? Révolte ? Sidération ? …) suscités pour ces personnes par la confrontation avec l’abus incestueux retiennent fortement mon attention, lorsqu’ils sont évoqués.
2.
Quelles représentations de la famille, des relations
parents/enfants et hommes/femmes sont en œuvre ici ?
La recherche de master 1 a montré le rôle des croyances des professionnel/le/s rencontré/e/s, concernant la famille, dans la continuation du silence autour de l’inceste : si tel enfant ne va pas bien, c’est, exemple récurrent, à cause du divorce de ses parents, l’inceste étant éludé quand son existence est connue, ou bien constituant une éventualité impensée sinon. Ici, il s’agit d’approfondir l’étude de ces représentations de la famille, et de leurs implications très concrètes relativement aux cas d’abus sexuels incestueux.
3.
Enfin, quelles divergences et convergences
existent-elles entre ces représentations, et l’inceste tel qu’il est
descriptible à partir des entretiens avec des incesté/e/s effectués en
master 1 ?
Ceci dans l’idée d’une cartographie précise des analyses des incesté/e/s et des professionnel/le/s, ainsi que de leurs croyances respectives concernant notamment les manières de faire des différent/e/s professionnel/le/s, les signes montrés par les incesté/e/s, et la parole autour de l’inceste.
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il m’a paru intéressant de resituer l’inceste dans le champ plus large des maltraitances au sein de la famille.
II - Les acteurs du terrain : présentation et implications méthodologiques
Et, pour ce faire, il nous faut commencer par comprendre l’univers dans lequel nous entrons, avec en son centre la « protection de l’enfance », afin de pouvoir préciser ensuite les choix méthodologiques pour ce travail.
Compréhension tentée, en première approche, par la lecture des nombreux documents disponibles via les sites internet des organismes et administrations concernés, ainsi que celle des écrits de différentes personnalités, qu’elles soient chercheurs en sciences humaines ou elles-mêmes professionnelles. Ou encore chercheurs/euses et professionnel/le/s à la fois.
Compréhension qui peut prendre du temps, m’en a pris en tout cas, et va, dans l’immédiat, nous occuper pour quelques pages, qui vont commencer par un historique, avant de nous attacher à décrire le système de protection de l’enfance tel qu’il existe aujourd’hui (années 2000) en France.
Selon Sellenet, « le mot maltraitance apparaît en 1550 au sens de « traiter durement » ; à l’époque classique, il signifie « mal nourrir » (1636), mais il faut attendre 1987 pour que la forme moderne du mot « maltraitance » se fixe dans notre vocabulaire. Il renvoie à une multiplicité de synonymes : rudoyer, battre, malmener, éreinter, étriller, houspiller, frapper, molester, abîmer, blesser … » (Sellenet, 2003, p 96-97).
Selon Noiriel, les faits divers médiatisés « ont imposé dans notre vocabulaire courant le terme de « maltraitance », au point que l’on a oublié qu’il est très récent dans la langue française. « Si maltraiter est soudé en un composé depuis le XVIe siècle, le dérivé maltraitance a moins de vingt ans » constate le linguiste Alain Rey (2001). Et il ajoute que ce terme « est venu rejoindre ces noms en –ance ou en –ence qui décrivent une action particulière, souvent plus précise et plus forte que le verbe dont ils proviennent (…). Ainsi la maltraitance est pire et va plus loin que les mauvais traitements. (…) » (…) La rapidité avec laquelle le mot « maltraitance » s’est imposé dans la langue française est un indice de l’importance que l’on accorde aujourd’hui à la question des formes de domination dans la sphère domestique. » (Noiriel, 2005, p 154-155).
Les termes ont donc évolué avec le temps, et n’ont pas toujours désigné les mêmes réalités. Les perceptions de ces réalités ont également évolué, comme le relate Ian Hacking : « En se limitant aux sociétés industrialisées à partir de 1800, nous possédons une quantité infinie de documents qui témoignent des horreurs subies par les enfants, que l’on considérait à l’époque avec effroi, et que manifestement les enfants détestaient tout autant. On faisait subir d’autres traitements aux enfants que nous jugeons mauvais aujourd’hui et que les enfants d’aujourd’hui détesteraient, mais qui, à l’époque, n’étaient pas nécessairement perçus comme tels. » (Hacking, 2006, p 92).
D’autre part, Hacking ajoute que l’idée d’abus sur enfant présuppose l’idée même d’enfance, qui, depuis les travaux d’Ariès (et, j’ajoute, les childhood studies qui s’en sont inspirées) est connue comme n’étant pas universellement existante. Il remarque en outre que, avant 1960, on parlait rarement « d’abus sur enfant », mais bien plutôt de « cruauté envers les enfants ».
Cette « cruauté envers les enfants », à l’ère victorienne, « ne fut mise explicitement en évidence qu’en 1874. Elle ne focalisa l’intérêt du public qu’à la suite d’un fait sensationnel (…). Une fillette, qui avait été battue et humiliée brutalement par sa belle-mère devint le symbole de toutes les horreurs cachées. On répondit par la création de la Société New-yorkaise pour le prévention de la cruauté envers les enfants (…). [Il est intéressant de noter que] Il s’agissait en fait d’une ramification d’une organisation consacrée jusque-là à la prévention de la cruauté envers les animaux, la Société américaine humanitaire (…). Tout se passait comme s’il n’y avait pas de place pour ce concept de cruauté envers les enfants, de telle sorte que ce problème devait rentrer sous la coupe d’une organisation déjà existante qui s’occupait des animaux. » (Hacking, 2006, p 93). Néanmoins, rapidement, l’idée se répand à travers les Etats-Unis et également en Angleterre. Et selon Hacking, « La cruauté envers les enfants a occupé une place de choix au sein du stock de causes morales où s’approvisionnait l’ère victorienne. La lutte contre l’esclavage avait été l’une des premières. Il y avait à l’époque toute une campagne d’agitation autour des heures de travail des enfants, qui contribua à associer d’un point de vue conceptuel l’enfance et l’esclavage. » (Hacking, 2006, p 94). Et c’est donc en participant de tout un réseau de luttes mobilisant les mêmes classes sociales : luttes contre l’abus d’alcool, pour l’extension du droit de vote, contre la vivisection, pour les droits des femmes … que s’inscrit la lutte contre la cruauté envers les enfants, perçue, on le voit, comme en lien également avec par exemple le travail des enfants. Cette cruauté envers les enfants était, en outre, décrite comme constituant avant tout un vice des classes sociales inférieures. Elle était une mauvaise chose, un mal, mais un mal parmi d’autres, « elle était simplement jugée particulièrement mauvaise, car elle s’attaquait à l’innocent, et qu’elle amenait souvent ce dernier à devenir plus tard un danger public promis à la délinquance organisée. » (Hacking, 2006, p 95). Enfin, durant l’ère victorienne, les procès font état de nombreux cas d’abus sexuels sur mineur/e/s, « Mais ces actes vicieux n’étaient en général pas regroupés avec la cruauté envers les enfants. » (Hacking, 2006, p 96).
Les campagnes contre les abus sur enfants débutent en 1961, lorsqu’un groupe de pédiatres de Denver attirèrent l’attention, en montrant des radios des os fracturés de nourrissons, sur les blessures de ces tout/e/s petit/e/s. « Si ces faits étaient déjà largement connus depuis 1945, personne n’avait osé dire que ces fractures étaient causées par les parents qui battaient leurs bébés. » (Hacking, 2006, p 98). Hacking remarque la finesse stratégique de ces pédiatres, qui ont choisi de montrer des radios de nourrissons, ce qui leur permettait « d’écarter le problème du prétendu droit qu’auraient les parents d’infliger des traitements physiques sévères à leurs enfants. Personne en effet ne pouvait soutenir que les parents avaient le droit de punir de simples bébés. » (Hacking, 2006, p 101). Ensuite, il ne restait plus qu’à faire considérer les bébés comme un sous-ensemble d’un ensemble en réalité plus vaste : celui des enfants victimes d’abus. L’attention était, ici, focalisée sur l’abus physique puis la négligence.
Dans la cruauté envers les enfants de l’époque victorienne, l’homme qui avait battu ou violé sa fille, nous dit Hacking, « était un minable qu’il fallait punir. » (Hacking, 2006, p 97), ou encore, la mère négligente, « devait être séparée de sa progéniture dans la mesure où elle leur faisait du mal, et non parce qu’elle appartenait à l’espèce de ceux qui font du mal aux enfants. » (Hacking, 2006, p 97). Dans l’abus sur enfant des années 1960, apparu aux Etats-Unis, les médecins « déclarèrent que les auteurs d’abus étaient des malades. » (Hacking, 2006, p 96). On suppose donc qu’il existe des types de personnes, telles les auteur/e/s ou les victimes d’abus sur enfants, à propos desquels une connaissance scientifique est possible et pourrait être efficiente : « Si cette connaissance est valable, on obtiendra de nombreux types d’abus, d’auteurs d’abus et de victimes d’abus, qui répondront à différents types de lois médicales, psychiatriques et statistiques. » (Hacking, 2006, p 97). J’ajoute que cette approche est encore prégnante en France aujourd’hui même, au niveau des documents écrits par les décideurs/euses dirigeant la protection de l’enfance. Ainsi, le SNATED, plus connu sous le nom de « 119 – allô enfance maltraitée », réalise des journées de formation à l’attention des professionnel/le/s :
« Elles
sont centrées sur la présentation du SNATED, son articulation avec les
dispositifs de protection de l'enfance, l'activité d'écoute, et les données
épidémiologiques relatives à la maltraitance. [souligné par moi]
(…)
Attention,
notre service étant très sollicité, nous ne pouvons malheureusement
pas répondre positivement à l'ensemble des demandes.
Le
SNATED n'intervient qu'auprès de professionnels. » (Source : site
internet du n°119)
Et si l’on regarde sur les différents sites des – nombreux - observatoires chargés de construire des statistiques autour des phénomènes « maltraitance et enfance en danger » (ODAS, ONED …), on trouve même des idées, tout à fait sérieuses, comme
«
Une enquête en population générale, réalisée auprès d’adultes, mais aussi
auprès d’enfants permettrait de répondre à cette question. Une telle
investigation ne nous semble cependant aujourd’hui pas justifiée du fait des
difficultés matérielles et juridiques, ainsi que du coût élevé d’un tel type
d’enquête » (Source : Guyarvarch, ONED 2008, p 6)
La question ? Savoir si les enfants d’aujourd’hui sont maltraités dans les mêmes proportions, ou non, que les adultes qui disent aujourd’hui dans les enquêtes qui le leur demandent, s’ils/elles ont été maltraité/e/s durant leur enfance.
La question qui manque, maintenant, dans cette réflexion : et qu’aurait fait l’ONED de tous les enfants qui auraient, anonymement, répondu « oui » aux item montrant qu’ils subissaient des maltraitances, là, en ce moment-même ?
Durant les années 1960, ce nouveau champ de connaissance, de typologisation, d’élaboration de « lois » statistiques autour des abus, prend corps à partir d’a priori, continue Hacking : « « Souvent, les parents peuvent faire subir à leurs enfants le type de traitements qu’on leur a appliqué lorsqu’eux-mêmes étaient enfants ». Cette remarque est tirée du premier article paru sur les bébés battus. (…) Cette phrase devint pratiquement un axiome adopté par la grande majorité des cliniciens et des travailleurs sociaux, et une idée générale reprise par les profanes » (Hacking, 2006, p 99).
En plus de son caractère « médicalisé », l’abus sur enfants se distingue de la cruauté sur enfants de l’ère victorienne sur trois autres points, nous dit encore Hacking :
- la cruauté envers les enfants était une cruauté parmi d’autres, comme celle exercée sur les animaux par exemple : « La cruauté envers les enfants était un mal, l’abus sur enfant est le mal absolu. » (Hacking, 2006, p 95).
- La cruauté envers les enfants était un vice des classes pauvres. L’abus sur enfant touche tous les milieux sociaux : ce qu’il menace, c’est la famille.
- La cruauté sexuelle envers les enfants va devenir, une décennie après les radios des pédiatres de Denver, une composante essentielle de la définition de « l’abus sur enfant », voire le prototype de ce « [mal absolu] parfaitement inintelligible au sens où seul le mal absolu peut être inintelligible. » (Hacking, 2006, p 96). Ce, alors qu’elle était totalement absente de l’idée de « cruauté sur enfants ».
C’est durant les années 1970, qu’arrive en effet, enfin, la question des abus sexuels sur enfants. « On pensait autrefois que les auteurs d’agressions sexuelles n’étaient pas des familiers. (…) Les agressions sexuelles touchaient toutes les couches sociales mais épargnaient les liens du sang. Cependant, des bébés étaient battus dans leur propre famille ! Pourquoi pas alors des agressions sexuelles au sein de la famille ? Un amalgame entre ces deux idées, l’abus interne à la famille et l’agression sexuelle, commença à se produire. L’agression sexuelle à l’intérieur de la famille nous ramenait à l’inceste. » (Hacking, 2006, p 102).
Et c’est « Florence Rush, une assistante sociale déjà impliquée dans les mouvements féministes, qui, la première, réalise cette synthèse. Dans la conférence qu’elle prononce le 17 avril 1971 à New-York – devant des centaines de femmes réunies pour assister aux assises du mouvement des radical feminists, consacrées aux viols -, elle lève le voile sur les abus sexuels de l’enfance. Elle démontre avec force, en se fondant sur son expérience professionnelle auprès de fillettes violentées, que les maltraitances infantiles sont très souvent sexuelles, qu’elles préfigurent le sort des femmes dans la société et que la lutte contre ce phénomène délibérément ignoré est aussi, si ce n’est d’abord, le combat des féministes. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 124). Elle est alors la première à s’opposer à la doxa psychanalytique, poursuivent Fassin et Rechtman, en expliquant qu’à son avis, les souvenirs d’abus sexuels par des parents, subsistant ou revenant à l’âge adulte, ne sont pas l’expression de fantasmes oedipiens, mais des souvenirs réels. C’est de là qu’aux Etats-Unis partent les mouvements d’anciennes victimes d’inceste choisissant de se nommer « survivantes de l’inceste ».
Mais, dans le même temps, Hacking remarque que « Un des puissants motifs qui se cache derrière le mouvement contre les abus sur enfant est la peur viscérale qu’inspire l’idée de la destruction de la famille américaine (…). La crainte d’une atteinte portée à la famille correspond au courant conservateur de l’activisme luttant contre les abus sur enfants. Il est contrebalancé par le courant radical des féministes, qui font de l’abus sur enfant un des visages du système patriarcal. La campagne contre les abus sur enfants a provoqué une coalition surprenante entre ceux qui s’attaquent à la famille traditionnelle et ceux qui redoutent sa dissolution. » (Hacking, 2006, p 95). Aux Etats-Unis, il y a donc eu une jonction, pensée par Hacking, ainsi que Fassin et Rechtman à sa suite, comme « contre nature », entre le mouvement féministe et des mouvances conservatrices, sur cette question de l’inceste. Fassin et Rechtman prennent, pour le montrer plus clairement, l’exemple de « la création des Parents anonymes, conçus sur le modèle des Alcooliques anonymes, [où] les « parents maltraitants » réapprennent les valeurs familiales, l’abnégation des mères, le dévouement des épouses. La défense de ces valeurs s’inscrit dans une vision naturaliste où la maltraitance est interprétée comme une aberration « biologique » du comportement humain. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 123). Dans cette mouvance, il cite Child abuse and neglect, première revue scientifique exclusivement consacrée à la maltraitance des enfants, créée en 1977. Il relève combien elle est éloignée de la critique féministe de la naturalisation de la reproduction, par exemple. Et « Pourtant, alors que tout semble les opposer – l’idéal familial, les valeurs religieuses, la domination masculine, le rôle maternel prédominant des femmes, le respect des valeurs américaines ancestrales, le silence sur les abus sexuels -, les progressistes féministes trouveront dans le combat mené par les mouvements de protection de l’enfance maltraitée une convergence inattendue leur permettant de conquérir une nouvelle audience, cette fois légitimée par le traumatisme. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 123). C’est en effet par la grille de description du viol en termes de « traumatisme » que se construit cette convergence qui semblait contre nature[8].
Mais ceci, aux Etats-Unis seulement : en France, nous n’avons pas de troubles de la personnalité multiple générés par les abus sur enfants comme peut, par suite, les étudier Hacking, et nous n’avons pas non plus eu de jonction équivalente. C’est ainsi que, aujourd’hui encore, les associations de victimes d’inceste sont pour la plupart construite sans connexion aucune avec les mouvances féministes. De même, les associations de défense des enfants maltraités telles enfance et partage n’ont, pour la plupart, aucun lien avec ces mouvances-là.
Est-ce ceci qui rend possible de penser l’inceste et la violence conjugale comme deux univers séparés, qui ne seraient jamais réunis dans le même foyer ? Nous verrons par la suite les difficultés, bien concrètes, induites par ce que soulève cette question que je pose là en passant.
Pour faire un historique autour de la maltraitance et de la protection de l’enfance en France, Hacking et Fassin ne nous sont plus d’aucun secours. Il nous faut revenir vers des personnes plus proches du terrain français : Catherine Sellenet, qui est psychologue, juriste, sociologue, chercheur au CREF de Paris X, et enseigne en sciences de l’éducation, et Jean-Pierre Rozencveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, et également, notamment, vice-président du bureau international sur les droits de l’enfant.
Avant de commencer l’historique proprement dit, il me faut alors faire remarquer que Didier Fassin est « anthropologue, sociologue et médecin, professeur à l’université de Paris Nord et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales », et que Richard Rechtman est « psychiatre et anthropologue, médecin chef de l’Institut Marcel Rivière (…) et rédacteur en chef de la revue L’évolution psychiatrique », selon la quatrième de couverture de leur ouvrage rédigé à quatre mains.
Pierre Bourdieu, dans son discours du 6 décembre 2000, prononcé lors de la remise de la Huxley memorial Medal for 2000, expose le concept « d’objectivation participante ». « Par objectivation participante, j’entends l’objectivation du sujet de l’objectivation, du sujet analysant, bref, du chercheur lui-même. Ce qui pourrait faire croire que je me réfère à cette pratique qui a été mise à la mode, il y a quelques années, par certains anthropologues, notamment outre-Atlantique : celle qui consiste à s’observer observant, à observer l’observateur dans son travail d’observation ou de transcription de ses observations, dans et par un retour sur l’expérience du terrain, sur le rapport aux informateurs et, last but not least, sur le récit de toutes ces expériences, qui conduit, bien souvent, à la conclusion, assez désespérante, que tout cela n’est jamais en définitive que discours, texte, ou, pire, prétexte à texte. » (Bourdieu, 2003, p 43)[9]. L’objectivation participante, c’est l’idée qu’il ne suffit pas d’expliciter l’expérience vécue du sujet connaissant, ou encore ses particularités biographiques propres. En fait, « L’objectivation participante se donne pour objet d’explorer, non « l’expérience vécue » du sujet connaissant, mais les conditions sociales de possibilité (donc les effets et les limites) de cette expérience et, plus précisément, de l’acte d’objectivation. » (Bourdieu, 2003, p 44). Limpide.
Pour sortir un peu du brouillard dans lequel, peut-être, nous a jetés cette définition, il faut lire plus loin que, « Ce qu’il s’agit d’objectiver, en effet, ce n’est pas l’anthropologue faisant l’analyse anthropologique d’un monde étranger, mais le monde social qui a fait l’anthropologue et l’anthropologie consciente ou inconsciente qu’il engage dans sa pratique anthropologique ; pas seulement son milieu d’origine, sa position et sa trajectoire dans l’espace social (…), mais aussi et surtout sa position particulière dans le microcosme des anthropologues. Il est en effet scientifiquement attesté que ses choix scientifiques les plus décisifs (sujet, méthode, théorie, etc) dépendent très étroitement de la position qu’il occupe dans son univers professionnel, dans ce que j’appelle le champ anthropologique » (Bourdieu, 2003, p 45). Pierre Bourdieu, peut-être parce qu’il n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’universitaire « pur sucre », n’envisage pas ici que les chercheurs/euses puissent appartenir à plusieurs champs différents simultanément, et être ainsi acteurs/trices de leur évolution : hormis Rozencveig, qui n’est « que » membre éminent du champ de la protection de l’enfance, tou/te/s les autres auteur/e/s dont j’ai détaillé les titres sont ainsi « pluri-champs ». Par ailleurs, les quatre personnes citées travaillent dans des organismes de recherche parisiens, les trois hommes sont de surcroît dans des positions dirigeantes d’institutions, et pas uniquement d’institutions dans le champ de la recherche en sciences sociales. Rechtman est médecin chef, Rozencveig est président de son tribunal pour enfants. Quant à Fassin, en sus d’être médecin, il est directeur d’études à l’EHESS, une des écoles les plus prestigieuses dans le champ de l’anthropologie française.
Ce n’est, manifestement, pas du côté de l’EHESS qu’il faut chercher l’histoire de la protection de l’enfance en France, à ce jour. Au contraire, une lecture peu attentive des ouvrages de Fassin et Rechtman, pourrait laisser croire que l’inceste est devenu un « problème de société », omniprésent, qu’il y aurait des « personnalités multiples » partout, etc.
Or, en France, aucune trace, visible d’où je suis, de tout cela. Pourtant, transparaît à travers l’ouvrage de Fassin et Rechtman une influence de ces débats, à travers l’Atlantique, dans certaines sphères, telles les champs où eux évoluent professionnellement : c’est pourquoi c’est bien du côté, par exemple, de l’EHESS, qu’il fallait se tourner pour connaître ce pan-là de l’histoire de la protection de l’enfance en France.
A cet égard, Noiriel relate que déjà en 1898, « L’exemple américain est souvent évoqué par les parlementaires français. (…) Néanmoins cette internationalisation précoce de la réflexion sur l’enfance ne doit pas masquer la force des logiques nationales. » (Noiriel, 2005, p 162). Et, partant, aujourd’hui comme hier, il faut être vigilant/e/s à ne pas réduire l’histoire de l’Europe uniquement à celle de ce qui lui vient d’Amérique du nord.
C’est, donc, du côté de chercheurs/euses « plus proches (professionnellement …) du terrain français » de la protection de l’enfance, ainsi que de chercheurs/euses d’autres disciplines telles l’Histoire, qu’il faut que j’oriente à présent nos regards.
En France, sous la troisième République, « La protection de l’enfance a été un enjeu majeur des luttes ayant opposé les républicains aux conservateurs entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Les partis hostiles à la République défendent alors un ordre social dont le principal pilier est la famille. Ils refusent donc énergiquement que l’Etat intervienne pour protéger les enfants maltraités par leurs parents. Selon eux de tels actes de barbarie sont rares et ne concernent que des milieux marginaux (saltimbanques qui prostituent leurs filles, ouvriers alcooliques et violents, etc). Pour le camp conservateur, il suffit donc de réprimer ces comportements contre-nature, et de moraliser les classes populaires en s’appuyant sur l’Eglise. La thématique de la « cruauté sur enfants » leur fournit les justifications dont ils ont besoin pour empêcher l’immixtion de l’Etat dans les affaires familiales. A l’inverse, le combat que les partis républicains mènent contre l’ordre ancien passe par une remise en cause de la toute puissance du père de famille, premier fondement du Code Civil. (…) A leurs yeux, les droits de l’individu (de l’enfant) passent avant ceux de la famille. Le pays des Droits de l’homme ne peut pas accepter que des parents indignes persécutent d’innocentes victimes. L’intérêt de la nation toute entière est en jeu, car les enfants maltraités deviennent fatalement de mauvais citoyens, des criminels ou des révolutionnaires. Tels sont, en substance, les arguments avancés par les partisans de la loi sur « la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités », adoptée le 24 juillet 1889. » (Noiriel, 2005, p 163).
Noiriel ajoute que cette loi, qui introduit la possibilité de « déchéance de la puissance paternelle », constitue en France le point de départ de la politique de protection de l’enfance. Elle est en outre d’une importance capitale pour la Troisième République car « aucune sphère de la société n’échappe plus désormais à l’intervention de l’Etat » (Noiriel, 2005, p 163). Ensuite, la protection de l’enfance étant constituée en problème politique légitime, sera simplement dénoncée l’insuffisance de la loi, pour proposer de nouvelles mesures, pensées comme pouvant être plus efficaces.
Pour Sellenet, à cette époque, « Trois catégories d’enfants sont [pensées comme] à protéger : les enfants placés chez des nourrices mercenaires, les enfants abandonnés et les enfants maltraités. La protection prend deux visages : elle lutte contre la mortalité infantile, mais aussi contre le risque d’asocialité qui fait peur à la société. La protection n’est pas totalement gratuite : elle affiche un double intérêt : l’intérêt démographique, et l’intérêt civil de préservation de la paix sociale » (Sellenet, 2006, p 23). Nous avions déjà remarqué, au passage, les légères nuances existantes entre la « cruauté sur enfants » telle qu’elle était décrite par Hacking, et par Noiriel. Chez Sellenet, nous pouvons noter l’absence de controverse sociale : ni partis Républicains, ni partis conservateurs, mais une société qui a des intérêts très pragmatiques à « protéger » les enfants. C’est pourtant bien de la même loi de 1889 dont il est question, chez Noiriel et Sellenet : ce sont donc leurs grilles d’analyse implicites qui diffèrent, nous montrant différents aspects du réel.
Pour Sellenet, trois lois font date dans l’histoire de la protection de l’enfance, la première étant la loi Roussel de 1874.
La loi Roussel est votée à l’unanimité. « Elle est le résultat d’une volonté politique qui rencontre un courant médical et scientifique en expansion. » (Sellenet, 2006, p 23). Cette loi concerne uniquement les enfants de moins de 2 ans lorsqu’ils sont placés chez des nourrices « mercenaires », « car seule la transaction financière justifie l’intervention de la collectivité » (Sellenet, 2006, p 24). Quant aux motivations avancées, elles « ne sont pas toutes dans le registre altruiste, et l’on peut dénoncer sans peine une « instrumentalisation de l’enfant » au travers de cette loi. A l’origine de cet intérêt subit pour l’enfant, des intérêts économiques et démographiques sont en jeu comme le rappelle Paul Strauss qui, avec Théophile Roussel, fut très largement à l’origine de la loi. (…) La parfaite comptabilité entre la protection de l’enfance et le redressement de la natalité, est énoncée sans faux-semblant. Si protection de l’enfance il y a, c’est que la nation est en péril, qu’elle doit faire des enfants et veiller à leur survie » (Sellenet, 2006, p 24). La famille nombreuse est alors valorisée « dans l’intérêt de l’enfant » : par exemple, « Pour Bertillon, seule la famille nombreuse permet de former le caractère, car « la coéducation avec de nombreux frères et sœurs est particulièrement précieuse ». » (Sellenet, 2006, p 25). Et l’auteure, qui parle aussi en fine connaisseuse du champ de la protection de l’enfance d’aujourd’hui, d’ajouter, comme en clin d’œil : « On l’aura compris à partir de ces discours d’archives, « l’intérêt de l’enfant » masque toujours des intérêts moins nobles, mais est-ce si différent aujourd’hui ? » (Sellenet, 2006, p 26). Elle nous fait, pour finir, remarquer que la loi Roussel préfigure la protection maternelle et infantile (PMI) qui existe aujourd’hui.
A cet instant, et avant de passer à la loi suivante, Jean-Pierre Rozencveig demande à apporter une précision, qu’il pense importante : « à partir de 1882, l’arrivée en masse des enfants à l’école publique permet de mesurer la dure condition qui leur est généralement faite. On ne dira jamais assez combien l’école rendue obligatoire est à la base de la protection de l’enfance » (Rozencveig, 1998, p 32). Et, tant qu’il a la parole, il peut aussi répéter, de façon peut-être plus crue, et partant plus claire, ce que vient de nous dire Sellenet : « Les lois sur la protection de l’enfance datent (…) de la fin du XIXe siècle (…). C’est l’époque où la France a besoin d’une jeunesse vigoureuse pour reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Et puis, la deuxième révolution industrielle a déjà ses laissés pour compte. Ligues et œuvres bienfaisantes éclairent le sort des enfants meurtris » (Rosencveig, 1998, p 32).
La loi suivante est celle évoquée par Noiriel : la loi de 1889. Sellenet remarque que, là, « la tonalité est différente. Il est moins question de préoccupation démographique que de prévention du crime et de la marginalité. L’enfant exploité, perverti, maltraité, par ses propres géniteurs est en germe un criminel et un vagabond. ». Elle ajoute, immédiatement : « Le déterminisme est à l’œuvre dans cette anticipation négative du futur, mais pas plus qu’elle ne l’est dans les années 2000 chez ceux qui annoncent que « les enfants maltraités deviendront des parents maltraitants » » (Sellenet, 2006, p 26). Cette loi, qui permet au juge civil de déchoir le père de sa puissance paternelle, « n’est guère sévère pour le père, la mère, le tuteur qui exerce sur son enfant des violences physiques ou le prive de soins. Le magistrat applique simplement les articles 309 et suivants du Code Pénal qui répriment « les blessures et coups volontaires », faits punis au maximum par deux ans d’emprisonnement. » (Sellenet, 2006, p 27). Ceci, sachant que la brutalité physique est, à cette époque, pleinement admise comme mode éducatif, y compris dans les institutions. Même si « certains parents tentent de limiter les atteintes : « La seule chose que je demande c’est que mon fils ne soit pas frappé à la tête. Je sais très bien comprendre que les enfants sont très durs à dresser, le mien n’est pas plus sucré qu’un autre … je vous autorise malgré cela à ne jamais le manquer, lorsqu’il ne marchera pas droit car qui aime bien châtie bien, mais pas de coups à la tête, sur les fesses il n’y a pas d’os » » (Sellenet, 2006, p 28-29). Et à « cette violence ordinaire correspond le savoir des médecins qui notent que « le sang se portant vers la tête, la fustigation décongestionne très efficacement » [ou encore] « les coups calment les nerfs, ou encore régularisent la circulation du sang que la colère entraîne au cerveau (…) » » (Sellenet, 2006, p 28). Bref, la sanction physique, alors nommée comme constituant le droit de correction paternel, est jugée tout à fait légitime, ces châtiments étant utiles au maintien de l’autorité. Ce qui devient illégitime à cette époque, c’est son abus : « Il n’y a « abus de droit » que parce que la punition est trop forte, mais au fond elle reste fondée par la conduite de l’enfant » (Sellenet, 2006, p 30). Dans ces cas, les inculpés sont généralement punis par une amende. « Enfin, avec la dernière catégorie, nous entrons dans le champ du « véritable » délit. Les résumés parlent d’objets contondants, de brutalités inadmissibles, de coups portés sans raison, ou rejettent les raisons évoquées par l’accusé comme constituant un prétexte irrecevable. » (Sellenet, 2006, p 31).
Alors que Sellenet est révoltée par cette manière de voir les corrections, j’observe quant à moi qu’elle est bien plus affinée que celle qui prévaut aujourd’hui, et qui oppose simplement l’existence de coups à leur absence, sans distinguer s’ils relèvent d’une logique de sanction, ou bien d’une logique qui transparaît dans ce que nous dit Sellenet en évoquant « le véritable délit » : une logique de coups « portés sans raisons ». Sans raisons ? C'est-à-dire pour quelles raisons, autres qu’une haine ainsi exprimée, physiquement, envers l’enfant ? Dans le monde de brutes que nous décrit Sellenet, la distinction était encore faite, entre la haine vis-à-vis d’un/e mineur/e, et la sanction d’un acte commis par ce/tte mineur/e. En l’an 2000, la haine d’un parent envers son enfant, exprimée et infligée via des coups et/ou des mots, serait-elle devenue un impensé ?
Seule Hirigoyen avait tenté, à la fin du 20e siècle, d’évoquer cette possibilité à travers son concept de « harcèlement moral », concernant ces « mots qui peuvent tuer » (Hirigoyen, 2001). Ce, dans la famille aussi bien que dans l’entreprise. Mais le personnage diabolique qu’elle nous campait, le « pervers narcissique »[10], est resté cantonné à l’entreprise, dans ce qui a été retenu, juridiquement et socialement, du concept. Exit la haine entre apparenté/e/s, alors revenons à l’Histoire.
La dernière loi marquante de cette époque est celle de 1904, qui harmonise et élargit les précédentes.
Ensuite, il faut arriver en 1945 pour voir « Avec l’ordonnance de 1945, une autre vision de la protection émerge[r]. Il s’agit de protéger le jeune contre ses propres pulsions, ses propres tendances asociales. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a été élaborée à la demande de résistants français qui avaient découvert, en prison, le sort des mineurs délinquants et s’en étaient inquiétés. (…) Le législateur ne fait pas mystère des considérations, plus médico-psychologiques que juridiques, qui orientent son texte. Il s’agit de créer une « juridiction spéciale pour juger les enfants » qui permette de « substituer aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement » » (Sellenet, 2006, p 34). On note l’importance du regard médical et psychologique sur l’enfance, ici. En outre, les enfants délinquants sont conçus là comme étant des « enfants inadaptés ». « Il importe donc d’obtenir leur adaptation. Comment y parvenir ? En les éduquant. Mais, pour les éduquer, il est souvent indispensable de les soigner » (Sellenet, 2006, p 36).
C’est ainsi que la protection de l’enfance comprend, clairement, la protection de l’enfance délinquante, et « L’opinion se divise (…) sur le fait de savoir si l’enfant délinquant est un enfant victime qu’il faut protéger, y compris de lui-même, ou un enfant qu’il faut sanctionner et punir pour protéger la société. » (Sellenet, 2006, p 36). L’ordonnance de 1945 met également en place, en toute logique, la généralisation de la mesure éducative : « les mineurs ne peuvent faire l’objet que de mesures de « protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ou de réforme ». La prééminence de la rééducation est ainsi affirmée. » (Sellenet, 2006, p 35). Enfin, elle crée une panoplie de mesures éducatives, essentiellement « une gamme importante de placements variés et gradués, destinés à répondre à tous les besoins. » (Sellenet, 2006, p 35).
Pour Noiriel, la période historique étudiée s’arrêtait au début du 20e siècle. Pour Sellenet, après l’ordonnance de 1945, il y a les procès d’Outreau et d’Angers, c'est-à-dire les années 2000.
Il nous faut donc donner la parole à Jean-Pierre Rozencveig pour avoir la suite de l’histoire.
Paradoxalement, cette suite est beaucoup moins scandée par les lois, alors même que celui qui la raconte est juge pour enfants : nous revenons à une histoire plus sociétale, que nous avions abandonnée durant les années 1960, aux Etats-Unis, autour de pédiatres et de leurs radios, puis durant les années 1970, sur le même continent, avec Florence Rush.
« Le rapport de la Fondation pour l’Enfance (1979), les premiers travaux de l’AFIREM [association regroupant des travailleurs/euses sociaux/ales autour de l’analyse et de la lutte contre les maltraitances sur enfants] créée par le Dr Strauss, pédiatre hors du commun aujourd’hui disparu et l’histoire du petit David (1983) sorti opportunément du placard où l’enfermait sa mère contrainte de le cacher aux yeux de son beau-père, sont à l’origine d’une remobilisation publique qui a re-légitimé les praticiens de terrain à travers notamment les circulaires de février et mars 1983. Puis, tout naturellement, en 1985, après avoir « osé parler de la violence à enfants », on a pu enfin abattre le tabou de l’inceste et des violences sexuelles à enfants à travers une campagne de sensibilisation lancée par les Affaires Sociales en articulation avec le réseau associatif » (Rozencveig, 1998, p 31).
Mais à cet instant, et avant que je le laisse poursuivre, deux personnes demandent la parole : il s’agit tout d’abord de David Bisson, alias le fameux « enfant du placard », médiatisé lors de sa découverte en 1983, lorsqu’il était parvenu à s’échapper du placard où l’enfermait sa mère. Il voudrait peut-être, pour commencer, nous parler de son beau-père, mal présenté par Rozencveig : « La première année, ma mère avait arrêté son travail pour s’occuper de « ses » enfants ; plutôt de son nouveau bébé [fait avec le beau-père de David]. En ce qui me concerne, déjà, elle ne pouvait s’occuper de moi que dans la colère et les coups. Le beau-père par contre, jouait avec nous. Normalement. Comme un père, quoi ! » (Bisson et Schonen, 2008, p 23). C’est l’époque des punitions disproportionnées par la mère. « A cette époque-là, nous allions encore chez une nourrice. Elle avait des enfants. Entre autres une fille, qui nous connaissait bien puisque nous dormions de temps en temps chez elle. Un soir, je lui racontai ce qui se passait à la maison. (…) Evidemment, ma mère apprit par la nourrice tout ce que j’avais raconté. Et je fus définitivement privé de nourrice. (…) [Et c’est là que des punitions démesurées, sa mère passe à l’enfermement] Voilà. J’étais enfermé seul, sans lumière. Pour combien de temps ? J’avais quatre ans et demi. A partir de ce moment-là, je n’ai plus bougé de la salle de bain. J’étais livré, pieds et poings liés, à ma mère. » (Bisson et Schonen, 2008, p 27). Là, attaché en permanence, il est livré aux séances de torture (brûlure des mains, etc) que lui inflige sa mère selon son bon vouloir, et isolé du reste de la famille et du monde. Le tout, sous l’œil du beau-père et du demi-frère cadet, qui lui allait à l’école, etc. A 9 ans, il est déménagé dans la chambre familiale, et attaché au lit. Là, il effectue une première tentative d’évasion, physiquement périlleuse, et, dehors, « Un monsieur avec son chien m’a vu, a appelé un couple qui se promenait ; tous les trois m’ont emmené au commissariat de Neuilly sur Marne. Là, on m’a demandé mon nom, où j’habitais : je ne savais rien. En tout cas, je n’en ai rien dit. Alors ils m’ont emmené à l’hôpital. » (Bisson et Schonen, 2008, p 64) Il y est gardé un mois, pendant lequel « c’est le paradis » pour lui. Sa mère se pose en unique interlocutrice de l’hôpital, lui apporte des petits soldats, et … il s’avère qu’elle l’a fait soigner là-bas sous un faux nom : celui de son frère. Ils déménagent peu après cet épisode, et c’est dans le nouvel appartement qu’il y a le fameux placard, dans lequel David est illico enfermé. C’est un an plus tard qu’il effectue sa troisième tentative d’évasion, réussie celle-là, et qui le fera connaître sous le nom « d’enfant du placard ».
De tout cela, Jean-Pierre Rozencveig a pu retenir que la mère l’enfermait dans ce placard parce que contrainte de … le cacher aux yeux du beau-père ! Impensable, la mère haineuse envers un de ses enfants ?
Mais une autre personne demande la parole, sur un second point : il s’agit d’Eva Thomas, psychopédagogue en école primaire, qui tient à rappeler qu’en 1985, il n’y a pas eu uniquement une campagne sur l’inceste à l’initiative des Affaires Sociales en lien avec les associations. En 1986, intervient la parution de Le viol du silence, dont elle est l’auteure. Son témoignage est alors médiatisé, ce qui fait d’elle la première victime d’inceste à témoigner à visage découvert devant la télévision, événement médiatique marquant suivant celui de « l’enfant du placard ». 1986 est également l’année de la création de SOS inceste Grenoble, première association du genre, à son initiative. Ces petits oublis et mal compréhensions ainsi rectifiés, nous pouvons reprendre la route tracée par Jean-Pierre Rozencveig …
Elle nous mène en 1989, avec l’adoption de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui induit en France la nécessité d’une nouvelle loi : ce sera la loi du 10 juillet 1989. « Cette loi introduit dans notre droit le concept de maltraitance. On parlait d’enfant en danger ou de coups et blessures à enfant, de mutilations, de négligences à enfants, etc. Il n’y avait pas jusque-là de dispositif spécifique pour l’enfance maltraitée, tenue pour un sous-ensemble de l’enfance en danger.
En 1989 se concrétise le souci d’un effort spécifique et renforcé en faveur des enfants maltraités (…). Des dispositifs doivent être installés pour le recueil et le traitement des signalements afin de garantir une intervention en général, une intervention judiciaire en particulier. Cette loi, pour intéressante par certaines innovations, pose une nouvelle question de frontière entre la protection médico-sociale et administrative, d’un côté, et la protection judiciaire de l’autre, car elle ne définit pas cette « maltraitance à enfants » qui oblige à informer immédiatement la Justice. » (Rozencveig, 1998, p 31).
Ainsi, en France, c’est à la fin du 19e
siècle que l’on pense à « protéger » les enfants des excès de leurs
parents qui pourraient nuire à leur survie, utile à la nation ; et/ou les
inciter à devenir des délinquants ou des agitateurs révolutionnaires plus tard.
C’est au milieu du 20e siècle que l’on s’émeut du sort des enfants
délinquants et que l’on se dit qu’il vaudrait peut-être mieux les éduquer que
les punir. C’est durant les années 1980 que l’on commence à parler des
maltraitances, puis de l’inceste : le mouvement féministe est alors en
pleine institutionnalisation, et non en phase ascendante comme durant les
années 1970. La rencontre n’aura donc pas lieu, contrairement au cas des USA.
Ce, même si Eva Thomas, psychopédagogue et incestée, connaissait à titre
personnel le mouvement féministe via une rencontre, plutôt mitigée, avec les
femmes de « psy et po », dont elle retire néanmoins un « Je
prends ma place dans ce vaste mouvement des femmes qui revendiquent leur
différence et leur droit à exister comme des êtres humains entiers »
(Thomas, 2003, p 186). Mais cette rencontre s’effectue bien avant celle
avec la petite Aline, cette enfant qui la conduira, par ses révélations, à
écrire l’histoire de sa vie d’incestée et à participer à la création d’une
première mobilisation contre l’inceste en France.
Enfin, c’est en 1989 que le mot
« maltraitance » rentre dans la loi française, et tout récemment, en
2009, que le mot « inceste » revient dans le Code Pénal, pour y
désigner les abus sexuels incestueux sur des mineur/e/s d’âge.
La protection de l’enfance en France est la
résultante de tous ces processus : elle constitue donc un domaine vaste,
composé, de surcroît, d’une multitude d’intervenants. Nous allons maintenant
nous attacher à la décrire telle qu’elle se présente aujourd’hui, « vue d’en
haut ».
Depuis les lois de décentralisation de 1983 et 1986, la protection de l’enfance est placée sous l’autorité de l’Etat et également du Président du Conseil Général (départements).
Sous l’autorité de l’Etat se trouvent le numéro vert « allô enfance maltraitée », les services hospitaliers, les services de santé scolaire et les autorités judiciaires.
Le n° vert 119 « allô enfance maltraitée », souvent dénommé « SNATED » ou « SNATEM » dans les documents, est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) créé en décembre 1989. Les personnels y sont recrutés sous statut de droit privé.
En reprenant le vocabulaire des documentations du site internet de ce numéro vert, voilà comment est reçu un appel : lorsqu’une personne contacte le 119, elle est accueillie par un « pré-accueil » qui va l’orienter. Lorsqu’il y a une demande d’aide concernant un enfant, ce « pré-accueil » transfère l’appel aux écoutant/e/s, qui ont pour mission « d’évaluer » la situation et de trouver une solution adaptée.
Si « la situation est grave, l’écoutant propose à l’appelant d’informer le service départemental de protection de l’enfance » (source : site internet du n°119).
Les services hospitaliers comportent depuis 1997, dans le cadre de dispositifs régionaux, des « pôles d’accueil et de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles » (source : site internet du n°119). Depuis l’an 2000, leur compétence a été étendue à l’accueil et à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance de quelque type que ce soit.
Les services de santé scolaire ont, en plus de la surveillance médicale des enfants, un rôle « de prévention des difficultés » (source : site internet du n°119).
Les autorités judiciaires peuvent intervenir immédiatement, ou bien après les services sociaux du département, dans les cas de danger avéré pour l’enfant. « Si la forme que prend cette maltraitance ne met pas la vie d’un enfant en danger et qu’elle fait l’objet d’une demande d’aide et que la famille peut accepter et mettre en place un projet de soins psycho-éducatifs », les mesures proposées par les services sociaux aux parents peuvent suffire. En effet, dans ces cas, « un travail préventif et curatif, peut suffire à rétablir une harmonie familiale satisfaisante » (source : site internet du n°119). Mais si les parents refusent « l’aide » des services sociaux, c’est alors le Juge des enfants qui décide des mesures à prendre, seule voie légale pour qu’elles puissent être imposées aux parents.
D’autre part, « si cette maltraitance est plus grave, elle entre dans le champ du pénal » (même source). Plus exactement, elle entre dans le champ du pénal à partir du moment où les actes commis envers l’enfant sont un délit ou un crime au sens du Code Pénal.
C’est alors un procès au pénal qui aura lieu envers le ou les parents maltraitant/e/s, qui peuvent en ce cas être condamné/e/s à des peines de prison. C’est ensuite au Juge des enfants que reviendra encore la décision de où placer l’enfant, si besoin.
Enfin, un troisième type de Juge peut intervenir, en sus du Juge des enfants et des Juges du pénal : le Juge aux affaires familiales, lorsqu’il y a procédure de divorce en cours, ou terminée, lors de la mise à jour des maltraitances. C’est à lui/elle que revient, en effet, dans ce cas, de décider des modalités de garde de l’enfant par ses parents divorcés, ou encore de confier l’enfant à un tiers. Il peut, pour s’aider dans sa prise de décision, recueillir des renseignements via une enquête sociale (et non pénale) sur la famille concernée.
Par ailleurs, dans certains départements, les plus importants démographiquement, existe une brigade des mineurs, qui a pour missions aussi bien le dépistage des cas de pré-délinquance, la répression du racket, la récupération des mineurs en fugue, que l’action répressive à l’encontre des majeurs qui se sont livrés à des voies de fait sur les mineurs, ou encore la protection contre les sévices ou agressions dont les mineurs peuvent être victimes en milieu familial ou extra-familial. Quand elle existe, c’est elle qui enquête sur toutes les situations de mineur/e/s en danger relevant du Code Pénal.
Ont été transférés au niveau départemental tous les autres services : Protection Maternelle et Infantile (PMI), service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), et service social de secteur.
La PMI vise le suivi des enfants de moins de six ans (entretien au 4e mois de grossesse de la mère, puis visites post-naissance). Elle a parmi l’ensemble de ses attributions un rôle préventif des mauvais traitements, et aussi de prise en charge des enfants maltraités.
Le service social polyvalent de secteur (alias, dans le Rhône, les « maisons du Rhône ») a des missions généralistes, telles la facilitation de l’accès aux droits sociaux, le traitement de l’urgence sociale. Parmi ces missions, est incluse la prévention de la maltraitance.
L’ASE est l’instance départementale dont la mission est la protection de l’enfance.
La protection de l’enfance est définie ainsi :
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance a pour but
de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et
d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une
prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un
ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces
interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt
et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en
charge. » (Guide Pratique 1, Ministère de la Santé et des Solidarités,
2007).
Il s’agit donc principalement de « prévenir des difficultés » en réalisant des interventions : le terme « maltraitance », ou encore de « sévices par les parents » par exemple, n’apparaît pas dans cette définition.
Et en réalité, la protection de l’enfance, ainsi assurée par le département, est donc un domaine très vaste : dans le département du Rhône, sur un total de 10 604 mineur/e/s connu/e/s de la Protection de l’enfance en 2007, 1 192 ont fait l’objet d’un signalement judiciaire (Rhône et Ministère de la Justice, 2008, p 4).
Pour 73 % de ces 1 192 cas, « parmi les principales causes mentionnées [du
signalement judiciaire], apparaissent dans l’ordre décroissant : les carences
éducatives, les conflits parentaux, les troubles du comportement de l’enfant ou
l’absentéisme, les difficultés
socioéconomiques ou encore l’instabilité parentale. » (Rhône,
2008, p 28).
Seuls les
27 %[11] restants,
soit 425 cas, ont pour motif principal une maltraitance, dont la nature est
détaillée ainsi, le graphique suggérant (involontairement ?) une partition
entre différents types de maltraitances, comme si elles ne pouvaient se cumuler
ou s’intriquer pour un/e même mineur/e :
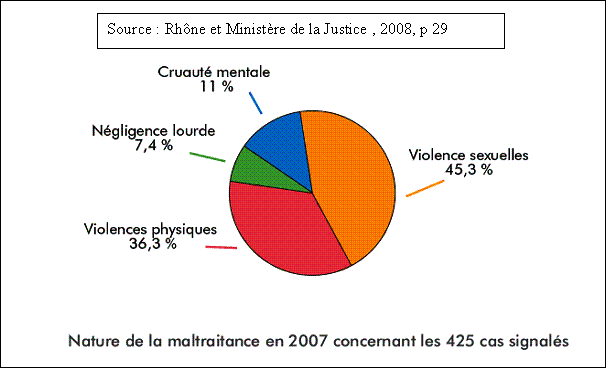
Les maltraitances, et parmi elles les abus sexuels, représentent donc en réalité une part minime de l’activité de la Protection de l’enfance.
En effet, la Protection de l’enfance concerne l’ensemble des familles et enfants ayant fait l’objet d’une « mesure ». Ces mesures peuvent être d’aide financière et à la gestion du budget familial pour assurer des conditions matérielles décentes aux enfants (et à leur famille). Il peut s’agir d’une AED (Action Educative à Domicile) ou encore de différentes formes de placements, en famille d’accueil ou en établissement. Ces mesures peuvent faire suite à un acte de délinquance de l’enfant aussi bien qu’à sa maltraitance. La Protection de l’enfance recouvre donc un vaste conglomérat d’activités de « protection des enfants » contre autrui ou … contre eux-mêmes !
Enfin, si parmi les 10 604 mineur/e/s pris/es en charge par l’ASE au moins une fois en 2007, plus de la moitié sont des garçons (56,4 %), parmi les 425 signalements judiciaires pour maltraitance, la proportion s’inverse de façon significative (61,5 % de filles).
Par ailleurs, la Protection de l’enfance est réformée par la loi du 5 mars 2007, qui « prévoit l’organisation d’une cellule départementale en matière de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être.
[Cette loi] renforce également le rôle du département qui centralise ces informations et doit les traiter avant d’effectuer un signalement judiciaire » (Rhône, 2008, p 2).
Il s’agit d’une
dé-judiciarisation des mesures de protection de l’enfance, le rôle central étant
dorénavant clairement attribué au département via cette cellule de
recueil-traitement-évaluation. D’ailleurs, la loi utilise le terme
d’ « information préoccupante » » (Rhône, 2008, p 2),
réservant désormais le terme « signalement » au seul signalement
judiciaire, alors qu’auparavant, il était distingué « signalement
administratif » (aux services administratifs du département – l’ASE) et
« signalement judiciaire » (au Parquet).
D’autre part, dans cette
loi, la notion de « situation de danger » ou « risque de
l’être » remplace systématiquement les termes de « mauvais
traitements », « maltraité », « maltraitance ». Or, la
notion de danger est bien plus vaste, au vu par exemple du cas de Jean, exclu
de son collège après une période d’absentéisme scolaire :
« en quoi la séparation
des parents a-t-elle mis en danger l’enfant ? Y avait-il d’autres éléments
préoccupants ? (…) L’absentéisme a-t-il été le déclencheur de l’inquiétude
de l’enseignant ? D’autres signes étaient-ils visibles en amont ?
L’exclusion aurait-elle pu être évitée en imaginant un travail avec les équipes
de l’AEP ? » (La lettre de l’ODAS, 2008, p 6).
Ici, le danger est induit
par la séparation des parents, tout simplement car elle conduit l’enfant à des
comportements préjudiciables vis-à-vis de sa scolarité. Très exactement, le
« danger » est défini ainsi :
« - Danger
Lorsque la santé, la
sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé ou les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, alors il est en situation de DANGER (cf. art. 375 du
Code civil). Ce mineur peut subir (violences intra-familiales,
institutionnelles…), comme il peut être acteur (fugues, pré-délinquance,
délinquance). » (Rhône, 2008, p 23).
On voit que les situations
de danger incluent même celles où c’est le/la mineur/e qui est
« acteur », « auteur ». Le flou de la définition,
directement inspirée de l’article n°375 du Code civil, permet en outre une
souplesse d’interprétation importante. C’est ainsi que Jean est en danger car
il a été exclu de son établissement scolaire suite à de l’absentéisme,
souffrant peut-être de la séparation de ses parents, et nullement parce qu’il
aurait été maltraité par ces derniers.
Les définitions des autres
termes importants sont également précisées tant dans les brochures
départementales que nationales :
« - Information
préoccupante
Une information
préoccupante est constituée de tous les éléments, y compris médicaux,
susceptibles de laisser craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger
et puisse avoir besoin d’aide, qu’il s’agisse de faits observés, de propos
entendus, d’inquiétude sur des comportements de mineurs ou d’adultes à l’égard
d’un mineur. (…)
- Signalement
judiciaire
Le signalement
judiciaire est l’ensemble des documents écrits, transmis à l’autorité
judiciaire, afin de porter à sa connaissance des faits graves, des éléments de
danger avérés, compromettant le développement du mineur et sollicitant une
mesure de protection judiciaire.
Ces documents sont
établis après évaluation pluridisciplinaire et si possible inter
institutionnelle, par des travailleurs sociaux ou médico-sociaux après leur
validation par le responsable de l’Aide sociale à l’enfance du Département.
Le signalement
judiciaire fait suite, en général, aux informations préoccupantes après leur
traitement administratif par les services du Département.
En cas d’urgence,
le Procureur peut être saisi. Il en est de même dans le cas d’un fait de nature
pénale. » (Rhône, 2008, p 23).
Suit, bien sûr, la
définition de l’urgence …
« - Urgence
Une situation est
qualifiée d’URGENTE quand un événement imprévu, inhabituel, rapide, dommageable
– ou sa révélation – implique la nécessité d’une protection et d’un éloignement
immédiat du mineur.
L’urgence de la
situation fait référence au degré élevé de mise en danger du mineur, elle
concerne l’action à entreprendre par les professionnels de la Protection de
l’Enfance.
(…)
Rappel :
définitions de l’ODAS [Observatoire national De l’Action Sociale décentralisée]
de la maltraitance (1989)
Si la loi remplace
les termes de « mauvais traitements » et de « protection des enfants maltraités
» par les mots : « protection des mineurs en danger ou qui risquent de l’être
», il convient de s’appuyer sur la définition des différents types de danger
pour un meilleur repérage :
- Violences
physiques : violences exercées sur le corps de l’enfant ayant des
conséquences graves sur sa santé.
- Abus sexuels :
ce sont des agressions impliquant des relations physiques à caractère sexuel
entre l’auteur et le mineur de moins de 15 ans par violence, contrainte, menace
ou surprise. Les abus sexuels incluent toutes les formes d’inceste, la
pédophilie, l’exhibition, l’utilisation des enfants à des fins pornographiques,
la prostitution infantile et le cybernet.
- Cruauté
mentale : elle consiste en l’exposition répétée d’un enfant à des
situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités d’intégration
psychologique : humiliations verbales, menaces verbales répétées, marginalisation,
dévalorisation systématique, exigences excessives ou disproportionnées à l’âge
de l’enfant, consignes et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles
à respecter. »
- Négligence
lourde : elle réside dans le fait de priver un mineur d’aliments ou de
soins, compromettant sa santé. » (Rhône, 2008, p 23-24).
Ces définitions semblent, encore une fois, par leur
caractère général, laisser une large place à l’interprétation par la pratique.
En effet, elles nous disent rarement avec précision ce qu’est le terme
défini : par exemple, le « degré
élevé de mise en danger du mineur » induisant une situation d’urgence, ne
nous renseigne ni sur ce qui est concrètement estimé dangereux, ni sur ce qui
est estimé, en pratique, comme degré élevé de danger. Par ailleurs, dans cette
deuxième définition, les « différents types de dangers » s’avèrent
être synonymes des « différents types de maltraitance », auquel cas
il devient difficile de comprendre comment Jean est un mineur « en danger » !
En outre, elles
emploient souvent un vocabulaire issu de l’univers juridique :
« priver un mineur d’aliments ou de soins » est une
formulation utilisant le vocabulaire du Code Civil, des relations sexuelles
physiques sur un « mineur de moins de 15 ans par violence, contrainte,
menace ou surprise » est un décalque des articles du Code Pénal
concernant les agressions sexuelles dont le viol. Et n’inclue d’ailleurs pas la
notion d’atteinte sexuelle sur mineur/e, créée précisément pour que les
tribunaux n’aient pas à questionner l’existence de « violence, contrainte,
menace ou surprise » de la part d’un parent pour obtenir de l’enfant les
actes sexuels en question.
Enfin, dans cette loi est créé le secret professionnel partagé : « Avant la loi réformant la Protection de l’Enfance, aucun partage n’était possible en droit entre les professionnels soumis au secret professionnel de différents services participant aux missions de Protection de l’Enfance.
Dans les faits, la plupart des départements ont mis en place des dispositifs d’analyse commune des situations, notamment entre les professionnels relevant des services départementaux, associant le plus souvent des professionnels extérieurs. Mais ces pratiques, tolérées par l’autorité judiciaire, étaient à la merci d’actions pénales intentées par les parents pour non respect du secret professionnel. » (Guide Pratique 2, Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007, p 4).
Il s’agit donc, selon ce guide, de mettre en adéquation la loi avec la pratique : « l’objectif du partage est donc de connaître, de la manière la plus exhaustive possible, la situation de l’enfant » (Guide Pratique 2, Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007, p 7) afin de garantir sa protection. Il est alors précisé que « Les informations susceptibles d’être légalement partagées sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires à l’évaluation, à la détermination et à la mise en œuvre d’actions à des fins de protection du mineur » (Guide Pratique 2, Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007, p 7).
Dé-judiciarisation, flou des termes entre
« danger » et « maltraitances », modification du secret
professionnel pour permettre le partage d’informations dans des proportions
raisonnables sont donc les traits majeurs de la réforme de 2007. Mais comment
s’applique-t-elle en pratique, dans le département étudié : le
Rhône ?
Dans le Rhône, la Protection de l’Enfance est donc aujourd’hui organisée ainsi :
- un service central, le pôle « enfance, famille et PMI », lui-même divisé en « santé publique et PMI », « Protection de l’Enfance », « modes d’accueil et adoption », et « IDEF – Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille ».
- Des maisons du Rhône, comportant chacune un secteur enfance.
Depuis la loi du 5 mars 2007, le Rhône a élaboré un « protocole d’accord en matière d’informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en risque de l’être » (Rhône, 2008, p 2), daté du 29 mai 2008. Ce protocole est décrit dans le « guide à l’usage des professionnels ». Dans l’éditorial, il est souhaité « que ce guide participe à un rapprochement des cultures professionnelles, conforte la confiance réciproque par une meilleure connaissance de la place de chacun » (Rhône, 2008, p 2), indiquant ainsi implicitement la diversité des acteurs en jeu et les difficultés possibles entre eux[12].
Une part importante du guide est pour cela consacrée à définir « le rôle de chacun », via des fiches par professions des auteurs du signalement. Y sont cités les travailleurs/euses sociaux, les enseignant/e/s, les médecins, les autres professionnel/le/s de santé, les cadres et personnels administratifs, les magistrat/e/s, les services d’enquête (police, gendarmerie), les avocat/e/s, les bénévoles et volontaires associatifs, les élu/e/s, les citoyen/ne/s[13]. C’est entre tous ces univers que « le protocole vise à poser les circuits de circulation des informations mais également à systématiser et à fiabiliser les procédures » (Rhône, 2008, p 6).
C’est donc en termes de procédures, de circuits d’informations, en situant précisément la place de chacun/e que pourraient se construire un rapprochement et une meilleure confiance entre les différents acteurs impliqués.
la cellule départementale de
recueil-traitement-évaluation des informations préoccupantes est quant à elle
composée de deux niveaux :
-
un niveau
stratégique inter-partenarial chargé de suivre le dispositif, de proposer des
évolutions, de faire les statistiques départementales
-
un niveau
opérationnel interne au Département, chargé du recueil-traitement-évaluation
des informations préoccupantes (ex-signalements administratifs).
Ce niveau
opérationnel est lui-même composé :
-
des 140 Maisons
du Rhône réparties dans tout le département, qui recueillent et traitent les
informations préoccupantes
-
d’une
Coordination des informations préoccupantes et des signalements, au sein du
service Protection de l’Enfance, auquel il est également possible de s’adresser
directement. Ce bureau exerce une fonction d’appui et de conseil technique aux
Maisons Du Rhône.
Le circuit d’une information préoccupante doit être le suivant :
-
lorsqu’elle
provient des partenaires signataires du protocole d’accord en matière
d’informations préoccupantes pour les enfants en danger ou en risque de danger,
le/la professionnel/le concerné/e doit transmettre l’information préoccupante
par l’intermédiaire d’une fiche de recueil d’une information préoccupante à
la Maison du Rhône concernée. Ou bien directement au Service Protection de
l’Enfance lorsque l’identification de la Maison du Rhône n’est pas possible.
-
lorsqu’elle
provient d’autres sources (secteur socioculturel, particulier …), c’est la
Maison du Rhône qui est l’interlocuteur, et c’est elle qui remplira et
transmettra la fiche de recueil d’une information préoccupante aux responsables
Aide Sociale à l’Enfance du département en vue de son traitement.
-
Si elle
provient du n°119, ce service national adresse une fiche de liaison spécifique
au service départemental, qui la transmettra ensuite à la Maison du Rhône
concernée.

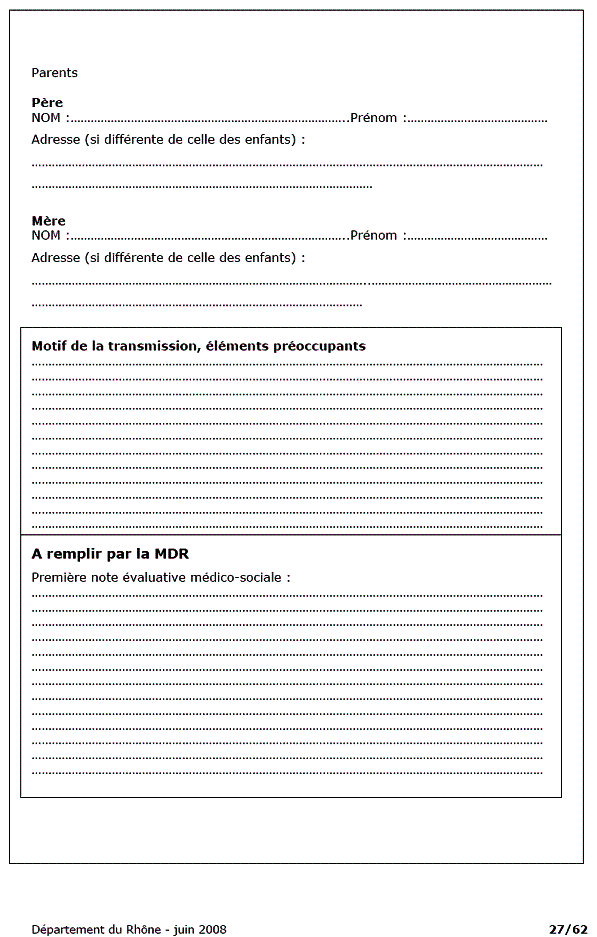
Une copie de cette fiche est conservée, anonymisée, pour alimenter les statistiques départementales telles que les organise la loi du 5 mars 2007. La fiche, quant à elle, va servir pour mettre en œuvre une procédure d’évaluation de la situation de l’enfant.
Cette évaluation « s’élabore à partir de l’échange qui aura lieu entre les parents, le mineur concerné et les professionnels amenés à intervenir » (Rhône, 2008, p 33). Elle « porte sur les points suivants :
- les besoins essentiels au développement de l’enfant (physique, affectif, intellectuel, social), à la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son autonomie
- l’état des relations entre l’enfant et chacun de ses parents
- le potentiel de ces derniers à se mobiliser
- le contexte familial et environnemental influant sur sa situation et son développement » (Rhône, 2008, p 33).
Elle est effectuée par des professionnel/le/s missionné/e/s par la Maison du Rhône, dans les 24h si la situation est estimée urgente, dans les 8 jours sinon. Ces professionnel/le/s vont ensuite contribuer chacun/e selon leur spécialisation à remplir un des quatre volets du rapport d’évaluation : administratif, social, budgétaire et santé.
Ce rapport d’évaluation sera
présenté devant la « commission enfance » de l’ASE, qui réunit le
responsable de l’ASE, le responsable santé, les professionnel/le/s ayant
contribué à l’évaluation et éventuellement d’autres professionnel/le/s
concerné/e/s, ainsi que les familles (dont éventuellement l’enfant concerné).
C’est cette commission qui décide des suites administratives à donner, en
établissant un « projet pour l’enfant » qui devra être co-signé par
les parents et le responsable ASE.
Voilà comment le travail des services départementaux de la Protection de l’Enfance est descriptible à partir des différents guides pratiques édités : avant tout comme un ensemble de circuits de traitement définis par des procédures claires, et où chacun se doit de rester à sa place, bien définie, dans l’intérêt du bon déroulement de ces procédures.
Mais cela pourrait faire oublier que « Le réel [du travail] est (…) ce qui résiste aux connaissances, aux savoirs, aux savoirs-faire, et de façon plus générale à la maîtrise. (…) [Ce réel] se fait essentiellement connaître au sujet par le décalage irréductible entre l’organisation prescrite du travail [ici, celle des guides et du protocole] et l’organisation réelle du travail. En effet, quelles que soient les qualités de l’organisation du travail et de la conception, il est impossible, dans les situations ordinaires de travail, d’atteindre les objectifs de la tâche si l’on respecte scrupuleusement les prescriptions les consignes et les procédures … Si l’on s’en tenait à une stricte exécution, on se trouverait dans la situation bien connue de la « grève du zèle ». » (Christophe Dejours, 2000, pp 32-33). Ainsi, ce vaste ensemble de guides ne nous donne pas accès à ce que font, dans le réel, les personnes employées dans ces services départementaux, ou les autres professionnel/le/s évoqué/e/s, mais, plus probablement, à la vision organisatrice des décideurs/euses et dirigeant/e/s qui ont élaboré ces – longs et nombreux - textes informatifs.
Quant aux agressions sexuelles, elles sont évoquées de manière spécifique dans le guide pratique du Rhône : « Evaluation d’une information préoccupante liée à un fait à caractère sexuel : si le fait constitue un crime ou un délit (notamment les agressions sexuelles, les violences sur mineurs), vous avez l’obligation d’en aviser le Parquet en appelant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie » (Rhône, 2008, p 37).
Tant numériquement par les statistiques, que pour leur traitement par les services du département, elles apparaissent donc dans ces écrits comme l’exception, d’une gravité particulière, à considérer à part (crime ou délit relevant du pénal).
Ainsi, l’enfance maltraitée est une petite part des activités de la Protection de l’Enfance, et l’enfance sexuellement maltraitée constitue une part infime de ces activités.
Finalement, les seuls « spécialistes » de l’enfance maltraitée, hormis le n° vert 119, ne seraient-ils pas alors les associations telles « enfance et partage », « la voix de l’enfant », « l’enfant bleu », « enfance majuscule », etc ?
Il s’avère que le premier numéro vert national de recueil de signalements de mineurs victimes de maltraitances a été créé en 1988, soit un an avant le n°119, par l’association enfance et partage (source : documentation de présentation d’enfance et partage). Ceci montre un important rôle des associations, en France, dans les évolutions des dispositifs de Protection de l’Enfance.
Pour donner un aperçu de ce que sont ces associations, je vais développer tout d’abord l’exemple d’enfance et partage, leur historique étant facilement disponible via internet[14], puis l’exemple d’une association de défense des droits de l’enfant (anonymisée) telle qu’elle m’a été présentée par un de ses bénévoles lors d’un entretien, non enregistré, avec prises de notes.
Enfance et partage a été créée en 1977, par des membres du personnel naviguant d’Air France, touché/e/s par la situation des enfants aperçus dans des pays étrangers où ils/elles avaient à séjourner de par leur profession (source : site internet d’enfance et partage). Au départ, enfance et partage n’est donc pas du tout une association de lutte contre la maltraitance des enfants par des apparenté/e/s en France, mais une association humanitaire de réaction aux effets de la pauvreté sur les enfants « d’ailleurs ».
Mais en 1983, l’association s’étant constituée partie civile dans un procès de violences sur mineur en France, elle commence, dans la foulée, à y développer des interventions juridiques. Ce tant et si bien qu’aujourd’hui, elle n’apparaît plus, aux yeux du grand public, comme association humanitaire s’occupant d’enfants pauvres en pays étrangers, mais comme association spécialiste de l’enfance maltraitée en France. Ce, via ses interventions juridiques (« constitution de partie civile », avocat/e/s, etc), son numéro vert national, ou encore son service d’accompagnement et de suivi psychologique des enfants victimes et de leurs familles, ouvert à Paris en l’an 2000.
Il me semble important de noter le caractère non programmé, tant de la création que de l’évolution de l’objet principal de l’association. Ce n’est pas un programme qui conduit les agents d’Air France à vouloir aider des enfants de pays du « tiers monde », mais les émotions suscitées en eux par la rencontre avec ces enfants à l’occasion de leur travail d’agents de ligne. Et ce n’est pas non plus un programme qui les conduit à agir ensuite pour soutenir les enfants français victimes de maltraitance, conduisant à un changement de l’objet central de l’association, mais le fait d’en avoir rencontré durant les années 1980 et d’avoir alors été sensibilisé/e/s à cette problématique. Cette façon de se mobiliser est très différente de la démarche, précédemment décrite, des services départementaux, basée, elle, sur la rationalité des procédures et la clarté des places de chacun/e, rationalité où ne transparaissent nullement les émotions des rédacteurs face aux situations violentes dont il est question, mais avant tout une volonté classificatoire et de bon ordonnancement.
Finalement, via l’exemple de cette association, nous retrouvons quasiment l’ensemble du domaine couvert par la « Protection de l’Enfance » de l’Etat et déléguée aux départements : protection de l’enfant victime de mauvais traitements par sa famille, protection de l’enfant victime des conditions sociales (pauvreté, voire misère). A l’exception de l’action vis-à-vis de l’enfant qui est « en danger » car auteur lui-même d’actes de délinquance. Une autre différence est aussi que l’enfant miséreux est aidé avant tout à l’étranger (« tiers monde ») par ces associations, et non en France.
Quant à l’association qui m’est présentée par l’un de ses bénévoles, si dans son prospectus de présentation, elle s’intitule « association pour la protection et la défense des droits de l’enfant », mon interlocuteur m’y explique quant à lui d’emblée que c’est une association « dont le but est la défense de l’enfance maltraitée », dont des adolescents et de jeunes adultes qui tentent d’agir après leur majorité par rapport à des maltraitances sexuelles qu’ils/elles ont pu subir. Nous passons donc des « droits de l’enfant » de la documentation, à la « lutte contre la maltraitance » décrite par le bénévole, ce qui semble beaucoup plus restreint, comme champ d’intervention, à moins de réduire les droits des enfants au … droit de ne pas subir de mauvais traitements ?
Concernant l’enfance maltraitée, le bénévole affirme que 70 % des dossiers traités par son association sont des cas de maltraitances sexuelles, proportion qui diffère radicalement de celle trouvée pour les services de l’ASE, et qui montre le degré de spécialisation de ces associations[15]. Il différencie ensuite deux sources de signalements :
- ceux venant des familles elles-mêmes, qui bien souvent ne savent alors pas très bien ce qu’il faut faire : la section locale de l’association les oriente (c'est-à-dire les incite fortement à porter plainte, me précise-t-il de suite), monte un dossier si possible.
- ceux venant de tiers qui n’ont rien à voir avec la famille (et signalent de manière anonyme ou en disant qui ils/elles sont) : dans ce cas-là, l’association transmet le dossier au Conseil Général pour enquête sociale, car en tant qu’association, ils n’ont eux ni les moyens ni le droit de mener une telle enquête. Ces dossiers débouchent, me précise-t-il, sur une action en milieu ouvert (c'est-à-dire sans placer l’enfant hors de sa famille) ou bien une transmission au Procureur (par le Conseil Général).
Lorsque « la famille » est l’auteur du signalement, le rôle de l’association est ensuite, concrètement, de l’orienter vers un/e des avocat/e/s avec qui elle est en lien régulier. S’il existe des chances que le dossier aboutisse en Justice, l’avocat/e prend la suite auprès de la famille, tout en tenant l’association informée de cette suite. Le bénévole me précise alors qu’il peut y avoir problème si l’adulte auteur « tient bon », c'est-à-dire n’avoue pas.
Par ailleurs, il m’explique que souvent, les familles ne connaissent pas les processus juridiques et ne comprennent donc pas que pour rouvrir « un dossier », c'est-à-dire une plainte, classé sans suite, il faut de nouveaux éléments : dans ces cas, au pire, les bénévoles envoient ces familles voir l’avocat qui, lui/elle, « bénéficie d’une certaine aura » pour leur faire comprendre cela. Le bénévole emploie de manière récurrente le mot « dossier », et me précise que le rôle des bénévoles, en plus d’être surtout un rôle d’écoute (et d’incitation à porter plainte), est principalement de préparer les dossiers avec les familles.
Si la famille manque de moyens, l’association peut fournir une aide financière pour les frais du procès, ainsi que pour le suivi psychologique de l’enfant auprès d’un/e des psychologues qui travaille en lien avec l’association. Ces suivis durent un nombre de séances fixé au départ par le/la psychologue sur la base d’une évaluation de l’ampleur du traumatisme psychique de l’enfant. Il s’agit de suivis qui durent entre 5 et 10 séances.
Quant au financement de l’association, en lui-même, il constitue un pan entier de l’activité des bénévoles, puisque les subventions constituent moins de 5 % des recettes de l’association en 2006 (source du chiffre : documentation fournie par le bénévole). Ainsi, mon interlocuteur évoque la confection de paquets cadeaux à Noël dans un magasin, le travail avec plusieurs associations qui organisent des lotos et partagent avec eux les bénéfices … Mais ce qui rapporte le plus, c’est le partenariat avec des entreprises, qui dure un an ou deux et peut concerner uniquement certaines affectations souhaitées par l’entreprise (exemple : « nous vous donnons tant, nous voulons uniquement que cela serve pour financer une publicité de votre association par voie d’affiches »).
Enfin, un autre axe est la prévention, via des actions de sensibilisation dans les écoles. Cet axe est développé dans certaines sections locales, pas dans toutes, car il exige une stabilité de l’investissement des bénévoles concerné/e/s, du fait qu’il faut les former spécialement pour cela. Or, des bénévoles qui étaient en recherche d’emploi peuvent retrouver un emploi et ne plus pouvoir s’investir, par exemple. Les abandons du bénévolat parce que les situations rencontrées seraient « trop dures » émotionnellement ne sont pas, en revanche, un facteur d’instabilité : de mémoire, mon interlocuteur cite un seul cas d’un tel abandon. Il commente, en outre, qu’il est nécessaire de « se blinder », c'est-à-dire de traiter les affaires avec beaucoup de détachement.
Pour ce qui est de la prévention, il la perçoit comme une activité de sensibilité plus féminine, de fait plus portée par des femmes. Il pense que c’est un aspect important, parce qu’il vaut mieux traiter le mal au début, en sensibilisant les enfants sur ce qu’ils ont le droit de ne pas laisser faire aux adultes, et il n’est pas rare, précise-t-il, qu’à la fin des enfants viennent voir les intervenant/e/s pour leur révéler des maltraitances subies.
Finalement, cette association a donc pour principal interlocuteur « la famille » qui protège son enfant contre un de ses membres. Il m’est précisé que ce ne sont jamais les enfants qui sont interlocuteurs/trices directs[16]. Lorsque je demande ce qu’est, concrètement, « la famille » dans ces cas-là, il m’est répondu : « souvent, c’est la mère, parfois, c’est le père, mais plus pour des maltraitances physiques ou des négligences de la mère (notamment dans le cas de séparations des parents) ».
L’association peut donc s’occuper des enfants dont un des responsables légaux (la mère ou le père) réagit en venant les consulter pour des actes de maltraitance commis par l’autre détenteur/trice de l’autorité parentale (le père ou la mère). Lorsque aucun/e des deux détenteurs de l’autorité parentale ne réagit contre une maltraitance subie par son enfant, que ce soit l’autre responsable légal/e l’auteur/e, ou non, il n’y a que l’Etat (service départemental d’ASE, ou encore instance judiciaire) qui est habilité à donner suite au signalement donné par un tiers, selon les procédures explicitées plus haut.
Ceci induit que le secteur associatif est confronté à des cas où intervient, tout à fait logiquement, un divorce entre le « parent protecteur » et le parent auteur des maltraitances, soit suite à la révélation des faits par l’enfant, soit, inversement, que ce soit la situation de divorce elle-même qui ait conduit l’enfant à révéler les maltraitances qu’il a subies de la part de l’autre parent.
A cet égard, mon interlocuteur précise que dans son association, ils/elles sont méfiants sur les questions de divorce, relativement à la garde des enfants. Il me fait état d’un « mouvement », il y a six ou sept ans, de femmes qui portaient plainte contre les pères pour abus sexuels sur des enfants, lors de divorces. Mais depuis, ajoute-t-il, les gens ont compris qu’il ne fallait pas mélanger les deux, car dans ce cas, les juges ne les croient pas.
A ce moment de la description, Vivienne Wee, nous propose, dans son article « Children, Population Policy, and the State in Singapore », de considérer le triangle relationnel suivant (Wee, 1995, p 185) :
Etat
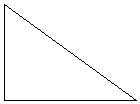
Parents Enfant
Ceci, en précisant que « Nos discours sur les enfants, sur la valeur des enfants, sur leurs droits, etc, rendent de manière faussée le contexte de la société étatisée dans laquelle nous vivons. « Parents » et « enfants » émergent comme catégories marquées à travers leur transformation de relations dyadiques en relations médiatisées, surveillées et in fine contrôlées par une tierce partie, l'Etat.[17] » (Wee, 1995, p 189).
L’originalité de l’approche de Wee est ainsi de sortir du cadre « naturel » de la relation parents/enfants, en soulignant les différences entre sociétés non étatisées, où la vulnérabilité spécifique des enfants est subsumée sous celle de l’humanité en général, et les sociétés à Etats, où comme il vient de nous l’expliquer, les « enfants » apparaissent comme une catégorie marquée, à part. Plus précisément, « Les sociétés politiquement non centralisées, non hiérarchiques, sans Etats, ont leur propre interprétation culturelle de la vulnérabilité biosociale des enfants. Ces populations tribales tendent à subsumer la vulnérabilité enfantine sous la vulnérabilité humaine en général. Par conséquent, les enfants sont traités violemment dans celles des sociétés tribales où les relations interpersonnelles sont violentes, comme les Yanomamös (voir Chagnon, 1983), ou de façon pacifique dans celles où les relations interpersonnelles sont non-violentes, comme les Semais (voir Dentan, 1978). Je voudrais défendre l’idée que dans de telles sociétés, les enfants ne sont pas traités comme une catégorie marquée d’êtres, distincte des autres humains, et avec qui des relations spéciales devraient donc être entretenues » (Wee, 1995, p 189)[18].
Ainsi, dans cette société pourvue d’Etat qu’est la société française, alors que communément, nous pensons à l’opposition, soit-disant toute naturelle, « adultes » / « enfants », nous retrouvons en réalité ce triangle relationnel : Etat, parents, enfants.
Les associations de défense des enfants ne nous en font pas sortir, puisqu’elles peuvent agir uniquement comme soutien à un élément de l’une des pointes ayant pouvoir sur l’enfant (« la famille », « le parent protecteur »), ou comme relais vers l’autre pointe ayant pouvoir sur l’enfant et la famille (l’Etat et ses services départementaux de Protection de l’Enfance), le tout pour défendre l’enfant. Elles ne constituent donc pas une pointe supplémentaire au polygone ici exposé, mais un appui aux pointes existantes.
Enfin, hors de la Protection de l’Enfance à proprement parler, s’ajoutent encore d’autres acteurs, concernant l’inceste : les différentes associations de lutte contre les violences faites aux femmes, ou identifiées comme s’intéressant à ces questions, ainsi que les associations s’adressant aux anciennes victimes d’inceste devenues adultes. Dans ce dernier réseau associatif se retrouvent des « spécialistes » du sujet souvent citées : à Lyon, pour prendre cet exemple, le nom de Liliane Daligand, présidente de l’association VIFF-SOS femmes (d’action contre les violences faites aux femmes) et médecin légiste, auteure de nombreux écrits sur l’inceste et ses victimes, ou encore celui d’Isabelle Bouclon, animatrice d’une « permanence jeunes » dans la même association. Dans le champ judiciaire, un autre nom peut être ajouté, également pour Lyon : celui de Marie-Pierre Porchy, juge et auteure d’un ouvrage sur l’inceste et la loi.
Ainsi, différent/e/s professionnel/le/s écrivent et réfléchissent sur le sujet, et sont reconnu/e/s légitimes comme théoricien/ne/s sur ce thème, au moins par le réseau de professionnel/le/s et associations contre l’inceste dont ils/elles constituent en outre des nœuds. Hormis ces quelques « têtes » théoriciennes, présentes dans plusieurs villes en France, en réalité, il n’est pas excessif de dire qu’il n’existe pas de spécialistes de l’inceste : les associations de défense des enfants maltraités fonctionnent localement plutôt comme des associations d’aide aux victimes, juridique et psychologique[19]. Et non pas forcément comme des « spécialistes » ayant une connaissance approfondie des mécanismes de la maltraitance, notamment incestueuse. Cette connaissance apparaît sortir difficilement des livres pourtant bel et bien écrits sur le sujet.
Cette mosaïque d’organismes intervenants : divers services de l’Etat, du département, et tissu associatif important, a une histoire. En effet, si aujourd’hui la majorité des assistant/e/s sociaux/ales, par exemple, « travaille dans les collectivités territoriales et est confrontée aux effets de la décentralisation, de l’introduction des méthodes gestionnaires et de la subordination plus nette aux élus » (Serre, 2009, p 9), il n’en a pas toujours été ainsi.
Au début du 20e siècle[20], leurs « ancêtres » sont des femmes, issues de la bourgeoisie, qui aident bénévolement les familles populaires. Elles les accueillent dans des résidences sociales ou leur rendent visite dans le cadre de la lutte hygiéniste contre la tuberculose. Le plus souvent, elles sont célibataires et catholiques : ce sont des « religieuses laïques », qui exercent via des associations philanthropiques parfois soutenues par des politiques municipales. Des écoles de service social assurent leur formation, et un diplôme est créé durant les années 1930.
C’est seulement suite à la seconde guerre mondiale que ce métier d’assistante sociale s’institutionnalise et se développe, parallèlement à la mise en place de la sécurité sociale et au développement des politiques de prévention. La multiplication des services sociaux, nouvelle, dans les administrations, entreprises, communes, va alors entraîner une croissance exponentielle des effectifs.
Durant les années 1970, cette profession, qui n’est plus désormais du domaine du bénévolat, mais constitue un métier féminin, marqué par « une idéologie vocationnelle » (Serre, 2009, p 9), se démocratise avec l’arrivée de femmes issues des classes moyennes. Et c’est dans les années 1980, avec la remise en question de l’Etat qui s’étend et se transforme - d’une critique de son trop grand pouvoir à une critique de son efficacité jugée trop faible - que nous aboutissons à l’importance actuelle des services sociaux départementaux. Notamment en matière de Protection de l’Enfance, puisque le budget « Protection de l’Enfance » est une part importante des budgets départementaux : « 40 à 60 % du budget départemental, sachant que l’ensemble des budgets départementaux a enflé, passant des 43,4 en 1984 [soit peu après la départementalisation de l’action sociale] à 63 milliards de francs en 1993 » (Rosencveig, 1998, p 22), nous précise Jean-Pierre Rosencveig, sans qu’il soit bien clair, à la lecture, de s’il s’agit du budget de la Protection de l’Enfance ou bien de celui de l’ensemble de l’action sociale. Retenons, en tout cas, l’idée ici exprimée de l’importance, en termes de coûts, de ce poste budgétaire pour les départements. Ceci à côté d’un important tissu associatif qui s’est maintenu et développé : si les bénévoles associatifs/ives me précisent bien « nous ne sommes pas des professionnel/le/s », et ne sont plus forcément des femmes bourgeoises catholiques, leur rôle concret d’aide, leur parcours souvent multi-associations et leurs motivations (« être utile ») participent bien de cette sphère qui était intégralement couverte par les associations philanthropiques au début du 20e siècle.
Cette mosaïque d’acteurs concernant la Protection de l’Enfance pose immédiatement la question de la méthodologie à adopter : qui aller voir ? Et comment ?
Fin 2008, ayant un cours hebdomadaire en commun avec les étudiant/e/s du master 2 professionnel d’anthropologie, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de discussions avec certaines d’entre eux/elles, à partir du moment où mon sujet de travail a été énoncé durant un « tour de table » de présentation des sujets de chacun/e durant ce cours.
Les étudiantes en question étaient toutes des professionnelles en reprise d’étude comme moi. Leurs professions étaient variées : sage-femme, éducatrice, travailleuse en maison de retraite … Mais toutes m’ont relaté : « les femmes enceintes confient des choses comme ça aux sages femmes à ces occasions, j’ai eu un certain nombre de cas, si tu veux … », « j’ai eu un cas, je pourrais éventuellement te faire un entretien pour ton mémoire », « tu devrais aller voir du côté des notaires et des maisons de retraite, car à l’approche de la mort et autour des héritages, ben parfois, ça ressort ». Etc !
Qui aller voir, et comment ? Mais mon terrain était bien sûr là, juste à côté !
Pour ma part, je n’ai pas manqué de leur demander comment elles pensaient qu’il serait le mieux que je procède pour accéder à un accord de leurs institutions pour des entretiens en leur sein. Une majorité m’a alors évoqué avant tout la difficulté du secret professionnel pour obtenir des entretiens dans ces secteurs … avant de se proposer de m’en offrir un « en personne », ou à l’inverse de me préciser de suite « savoir trop bien ce qu’est un anthropologue » pour accepter cela (sic). Dans tous les cas, aucune piste pour entrer dans leurs obscures institutions … J’étais en effet gênée par l’idée d’avoir jusqu’à la moitié de mes entretiens dans ma propre faculté : comment les anonymiser ensuite, par exemple ?
Ces discussions m’ont cependant fait conclure que les révélations d’abus sexuels incestueux étaient un phénomène diffus, auquel pas mal d’intervenant/e/s ont affaire dans le cadre de leur profession, mais pas forcément très souvent. En outre, les révélations se font à tous les stades de la vie des incesté/e/s (accouchement, mort prochaine …), et concernent un éventail d’interlocuteurs/trices possibles qui s’avère donc bien plus vaste encore professionnellement que ce que j’imaginais.
Pour moi, il était dès lors évident :
- que la monographie d’un lieu était inappropriée, parce qu’elle ne me permettrait pas de croiser les représentations de personnes appartenant à des univers différents, mais susceptibles de recevoir des révélations d’incesté/e/s dans le cadre de leur profession.
- qu’il fallait que je délimite le champ des professions : j’ai choisi de m’intéresser aux professionnel/le/s en relation avec des mineur/e/s d’âge.
- qu’interroger les quelques « spécialistes » reconnu/e/s de l’inceste ne m’apporterait pas forcément d’information sur les pratiques réelles des professionnel/le/s de l’enfance ou du psychisme « non spécialistes » lorsqu’ils/elles sont confronté/e/s à une révélation d’abus sexuel incestueux.
En fait, la monographie d’un lieu aurait probablement été tout simplement impossible, à moins, précisément, de m’orienter vers un mémoire sur un lieu spécialisé, comme par exemple la maison Jean Bru d’Agen, unique foyer en France spécialisé pour accueillir des jeunes filles placées là après avoir été victimes d’inceste. De fait, cela aurait été un mémoire tout à fait différent.
Restait l’éventualité de m’intéresser à une profession bien ciblée. C’était un choix possible. Ce n’est pas celui que j’ai fait, à la fois pour des raisons personnelles et d’intérêt de recherche. Mes raisons personnelles étaient que j’avais eu moi-même affaire à beaucoup de professionnel/le/s différent/e/s, durant ma minorité[21], et je voulais comprendre comment il était possible qu’aucun/e n’ait eu l’ombre de l’idée que « peut-être » je subissais ces mauvais traitements là, c'est-à-dire l’idée que « un enfant » si bizarre, puis si conforme que moi pouvait l’être notamment parce que subissant des actes incestueux. Mes raisons d’intérêt de recherche sont que diversifier au maximum les professions permettrait d’apporter une vision transversale. Vision, précisément, impossible à avoir pour un/e professionnel/le de ces secteurs, fixé/e à un lieu de travail et une profession précise : c’est aussi là un apport possible de la recherche depuis un point de vue extérieur à ces univers.
Diversifier au maximum les professions, les lieux, m’a néanmoins conduit à des choix en partie arbitraires, en plus de celui des professions en rapport avec les mineur/e/s, afin de rester dans un travail d’une taille raisonnable pour un master 2 : je n’ai par exemple prospecté ni les personnels médicaux, ni les associations d’écoute du type « sos amitié » ou « sos suicide phénix », qui sont susceptibles également de recevoir des révélations d’abus sexuels incestueux de la part de personnes mineures ou jeunes. Cela aurait pourtant pu être également très intéressant puisque, comme le relate l’ouvrage de Claude Couderc, Mourir à 10 ans : « Isabelle, confrontée brutalement à un comportement de séduction très trouble de son père ; Laure, violée par son propre frère aîné ; et bien entendu Thierry, subissant les sévices sexuels de deux co-détenus avec qui il partage sa cellule en prison. Combien de fois, après une tentative de suicide d’une adolescente, sommes-nous amené à entendre de la part du suicidant la relation de tels faits ! » (Couderc, 2003, p 205).
J’ai finalement privilégié les acteurs obligatoirement impliqués dans le processus de signalement ou de mise au jour d’abus incestueux : les services sociaux départementaux ; ainsi que ceux qui me semblaient avoir le plus de chance de l’être en-dehors des parents : l’école, les professionnel/le/s du psychisme, les associations ayant pour objet l’aide aux enfants maltraités. Enfin, en pratique, j’ai accepté volontiers les opportunités, trop rares, qui se sont présentées à moi, hors du master 2 professionnel d’anthropologie : par exemple, les deux entretiens effectués avec des travailleuses d’un planning familial n’étaient pas dans mes projets au départ.
Par ailleurs, le choix entre entretien et observation s’est fait par défaut : les statistiques du département du Rhône recensaient 193 cas de violences sexuelles par un parent, soit entre 5 et 6 cas par maison du Rhône en moyenne en 2007. Autant dire qu’il aurait fallu beaucoup de patience, pour pouvoir observer un tel signalement. Par ailleurs, l’association de défense des enfants à laquelle j’ai eu accès est petite et n’a pas un nombre important d’appels et de dossiers : il est possible d’y rester trois semaines sans nouvel appel, m’a-t-on informée. Enfin, dans l’éducation nationale, qu’observer ? Et auprès des professionnel/le/s du psychisme, qu’aurait voulu dire observer ? A supposer qu’on m’y autorise, je me serais sentie en position de voyeurisme. Pourtant, observer aurait pu être parfois intéressant pour pouvoir accéder à ce qui est fait, et non pas uniquement à ce qui m’était dit sur ce qui est fait, ces dires étant déjà filtrés par la pensée et la mémoire de mes interlocuteurs/trices, alors que mes observations l’auraient été par mes grilles de pensée et ma mémoire à moi.
Etant et me sentant totalement extérieure à ces univers professionnels, à la fois il était difficile d’observer des révélations en train de se faire, des signalements en cours, comme l’avait fait Delphine Serre par exemple, et à la fois, je n’ai pas osé demander ces possibilités auprès des services et personnels concernés. Je me suis de facto limitée aux entretiens, qui me permettaient de remonter dans le temps sur la durée de toute la carrière, et des différents lieux de travail, de mes interlocuteurs/trices, qui pour la plupart avaient personnellement rencontré un, deux ou trois, pas plus, cas d’inceste au total, sur leurs différents lieux de travail cumulés. Et obtenir des entretiens sur ce sujet s’est, déjà, avoué suffisamment difficile … probablement, j’ai bien fait de ne pas me montrer plus ambitieuse dans mes demandes dans des univers, souvent tenus au « secret professionnel », auxquels j’étais extérieure.
En outre, pour une partie de mes interlocuteurs/trices, les entretiens avec magnétophone étaient une pratique déjà familière, puisqu’ils/elles avaient eux-mêmes du la pratiquer lors de la réalisation de leur mémoire professionnel de travailleur/euse social/e. Cette pratique là n’a donc pas posé problème dans ces cas. Et je garde l’éventualité d’inclusion de l’observation dans ma méthodologie pour des lieux où se concentrent beaucoup plus les cas d’abus incestueux : procès accessibles au public, police spécialisée, tous lieux qui ne faisaient pas partie de mon champ cette année.
Lors de mes entretiens avec des adultes anciennes victimes d’inceste, effectués pour mon mémoire de master 1, j’avais choisi de me présenter en tant qu’étudiante en anthropologie et ayant été moi aussi victime d’inceste, en utilisant par exemple un forum internet où j’étais connue comme ancienne victime depuis plusieurs années. Cette information avait permis de mettre plus à l’aise mes interlocutrices, j’ai ainsi reçu des « seule une victime peut comprendre une victime », des « pfiou … le magnétophone … il va falloir que je m’y fasse, mais tu es victime aussi, donc ça va être plus facile », ou encore entendu, au téléphone, des bégaiements se transformer, d’un coup, en une voix normale et assurée, lorsque j’ai fait apparaître à mon interlocutrice que moi aussi, j’avais été victime.
Le fait de le dire m’avait aussi mise plus à l’aise moi, puisque c’est du fait d’avoir subi des abus sexuels incestueux que j’ai eu envie de mener une recherche sur ce thème en anthropologie.
Avec les professionnel/le/s et bénévoles, j’ai du faire le choix inverse : me taire.
En plus d’un clair sentiment, spontané, comme quoi cela me desservirait sur le terrain, j’avais en effet le souvenir de ma discussion avec une bénévole d’une association s’occupant de lutter contre la maltraitance envers les enfants, fin 2007, dans le cadre d’une recherche de stage. Lorsqu’il m’a été signifié que « même les étudiant/e/s de master 2 en psychologie, nous les refusons comme stagiaires », ce qui mettait définitivement fin à tout espoir de stage ici, j’avais décidé de continuer à discuter avec mon interlocutrice, afin, au moins, de savoir un peu plus ce que faisait concrètement son association.
Dans cette conversation, lorsque j’ai glissé l’information selon laquelle j’avais été victime d’inceste pour expliquer mon point de vue personnel sur la prévention, l’entretien a tout de suite basculé, à l’initiative de mon interlocutrice, vers un entretien « d’aide à victime », avec interrogatoire serré (avez-vous des frères et sœurs ? Avez-vous porté plainte ? Etc.). Malgré mes protestations, je me suis donc retrouvée dans le rôle (non souhaité) de la « victime à aider », alors que j’étais venue chercher un stage.
Il était donc dès lors clair qu’il ne fallait surtout pas que je donne cette information sur moi, si je voulais pouvoir obtenir et conduire mes entretiens pour ce mémoire. Donner cette information revenait en effet à risquer fortement d’être déchue de ma place, qu’elle soit d’anthropologue, ou tout autre statut selon les contextes[22], pour être mise dans celle de « victime à aider », que cela fasse partie ou non de ma demande à moi dans le moment.
Ceci me conduit à proposer d’analyser le statut de « victime », dans ces contextes, comme un stigmate, au sens de Goffman : « Le mot de stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit profond [sur la personne, dans un contexte donné] » (Goffman, 1975, p 13). Ainsi, « un individu qui aurait pu aisément se faire admettre dans le cercle des rapports sociaux ordinaires possède une caractéristique [par exemple : avoir subi un inceste] telle qu’elle peut s’imposer à l’attention de ceux d’entre nous qui le rencontrent, (…) détruisant ainsi les droits qu’il a vis-à-vis de nous du fait de ses autres attributs. Il possède un stigmate, une différence fâcheuse d’avec ce à quoi nous nous attendions. » (Goffman, 1975, p 15). Goffman distingue en outre l’individu discrédité, dont le stigmate est d’emblée visible, et l’individu discréditable, dont « la différence n’est ni immédiatement apparente ni déjà connue (…). Le problème n’est [alors] plus tant de savoir manier la tension qu’engendrent les rapports sociaux que de savoir manipuler de l’information concernant une déficience : l’exposer ou ne pas l’exposer ; la dire ou ne pas la dire ; feindre ou ne pas feindre ; mentir ou ne pas mentir : et, dans chaque cas, à qui, comment, où et quand. » (Goffman, 1975, p 57). Avoir été victime d’inceste rattache la personne à la seconde catégorie : celle des individus discréditables. Pour l’anthropologue que je suis, avoir été victime d’inceste implique donc de facto toutes ces questions de présentation de soi. Sans compter la peur d’être « découverte » : « au cours des contacts mixtes [comme par exemple mon terrain de master 2], l’individu affligé d’un stigmate a tendance à se sentir « en représentation », obligé de surveiller et de contrôler l’impression qu’il produit, avec une intensité et une étendue qui, suppose-t-il, ne s’imposent pas aux autres. » (Goffman, 1975, p 26).
Mais dans ce cas plus précis des violences sexuelles, le stigmate apparaît comme provoquant des sentiments très difficiles à supporter sans agir, pour les personnes interlocutrices du/de la stigmatisé/e, comme cela apparaît par exemple lors de discussions avec les enquêteurs/trices de l’enquête statistique CSF (Contextes de la Sexualité en France), à propos du module « abus et violences sexuelles » du questionnaire : « « Puis j’ai raccroché. Et je ne sais pas. Si ça se trouve, cette femme elle va avoir du mal à se remettre, elle ne pourrait plus avoir des rapports avec son mari, pendant un moment. Tout ça à cause d’un coup de fil. Elle n’y pensait pas avant. » « Comment on peut savoir ce qui se passe après. C’est « salut au revoir ». Si ça se trouve il/elle va tenter de se suicider. Elle va faire une dépression à cause de moi . » Une enquêtrice, pour se défendre de cette culpabilité, a insisté très lourdement pour que l’enquêtée accepte de noter les numéros verts (numéros d’associations ou de structures qui s’adressent aux personnes ayant subi des violences ou des abus sexuels) dont elle disait n’avoir pas besoin. « Parfois ils sont dans la dénégation, ils n’expriment aucune souffrance. Mais il faut qu’on fasse quelque chose. On ne peut pas les laisser comme ça. » » (Levinson, 2008, p 108). Et donc, on ne peut me laisser comme ça non plus … inimaginable qu’il n’y ait plus rien à faire « pour » moi[23]. Levinson explicite d’ailleurs davantage ce qui se passe là, sous le signe de la projection : « L’expression de ces craintes a permis au groupe de travailler sur la distinction entre la souffrance de l’enquêté-e et celle de l’enquêteur. Reconnaître que sa propre souffrance, ses frustrations, et ses incertitudes sont projetées sur l’enquêté a considérablement diminué l’angoisse des enquêteurs et permis d’aborder ce module avec davantage de confiance en soi et de bonne distance affective. » (Levinson, 2008, p 108).
Mais mes interlocuteurs/trices à moi n’ayant pas participé à cette dynamique d’expression, je me suis tue sur mon statut d’incestée, et ai plutôt glissé, au fil des entretiens, d’autres statuts, selon les cas : « je vois un peu, j’ai été prof vacataire », « rassurez-vous, j’ai déjà travaillé dans des administrations donc ça va je suis votre explication … administrative » ...
Ainsi, « j’ai été victime d’inceste » n’est aucunement une information aussi ordinaire que ces autres éléments, qui font partie de mon passé. Même si je le conjugue, exprès, au passé, puisque c’est aussi du passé …
Cela soulève d’ailleurs la question de « l’archivage » possible de ce type d’événements : à supposer qu’on y parvienne pour soi, c'est-à-dire qu’il devienne un souvenir passé, et non plus une douleur actuelle revenant se rappeler sous forme de cauchemars ou autres manifestations désagréables même des décennies après. Cette possibilité de transformation en souvenir enfin simplement historique semble absolument impensée par ces personnes, qui éprouvent le besoin de réactualiser ainsi le statut de victime pour pouvoir agir, « aider » … s’aider à supporter moins mal leur angoisse ?
Devoir me taire m’a mise extrêmement mal à l’aise dans mes premiers contacts : j’avais peur qu’on me questionne sur ce qui me motivait à avoir choisi un tel sujet, et ai donc préparé une liste de raisons, plus présentables, à réciter, au cas où. En outre, cela recréait une situation de mise au secret pour moi : j’avais l’impression que je ne pourrais pas parler librement, la moindre connaissance empirique du sujet pouvant me révéler comme victime et donc me disqualifier comme anthropologue. Heureusement, ces connaissances empiriques pouvaient tout aussi bien venir, finalement, de mon travail de master 1, dont je me suis amplement servie comme média pour pouvoir tout de même « afficher » mes savoirs lorsque la conversation le nécessitait. Bien sûr, j’ai eu, du coup, peur que des personnes me demandent de pouvoir lire ce mémoire de master 1 avant l’entretien … puisque j’y avais écrit, en première page, en toutes lettres, que c’était, précisément, du fait d’avoir été victime d’inceste que j’avais eu envie d’effectuer ce travail !
Une autre manière d’analyser la situation aurait pu être d’évoquer les déconvenues rencontrées par Samuel Lézé dans ses entretiens avec des psychanalystes : d’anthropologue, doctorant, venant avec son magnétophone pour un entretien avec un psychanalyste, le voilà transformé en « homme au magnétophone », c'est-à-dire patient un peu bizarre venu avec ce matériel, patient auquel il est demandé « quel est votre désir ? », et l’entretien d’enquête anthropologique se voit l’objet de tentatives de transformation en entretien préliminaire à une cure … en effet, « Faire une recherche sur la cure ce serait une façon de « dire sans dire », i.e. une demande implicite de recherche sur soi, ou encore une façon négative de s’interdire de faire une cure. » (Lézé, 2008, p 54), aussi vrai qu’il y a « toujours anguille sous roche » (Lézé, 2008, p 53) dans une demande … Il comprend alors que « Des places sont assignées bien malgré soi et se cogner à certaines limites permet de réaliser l’existence d’un système de places. » (Lézé, 2008, p 46). En l’occurrence, ici, celles d’analyste, d’analyste en formation, d’analysant, d’analysant potentiel, et c’est tout. C’est pourquoi « L’entretien [anthropologique] avec un psychanalyste ne va pas de soi. (…) Il faut (…) que la situation remplisse deux conditions : ne pas être perçu comme un individu porteur d’une plainte ; que mon interlocuteur ne se pose pas comme (« mon ») psychanalyste. » (Lézé, 2008, p 47).
En réalité, j’ai heureusement plus de chance que Samuel Lézé, à condition de ne pas communiquer mon statut de victime d’inceste, susceptible de m’assigner à tout instant à la « place de victime » contenue dans le système des places existant dans mon cas. Je bénéficie du fait que l’entretien peut être en partie centré sur les « cas » rencontrés, et non sur le déroulement d’une séance (mon sujet n’est pas « la psychanalyse », mais « l’inceste »), ce qui me met dans un statut de « discussion d’expert/e/s », ou bien « passation de savoirs entre expert/e et novice à former » sur ces « cas » rencontrés par le ou la professionnel/le.
En réalité, les « cas » m’intéressent comme support de discussion sur l’activité et les représentations de mes interlocuteurs/trices autour de l’inceste, et non en eux-mêmes[24]. En réalité, mes « cas » à moi, dans cette optique, ce sont donc mes interlocuteurs/trices, mais tout comme il y avait une ignorance autour de mon statut d’incestée, il y avait également une ignorance, tacite, entre eux/elles et moi, sur cela … Un flou, pas levé, qui faisait de « la femme au magnétophone », probablement, un succédané de travailleuse sociale en cours de réalisation de son mémoire professionnel. Succédané peut-être étrange, car s’intéressant aux « ethnies », comme me le renvoie un assistant social, qui s’amuse à commencer l’entretien à sa manière, en me posant des questions pour « identifier mon école anthropologique ». Et de conclure, humoristiquement, qu’il aime bien « connaître à quelle ethnie se rattachent les gens ». Avant de m’inviter aimablement à brancher le magnétophone pour le vrai entretien …
Finalement, faut-il parler de « cas », ici ou ailleurs ? Ou bien, comment parler de « cas » sans pour autant réduire les personnes à être des « cas », que ce soit dans le travail social, psychologique, ou bien encore anthropologique ?
Ce point permet, précisément, d’en venir à une spécificité de ce travail : habituellement, ce sont des personnes qui font autorité dans leur domaine professionnel, qui écrivent sur les institutions de Protection de l’Enfance ou encore sur les enfants victimes d’abus incestueux et leurs familles, ainsi que sur l’évolution de ces enfants à l’âge adulte.
En master 1, c’était moi, personne qui ne fais pas encore autorité en anthropologie car je suis en apprentissage, qui écrivais sur « mes pairs » victimes d’inceste.
Cette année, finalement, on pourrait dire « c’est une anthropologue ayant été victime d’inceste qui tente d’écrire sur les institutions de Protection de l’Enfance et les spécialistes reconnu/e/s du sujet ». C'est-à-dire une situation doublement inhabituelle : c’est une personne extérieure à ces univers professionnels, ne faisant donc aucunement partie des personnes « du sérail » qui écrivent habituellement sur ce « sérail » ; c’est une personne qui a déjà eu affaire à certaines de ces institutions et professions, mais en tant qu’usagère, de l’autre côté de la barrière, donc.
Si je n’écrivais pas cette réalité – à savoir : l’auteure de cette recherche a été incestée, et a de ce fait été usagère des services sociaux et autres professions et institutions concernées, dans le présent travail, il n’y aurait pas de problème. Mais, précisément, ce qui m’intéresse est de poser le problème sur la table clairement, ici et maintenant.
En effet, la place de « victime d’inceste » (ou, plus largement, victime d’abus sexuels), telle qu’elle est construite socialement, est une place délégitimante. Cela est visible par exemple dans l’ouvrage de Liliane Daligand, L’enfant et le diable, accueillir et soigner les victimes de violences, lorsque l’auteure, médecin légiste et psychiatre expert auprès des tribunaux, écrit « on peut noter qu’une jeune stagiaire de la crèche a témoigné de l’attitude de repli sur soi de Noémie, en mettant cela en parallèle avec son propre passé de victime d’abus sexuel » (Daligand, 2004, p 147). Les italiques sont de l’auteure, et sa conclusion est, sur cette affaire, que « les conséquences du signalement ont provoqué des phénomènes d’angoisse et une souffrance psychique chez tous les membres de cette famille » (Daligand, 2004, p 149). Voilà une bien lourde culpabilité à porter pour la jeune stagiaire, ex-victime …
Les seules autres italiques figurant dans le chapitre « pièces » où est évoquée la « jeune » « stagiaire » au « passé de victime d’abus sexuel » - rien que cela n’en jetez plus (!), concernent l’examen médical qui conclut à « l’absence de lésion génito-anale » (donc « RAS »), et celles d’une expertise pédopsychiatrique qui conclut à un développement non troublé de l’enfant, tout en signalant une situation de souffrance « par rapport à un déséquilibre relationnel intransmissible » (Daligand, 2004, p 147).
Il faut remonter plusieurs pages en arrière, donc sortir du chapitre « pièces », pour lire qu’à la crèche, « la directrice aurait fait « dire des choses » à Noémie qui présentait des irritations vulvaires depuis environ un an. Noémie a eu également un herpès buccal et la directrice a suspecté des abus sexuels. » (Daligand, 2004, p 144). D’autres « signes d’alerte » suivent, aboutissant à ce que « Finalement, un médecin de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) les aurait obligées à faire un signalement à la DDASS, puis au Procureur de la République. » (Daligand, 2004, p 145).
On le voit, en réalité, le signalement ne s’est pas fait de manière si « intempestive » qu’il y paraît[25], il a fallu une accumulation de personnes, pas toutes « jeunes », « stagiaires », voire, peut-être pire, ayant un « passé de victime d’abus sexuel », pour arriver à ce résultat.
Résultat que Liliane Daligand classe dans un chapitre de son ouvrage intitulé « Signalements intempestifs et fausses allégations ». Il s’agit ici du signalement intempestif.
Le chapitre commence, en outre, ainsi : « Des observateurs sans expérience mais alertés par les médias ou responsabilisés par leur administration font, sur des signes souvent minimes qui donnent prise à leur imagination, sans contrôle, sans critique préalable, des signalements non fondés. » (Daligand, 2004, p 143).
Et ce qui est important pour nous ici, le fait qu’une personne « jeune », « stagiaire » (donc inexpérimentée) et au « passé de victime d’abus sexuel » ait évoqué que l’attitude de Noémie lui rappelait ses attitudes à elle lorsqu’elle subissait des abus, est utilisé comme pièce « à charge » pour nous démontrer, presque mathématiquement, ce caractère intempestif du signalement.
J’emploie à dessein l’expression « démonstration mathématique », car dans l’ouvrage, sur l’ensemble des cas d’expertise développés, jamais Liliane Daligand ne fait part du moindre doute éprouvé par elle : ses décisions, ses diagnostics, sont justifiés exclusivement, en réalité, par des démonstrations à sens unique, où jamais les points de vue divergents d’avec celui retenu ne peuvent trouver le moindre crédit, ni même, d’ailleurs, la moindre existence. Le signalement est intempestif, il s’agit de fausses allégations, il s’agit d’un signalement justifié : j’en suis sûre, nous affirme-t-elle à chaque fois. D’ailleurs, elle ne l’écrit même pas : si nous lisions « j’en suis sûre » sous sa plume, nous pourrions en effet, au moins, commencer à penser : « ah, elle aurait donc pu ne pas être sûre ? ».
L’ouvrage apparaît alors comme une entreprise d’auto-renforcement de sa légitimité par cette personne déjà légitime de par ses statuts de médecin légiste et expert psychiatre.
Insidieusement, nous avons donc effectué là « un déplacement depuis la question de la vérité vers la question du pouvoir – et du pouvoir de parole en particulier » (Michel Agier, 2006, p. 156). Mais cela, Liliane Daligand ne nous le dit pas, nous laissant accroire que le pouvoir, et en particulier celui qu’elle exerce, détient la vérité.
Mais, plus précisément, que s’est-il passé, le temps de la lecture de la page 147 de l’ouvrage de Liliane Daligand ?
Pierre Bourdieu, dans Ce que parler veut dire, développe le concept de rites d’institution.
Ceci, à partir d’un ré-examen critique du concept de « rites de passage » développés par Van Gennep et Turner, d’une part, et du concept de « performatif » exposé par Austin, d’autre part.
Le performatif, c’est cette faculté qu’ont les mots d’agir sur la réalité, nous apprenait Austin : ainsi, dire « je te sacre » ou « je vous déclare mariés » modifie le réel. Mais Pierre Bourdieu met l’accent sur le fait que n’importe qui ne peut dire « je te sacre » ou « je vous déclare mariés » : « C’est ce qu’oublient les linguistes qui, dans la lignée d’Austin, cherchent dans les mots eux-mêmes la « force illocutionnaire » qu’ils détiennent parfois en tant que performatifs » (Bourdieu, 1982, p 132). Pour Bourdieu, ce n’est pas dans le langage qu’il faut chercher, mais dans les rapports sociaux, puisque « La plupart des conditions qui doivent être remplies pour qu’un énoncé performatif réussisse se réduisent à l’adéquation du locuteur – ou, mieux, de sa fonction sociale – et du discours qu’il prononce : un énoncé performatif est voué à l’échec toutes les fois qu’il n’est pas prononcé par une personne ayant le « pouvoir » de le prononcer » (Bourdieu, 1982, p 109). C’est pourquoi il ne suffit pas à la jeune stagiaire de répondre à Liliane Daligand que son expérience en vaut bien une autre, pour pouvoir sortir de la liste des pièces « à charge » du dossier. En effet, c’est Liliane Daligand qui, puisque médecin légiste et expert psychiatre, a ici le pouvoir de parole.
Et si elle l’a, c’est parce qu’elle a effectué les rites de passage lui permettant d’user des titres de médecin légiste et expert psychiatre, contrairement à la jeune stagiaire. Ces rites de passage ont été nommés et décomposés par Van Gennep et Turner : ils comportent trois phases. La phase de séparation, la phase de liminalité et celle d’intégration. Par exemple, l’entrée en faculté de médecine sépare Liliane Daligand des non-médecins. Mais elle n’est pas encore médecin, et ce, pour une durée d’au moins huit ans : c’est la phase de liminalité, caractérisée par le fait qu’on n’est plus comme les membres du groupe d’où on est issu/e … mais pas encore partie prenante du groupe auquel on aspire à participer. Enfin, la phase d’intégration est celle par laquelle, via la soutenance du doctorat en médecine (spécialisation psychiatrie) Liliane Daligand acquiert la légitimité d’exercer la médecine et la psychiatrie, devient pair des autres médecins psychiatres.
Mais Pierre Bourdieu se demande alors « si, en mettant l’accent sur le passage temporel – de l’enfance à l’âge adulte par exemple [ou du statut de profane au statut de médecin] - , cette théorie ne masque pas un des effets essentiels du rite, à savoir de séparer ceux qui l’ont subi non de ceux qui ne l’ont pas encore subi, mais de ceux qui ne le subiront en aucune façon et d’instituer ainsi une différence durable entre ceux que ce rite concerne et ceux qu’il ne concerne pas. » (Bourdieu, 1982, p 121). Il propose donc de parler, plutôt que de rites de passage, de rites d’institution (« en donnant à ce mot le sens actif qu’il a par exemple dans l’expression « institution d’un héritier » » (Bourdieu, 1982, p 121)). Et de changer d’angle de vue, puisque « En marquant solennellement le passage d’une ligne qui instaure une division fondamentale de l’ordre social, le rite attire l’attention de l’observateur vers le passage (d’où l’expression rite de passage), alors que l’important est la ligne [de séparation]. Cette ligne, en effet, que sépare-t-elle ? Un avant et un après, bien sûr : l’enfant non circoncis et l’enfant circoncis (…). En réalité, le plus important, et qui passe inaperçu, c’est la division qu’elle opère entre l’ensemble de ceux qui sont justiciables de la circoncision, les garçons, les hommes, enfants ou adultes, de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les fillettes et les femmes. » (Bourdieu, 1982, p 122).
Le plus important, c’est la ligne de séparation, arbitraire et ainsi légitimée, entre les instituables et les non instituables : quel rapport avec notre propos ?
Les incestées apparaissent maintenant ouvertement dans différents champs : le champ littéraire, le champ thérapeutique, principalement.
Monique Wittig remarquait que si l’on écrit un texte évoquant, par exemple, l’homosexualité parmi ses thèmes, « Le texte donc qui accueille un tel thème [peut voir] une de ses parties prises pour le tout, un des éléments constituants du texte pris pour tout le texte et le livre devenir un symbole, un manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d’opérer au niveau littéraire, il est l’objet de déconsidération en ce sens qu’on cesse de le considérer en relation avec les textes équivalents. Cela devient un texte à thème social et il attire l’attention sur un problème social. Quand cela arrive à un texte il est détourné de son but premier qui est de changer la réalité textuelle dans laquelle il s’inscrit. (…) Il n’intéresse plus que les homosexuels. » (Wittig, 2007, p 91-92). Dans le champ littéraire, les ouvrages publiés évoquant le thème de l’inceste sont quasiment tous des ouvrages de témoignages. Ils ne sont pas référencés comme des œuvres littéraires à proprement parler[26]. Ils attirent l’attention de ceux et celles qui veulent bien les lire sur un problème social : l’inceste. Ils n’intéressent que les incesté/e/s, ou presque ?
Ils montrent surtout la position subordonnée dans le champ littéraire, des ouvrages parus évoquant l’inceste, même si un certain nombre sont écrits d’une façon qui pourrait mériter le qualificatif de « littéraire ». Dès lors, on peut poser la question : les incesté/e/s sont-elles/ils instituables dans le champ littéraire ?
Certains ouvrages sortent néanmoins du domaine de la littérature de témoignage, pour s’engager sur le chemin de la réflexivité : « voilà quel a été mon parcours en tant qu’incestée, et voilà comment je peux l’analyser à travers les outils de la psychologie et des récits de vie », nous dit en substance Mary Odile, aujourd’hui thérapeute suite à ce travail réflexif validé par l’université. Mais il aura fallu qu’elle fréquente deux universités avant de parvenir à cette validation … En effet, lorsqu’on lui demande « Repérez dans votre histoire de vie ce qui a été formateur pour vous », elle cache son vécu, car : « Je me retrouvais face à un véritable paradoxe : j’avais vécu des situations désignées comme « déstructurantes » par notre culture. Mais si j’étais là, dans cette formation, c’était grâce à elles. C’est donc que je les avais transformées pour en tirer des leçons, des apprentissages. Mais culturellement admises comme « déstructurantes », je prenais un très gros risque si je décidais d’en parler : celui d’être vue comme une « déstructurée » » (Mary Odile, 2006, p 72). Ou d’être vue comme une jeune stagiaire de crèche au passé stigmatisant ?
Elle poursuit : « Comment raconter mon parcours sans rien dire de mon histoire ?? J’étais tellement dans la peur d’être jugée, étiquetée, qu’à chaque prise de parole, je fondais en larmes. Pourtant, je ne disais rien de ma vie. (…) En juin 1999, je présentais mon mémoire de première année et ma question de recherche. Je réussis le défi de ne jamais parler de mon implication dans mon sujet. Alors qu’on me proposait exactement l’inverse. Cela devenait difficile. Le groupe m’interpella sur le fait de ne jamais dire « je ». » (Mary Odile, 2006, p 73). C’est au bout de cette année qu’elle prend son courage à deux mains : « Finalement, je me décidais à parler à mes formateurs. Un par un. L’un après l’autre. Oh, je ne leur ai pas dit grand chose. J’ai simplement lâché le mot « inceste ». Ils ont tous eu sur le coup exactement la même réaction : devenir blêmes, livides et distants. (…) Et puis ils ont insisté sur le fait que je n’avais pas à en parler dans ce lieu de formation. Ni dans mon mémoire. » (Mary Odile, 2006, p 73). Alors que c’était le principe même de la formation : partir de son vécu pour en tirer ce qui y avait été formateur pour soi. Pour cette université, et ces formateurs, Mary Odile n’était donc tout simplement pas instituable, puisque incestée. Ou alors, il aurait fallu qu’elle fasse semblant d’avoir une autre histoire, sans abus incestueux , bref, il aurait fallu qu’elle se taise.
Il faudra attendre 2004 avant qu’elle trouve une université plus accueillante et y valide son travail. Validation suite à laquelle elle exerce en tant que thérapeute, animatrice de groupes de parole, etc, notamment pour des incestées. Mais elle n’est ni médecin psychiatre, ni même « simplement » psychologue clinicienne, et encore moins psychanalyste : tout au bas de la hiérarchie interne au champ « psy », elle est simplement psychothérapeute[27]. En aucun cas, elle n’aura donc la légitimité d’une Liliane Daligand pour s’exprimer sur l’inceste …
Non qu’il n’y aurait aucun/e psychiatre, psychanalyste ou psychologue qui aurait été incesté/e. Mais, simplement, il vaut mieux que cela ne se sache pas. Dorothée Dussy remarque à cet égard que « Déroger à la règle du silence sur l’inceste revenant à perturber l’ordre social, il n’est pas anodin de constater qu’il n’y a quasiment que des femmes et des enfants, c'est-à-dire les groupes qui ont le moins de poids dans l’exercice du pouvoir et le moins de légitimité représentative de l’ordre social, qui révèlent l’inceste » (Dussy, 2009, p 133). C’est ainsi que sur des forums internet d’entraide entre incesté/e/s, il est possible de lire les dilemmes d’une telle, éducatrice, d’une telle autre, psychiatre : les enfants leur confient plus souvent qu’à d’autres ces choses-là, comment expliquer, justifier cela aux collègues ou à la hiérarchie sans dire cette partie de son passé à soi ? Ou encore elles ont des savoirs sur les maltraitances qui transparaissent, d’où leur viennent-ils ? Pourvu que personne ne pense à l’explication, s’inquiètent-elles, restant seules avec ce vécu à cacher comme un secret honteux, alors, précisément, qu’il leur sert pour comprendre les jeunes victimes et les mécanismes des maltraitances qu’elles subissent …
Pendant ce temps, Liliane Daligand continue d’offrir ses propos à notre lecture : retournons au tout début de l’ouvrage, qui s’intitule, précisément, « avant propos ». Elle y relate son parcours de vie, de façon émouvante et touchante. La première phrase est : « J’aurais voulu être trapéziste, faire le saut de l’ange ou de la mort. Mais à 16 ans, en terminale, j’ai décidé d’être psychanalyste » (Daligand, 2004, p 17). Comment cette ex-ado suicidaire peut-elle être ainsi plus légitime à nos yeux qu’une stagiaire en crèche ex-victime d’abus sexuels ?
Pierre Bourdieu remarque alors, fort à propos, l’existence de ce qu’il appelle des stratégies de condescendance : « le consacré condescendant choisit délibérément de passer la ligne ; il a le privilège des privilèges, celui qui consiste à prendre des libertés avec son privilège. C’est ainsi qu’en matière d’usage de la langue, les bourgeois et surtout les intellectuels peuvent se permettre des formes d’hypocorrection, de relâchement, qui sont interdites aux petits bourgeois, condamnés à l’hypercorrection. » (Bourdieu, 1982, p 131). C’est ainsi que Liliane Daligand peut nous confier avoir eu pour idée un jour de faire le saut de l’ange, puis délégitimer les incestées en tant que porteuses de connaissances sur l’inceste (au contraire, arguer de son expérience d’incestée constitue une pièce « à charge »). Contrairement à Mary Odile ou aux incestées auteures de témoignages littéraires, elle est suffisamment légitime pour cela. Il faut noter que ce modèle d’expertise, où si l’on est passé/e par l’expérience dont il est question, on ne peut être légitime, est à l’opposé du modèle chamanique concernant les maladies : on ne peut être chamane que si l’on a été touché par le mal que l’on a la vocation de guérir. Las, on ne peut parler légitimement sur l’inceste que si l’on n’a pas été incesté/e … et c’est dans ce contexte-là que j’effectue quant à moi ma recherche.
Monique Wittig nous explique, à cet instant, que « pour mener à bien une œuvre littéraire, il faut avant tout être modeste et ne pas ignorer que tout ne se joue pas dans le fait d’être gay ou quoi que ce soit de comparable sociologiquement [par exemple, être incestée]. (…) Plus le point de vue est particulier, plus l’entreprise d’universalisation exige une attention soutenue aux éléments formels qui sont susceptibles d’être ouverts à l’histoire tels que les thèmes, les sujets du récit en même temps que la forme globale du travail. C’est finalement par l’entreprise d’universalisation qu’une œuvre littéraire peut se transformer en machine de guerre. » (Wittig, 2007, p 102). Elle prend l’exemple de Proust dont « les personnages et les descriptions de moments donnés servent, comme autant de couches, à construire, petit à petit, le sujet, comme étant homosexuel pour la première fois dans l’histoire littéraire. » (Wittig, 2007, p 102). Quant à la machine de guerre, « son intention et son but sont de démolir les vieilles formes et les règles conventionnelles. Et plus ce cheval de Troie apparaît étrange, non conformiste, inassimilable, plus il lui faut de temps pour être accepté. En fin de compte, il est adopté, et par la suite il fonctionne comme une mine, quelle que soit sa lenteur initiale. Il sape et fait sauter la terre où il a été planté. Les vieilles formes littéraires auxquelles on a été habitué apparaissent à la longue démodées, inefficaces » (Wittig, 2007, p 98). L’idée est ici que les choses peuvent changer, que les subalternes ne sont pas condamnées à ne jamais pouvoir parler, et ce, j’ajoute, en sciences sociales comme en littérature. Donc que le monologue de Liliane Daligand pourrait bien, un jour ou l’autre, devoir se transformer en dialogue. Voire en pluri-logue. Voire que l’idée même d’un monologue auto-légitimant comme elle le pratique actuellement paraisse démodée, devienne inefficace. Et, par ma recherche, à mon niveau, j’ai bien l’intention d’y contribuer. En anthropologie également, il est possible de penser (et de construire) la « machine de guerre ».
Pour ce faire, il nous faut ré-examiner encore ce en quoi consiste un discours qui ne laisse pas place au doute, tel celui de Liliane Daligand.
Christine Delphy évoque le positivisme comme constituant une « Traduction en termes laïques de la thèse de l’ubiquité de Dieu, [et] cette prétention à parler de « nulle part », donc de « partout », va de pair avec celle d’exercer un magistère civil. Or la « nouvelle » épistémologie [des savoirs situés] (qui n’est en réalité pas nouvelle puisque les premières critiques du positivisme ont un siècle et sont contemporaines du positivisme lui-même) replace les scientifiques et leurs productions là où ils sont, dans l’histoire et dans la société, à des endroits précis de la hiérarchie sociale. (…) Cela a pour conséquence de relativiser la connaissance, et de miner la base des revendications d’autorité – de magistère – des scientifiques. (…) anti-féminisme et adhésion au positivisme ont la même origine, le même enjeu : le pouvoir. » (Delphy, 2009, p 28), nous précise-t-elle. Nous reconnaissons là les caractéristiques de la prise de parole de Liliane Daligand dans L’enfant et le diable, et, par suite, son rattachement au positivisme. Positivisme qui proclame subjectif, donc invalide, tout point de vue « marqué » socialement, comme s’il pouvait exister un point de vue « hors social », « non marqué », c'est-à-dire un point de vue qui n’en soit pas un. Oublions là cette conception, absurde, et passons à présent aux choses sérieuses.
Lorsque Jeanne Favret-Saada parle de son étude de la sorcellerie dans le bocage normand, elle constate que « la sorcellerie, c’est de la parole, mais une parole qui est pouvoir et non savoir ou information. » (Favret-Saada, 2005, p 26). Dans ce contexte, « Autant dire qu’il n’y a pas de position neutre de la parole : en sorcellerie, la parole, c’est la guerre. Quiconque en parle est un belligérant et l’ethnographe comme tout le monde. Il n’y a pas de place pour un observateur non engagé. » (Favret-Saada, 2005, p 27). De fait, l’anthropologue ne peut étudier la sorcellerie qu’à condition d’être « pris » dedans, c'est-à-dire d’occuper une des places du système de places existant : sorcier, désorceleur, ou victime. Mais il/elle a encore le choix de rester extérieur/e à ce système de places. Il/elle peut ainsi vaquer, tranquillement, dans le bocage, en ignorant totalement cet univers dont les drames se déroulent, subrepticement, autour de lui/elle.
Il n’en est pas de même concernant l’inceste, puisque dès lors que le mot est prononcé, « nous nous positionnons comme acteurs du jeu social, c'est-à-dire comme parents, amis, voisins, [et] nous évitons précisément de réaliser qu’autour de nous, des enfants sont violés dans leur famille. » (Dussy, 2009, p 131). Ainsi, ici aussi, mais de manière encore accrue, il n’y a pas de place pour un observateur non engagé : l’observateur/trice est engagé/e, ne serait-ce que dans la position d’un/e Ponce Pilate telle que nous la décrit Dussy. Et la parole, comme nous l’avons vu plus haut en commentant Liliane Daligand, relève tout autant du registre du pouvoir que de celui de l’information.
Dès lors, question bien embarrassante que nous ne pouvons éluder : comment effectuer la démarcation entre le sujet de l’observation et l’observateur ?
Liliane Daligand l’avait fait de manière fort simple : en distinguant un « propos » et un « avant propos ». Dans l’avant-propos, elle se présente, nous raconte sa vie, ses émotions … avant de passer au « propos », où, après les deux premiers chapitres dans lesquels elle dit encore « je », elle ne nous parle plus du tout d’elle-même, semble absente, laissant place au regard et aux certitudes, objectives mais aussi désincarnées, de l’expert qu’elle est devenue face à ses objets d’étude (et de décisions).
C’est à cet instant que François Laplantine demande la parole, pour rappeler que, déjà, « Dans Les règles de la méthode sociologique, Durkheim y revient sans cesse. Il estime que pour parvenir à l’objectivité, il convient de neutraliser la subjectivité, de diviser, en quelque sorte, le sujet en deux : celui de la logique et celui de l’affectivité. C’est donc logiquement – mais est-ce bien raisonnable ? – que la connaissance se voit séparée de la souffrance, du plaisir, du désir, bref, de tout ce qui est censé nous égarer. Il s’agit d’un processus de rationalisation (…), qui désigne une certaine façon dont le sujet se défend lorsqu’étant affecté, il se sent menacé. » (Laplantine, 2007, p 51-52).
Au contraire, ajoute Georges Devereux, « L’étude scientifique de l’Homme (…) doit exploiter la subjectivité inhérente à toute observation en la considérant comme la voie royale vers une objectivation authentique plutôt que fictive. » (Devereux, 1980, p 16). Il s’agit donc ici, à l’inverse de la partition Durkheimienne, d’utiliser ses affects, qui sont induits dans la situation étudiée (contre transfert), pour parvenir à s’approcher d’une vision objective, et ainsi, « une expérience sur des rats, une enquête ethnographique ou une psychanalyse contribuent davantage à la compréhension du comportement quand elles sont considérées comme une source d’information sur le psychologue expérimental, l’ethnologue ou le psychanalyste, que lorsqu’elles sont considérées seulement comme une source d’information sur les rats, les primitifs ou les patients. » (Devereux, 1980, p 19). Certes. Fort bien. Mais à un moment, il faut tout de même effectuer une division en deux ?
Georges Devereux explique alors que « de nombreuses difficultés de la science du comportement proviennent de tentatives pour contourner et pour ignorer [les] interactions [tant conscientes qu’inconscientes, entre l’observateur et le sujet de l’observation] – et tout particulièrement le fait que l’observation du sujet par l’observateur a, comme complément, la contre-observation de l’observateur par le sujet. » (Devereux, 1980, p 375). Ce constat contraint à abandonner l’idée que « l’opération fondamentale en science du comportement est l’observation d’un sujet par un observateur[, pour] lui substituer l’idée que l’opération fondamentale est l’analyse de l’interaction entre les deux, dans une situation où chacun des deux est simultanément observateur pour soi-même et sujet pour l’autre » (Devereux, 1980, p 375).
Mais cela crée une situation, en somme, symétrique, où l’on ne sait plus qui observe qui.
Pour lever cette indétermination, Devereux propose de distinguer le sujet en lui permettant de produire des énoncés, et l’observateur, « c'est-à-dire celui qui est défini comme tel », en l’autorisant de surcroît à « produire aussi des énoncés sur des énoncés. » (Devereux, 1980, p 376).
C’est ainsi qu’il est possible, dans ce mémoire, d’osciller entre les registres du témoignage et de l’analyse, l’analyse pouvant porter sur mon propre témoignage, en tant qu’actrice du monde social comme le sont les incestées que j’ai interviewées pour mon travail de master 1, ou bien porter sur mon retour d’expérience à propos de ma rencontre avec mon terrain de master 2, ce qui constitue une forme d’anthropologie de l’anthropologie (et de l’anthropologue), ou encore, plus classiquement et plus fréquemment, porter sur les témoignages des interviewé/e/s, ce qui constituera le travail anthropologique proprement dit. Ainsi, il existe bien une démarcation entre l’observateur et son sujet, mais elle est devenue mobile, et assumée comme telle.
Je pense que cette mobilité assumée peut permettre, en outre, d’éviter de retomber dans les écueils que je relevais plus haut, d’une Science avec un grand S, majuscule s’il vous plaît, qui ne souffre plus la discussion. Et de participer à l’élaboration du débat au sein d’une science plus modeste, c'est-à-dire sans majuscule, trop présomptueuse.
Débat qui peut, et devrait, se dérouler dans le respect de tou/te/s les intervenant/e/s.
Pour ce faire, il s’agit donc ici non pas, ou plus modestement, pas uniquement, d’utiliser des citations d’entretiens en tant que « pièces » d’une démonstration, comme le suggèrent certains ouvrages : « En tant que production de source, la citation fait tout d’abord fonction d’élément de « preuve ». » (Blanchet et Gotman, 2007, p 111). Ni uniquement de façon illustrative (comme je vais le faire à l’instant) : « La citation peut également, lorsqu’elle vient en illustration des analyses de l’auteur, étayer ses interprétations. Dans ce cas, le lecteur dispose le plus souvent de deux énoncés légèrement différents, celui de l’interviewé qui livre une suite d’éléments, et celui de l’auteur qui établit une relation entre ces éléments. » (Blanchet et Gotman, 2007, p 111).
Mais de la considérer comme partie du texte à part entière, comme « collage » : François Laplantine explique que « Le collage est un autre procédé utilisé par les avant-gardes dès les années 1910 ( …). Il consiste dans la rencontre de formes, d’événements, de personnages éloignés les uns des autres sur un plan qui leur est étranger à tous. Très proche du collage, la citation ne vient pas nécessairement illustrer un propos, mais peut le surprendre, voire le suspendre. » (Laplantine, 2003, p 192-193), et contribuer ainsi, comme la mobilité des statuts d’observateur/sujet de l’observation, à créer des écarts, du doute. A éviter de se transformer, à son tour, en relais de la Science.
Par conséquent, dans ce travail, l’assertion selon laquelle « Le recours à la citation ne peut évidemment se substituer au texte qu’il vient éclairer ou étayer. » (Blanchet et Gotman, 2007, p 111) sera considérée comme résolument fausse[28]. Aussi fausse que la croyance selon laquelle, dans un quatre pages de l’INSEE par exemple, le tableau ou le graphique statistique n’aurait qu’une fonction illustratoire du texte : au contraire, il apporte, par sa forme, des informations, un contenu, que le texte ne peut livrer. Un peu comme une image ou une photo, souvent, ne fait pas qu’illustrer les mots qui l’entourent.
Aussi, dans un premier temps, la rencontre avec le terrain, et son déroulement, vont contribuer, de facto, d’une part à la connaissance anthropologique des institutions contactées, d’autre part à une anthropologie de l’anthropologue. Mais peut-être également à une anthropologie de l’évolution des relations entre une incestée qui devient anthropologue et ces institutions qui contribuent, par leurs réactions, positives ou non, à cette transformation …
J’ai fait le choix de ne pas donner suite aux possibilités d’entretiens avec des étudiant/e/s du master 2 professionnel d’anthropologie : j’aurais pu avoir ainsi 4 ou 5 entretiens avec des professionnel/le/s en reprise d’étude dans ma discipline, dans ma faculté, ce qui me posait, hélas, de bien prévisibles problèmes pour l’anonymat et la confidentialité de mes entretiens ensuite, outre l’aspect de vase clos lui aussi problématique : « les anthropologues s’interviewent entre eux/elles et cela donne un mémoire ». On peut supposer de surcroît que ce n’est pas « n’importe quel/le » professionnel/le qui va reprendre ainsi des études.
Hors ces personnes, je n’avais a priori aucune entrée sur le terrain. Je ne connaissais aucun/e travailleur/euse social/e. Quant à l’éducation nationale, j’avais perdu au fil du temps tout contact avec les gens que j’y avais connus lorsque j’y avais moi-même travaillé, à la fin des années 90 et au début des années 2000.
Il me fallait donc, une fois les opportunités d’entretiens amenées par mes camarades étudiant/e/s de master délaissées, tenter d’atteindre des personnes par le biais de leur employeur, sur lequel ma méconnaissance était à peu près totale la plupart du temps.
En outre, à ce moment, une première difficulté, majeure, surgit : mes relations passées avec ces institutions, et leur impact fort sur moi.
La dernière fois que
j’avais eu à entrer dans une maison du Rhône, c’était lorsque, à 19 ans, ayant
entendu parler du contrat « jeune majeur », j’étais venue voir une
assistante sociale dans l’espoir qu’elle m’inclut dans ce dispositif puisque j’étais
en situation de rupture familiale et avais un projet professionnel clair.
Dispositif dont m’avait parlé une personne elle-même incluse dedans.
Le souvenir, cuisant,
était celui d’un énième déballage-exposition de mon parcours, pour me retrouver
avec simplement une lettre de recommandation pour une association catholique
qui pourrait me proposer, peut-être, « du travail ». Ce souvenir
faisait lui-même suite à une série d’autres, tout aussi cuisants, de
rencontres, qui avec l’assistante sociale de la maison du Rhône du quartier,
vers mes 16 ans, suite à un signalement me concernant, et celle de mon lycée,
avec à chaque fois la même demande : « je veux pouvoir partir de chez
mes parents, je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens ».
Puis celle de l’université,
une fois le départ fait sans aide.
Souvenirs cuisants de
personnes de pouvoir pour qui je suis juste « une adolescente qui cherche
ses limites », pour qui ma famille est normale et pour qui il faut, comme
tant d’autres de mon âge qui veulent « prendre leur autonomie »,
simplement dire de prendre leur mal en patience. Puis souvenir de l’assistante
sociale de l’université qui, après m’avoir laissée sans revenus durant deux ans
de DEUG, m’explique, une fois que j’entre en licence : « maintenant, on
vous connaît, on sait que vous ne mentez pas, que vous êtes vraiment en rupture
familiale, c’est OK pour les bourses sur critères dérogatoires ». Deux ans
de galère juste pour ça …
Autant dire que j’avais, pour le moins, comme des comptes à régler, un mélange de haine vis-à-vis de ces professionnelles qui m’avaient laissée sans aide si longtemps, et de peur, de vieille peur vis-à-vis de l’assistante sociale qui ne lâchera, éventuellement, la thune, que si j’expose dans le menu toute une partie de mon histoire dont elle se repaîtra … La rencontre avec une dernière assistante sociale, qui ne s’est repue de rien du tout avant de porter « en mains propres » mon dossier de demande de poste de surveillante d’externat au Rectorat, n’a hélas aucunement annulé mes (re)ssentiments précédents. Pourtant, il n’avait pas fallu un mois pour que j’aie alors un premier poste de surveillante, et, partant, un salaire.
Finalement, devant ma peur insurmontable à l’idée d’entrer dans une maison du Rhône, doublée de ma vieille rancœur vis-à-vis de ces personnes qui m’avaient laissée dans un univers invivable et ensuite dans une pauvreté matérielle sans nul doute difficile à entrevoir pour elles, je me suis dans un premier temps trouvée paralysée aussi bien pour effectuer les démarches de prise de contact avec ces institutions pour demander des entretiens, que pour construire la grille d’entretien elle-même.
J’ai donc décidé d’aller « régler mes comptes », carrément, là où cela était possible : en allant demander à la maison du Rhône où j’avais été convoquée suite au signalement, pourquoi on ne m’avait pas donné les moyens de partir de l’enfer où je vivais, et comment on avait pu nommer cet enfer comme constituant une vie « normale » d’adolescente « normale ».
Il n’a pas été facile
d’entrer là, puis de répondre à l’agent d’accueil : « c’est
pourquoi ? ». Ah. Oui. C’est pourquoi. Qu’est-ce que je pourrais bien
lui dire ? Dans l’improvisation totale, sur le vif, je raconte qu’il y a
eu un signalement, il y a environ 15 ans, fait à cette maison du Rhône, me
concernant, et que je souhaitais savoir s’il en existait une trace écrite
archivée.
Cela me donne accès à un bureau fermé, où une assistante sociale m’accueille, et me questionne pour comprendre plus précisément ce dont il s’agit, ce qu’ils/elles peuvent faire. Elle comprend qu’il y a eu un signalement, que j’ai été convoquée suite à ce signalement me concernant. Je lui explique que l’assistante sociale n’a pas dû poser les bonnes questions pour avoir les réponses, à l’époque, et qu’en plus il s’était passé d’autres choses. Elle me précise qu’elle ne me « demande pas le détail », et en réponse, je lui tends la photocopie de ma plainte pour « agression sexuelle ». Qu’elle lit. Sans changer de ton, elle continue alors à mener l’entretien, de façon très professionnelle. Deux seules petites différences : c’est à cet instant qu’elle prend un stylo, un papier, et commence à prendre des notes sur l’entretien ; de petits signes, de petites hésitations, montrent qu’il y a, par delà l’attitude et la distance professionnelle, de l’angoisse, manifestement. Enfin, alors qu’elle est elle-même assistante sociale, elle me suggère : « en fait, vous n’avez pas été entendue, à l’époque. Il faudrait que vous ayiez rendez-vous avec une assistante sociale ».
De ce premier entretien, je retiens pour ma recherche : l’usage spontané d’un vocabulaire professionnel (« signalement voisinage », pour qualifier le signalement), qui montre que cela doit être routinisé, fréquent, alors que, en revanche, « agression sexuelle » semble source, imperceptible, d’angoisse, doit donc effectivement être beaucoup moins ordinaire. Me marquent également le « mais vous travaillez, maintenant » : le reste, fondation d’une famille, etc, ne semblent pas pensés comme critère de bonne insertion sociale après une telle histoire. Le « vous vous faites / vous vous êtes fait aider ? », qui place la nécessité d’une « aide » (par un/e professionnel/le du psychisme, de toute évidence) suite à un tel vécu. Pensée du rôle du « psy » en termes « d’aide », d’étayage, de soutien, que j’avais déjà rencontrée auparavant dans mon parcours de victime, ainsi qu’ensuite dans mes entretiens pour mon master 1 : c’est le/la professionnel/le du psychisme pensé/e comme confident/e de choses trop lourdes pour être supportées par des ami/e/s, donc comme équivalent/substitut de l’aide amicale, et non le/la professionnel/le du psychisme pensé/e comme professionnel/le permettant plus spécialement l’exploration douloureuse d’un passé insupportable (Perrin, 2008, p 53 et suivantes). Enfin, mes propos sont interprétés immédiatement selon les « cases » procédurales, auxquelles je ne connais alors pourtant toujours rien : « on vous a proposé une mesure éducative, alors qu’en somme vous demandiez un placement ? ». Jamais je n’avais demandé de placement …
Sur un plan plus personnel, je suis ressortie de cet entretien avec en tête : « maintenant, je ne suis plus « usagère » soumise à leur pouvoir, je peux être ex-usagère qui demande des comptes, et donc je peux parler à égalité avec ces gens ».
Ce qui était un préalable nécessaire pour revenir, en tant qu’anthropologue cette fois, parler avec ces gens !
Après avoir écrit le courrier qu’elle me suggérait de rédiger, c’est avec une assistante sociale et la responsable du « service enfance » que j’aurai finalement un rendez-vous, courant janvier 2009. Il m’y sera confirmé qu’il n’y a aucun archivage des signalements lorsqu’ils ne sont pas suivis de mesures éducatives. L’entretien permet de se comprendre mutuellement, mes interlocutrices entendent le malentendu mortifère dans lequel l’inaction de leur service à l’époque m’a laissée : puisque pour tout le monde, ma famille et ce qui s’y passait était normal, pour moi, c’est cette violence et l’enfer que j’y ai vécu qui étaient normaux. « Oui, c’est vrai, pour un enfant, c’est ce que fait et dit le parent, la norme », reformule la responsable enfance. Par moments, la position de pouvoir revient, sur le mode, ferme, du « de toute manière, vous n’aviez rien à décider, puisque vous étiez mineure. C’étaient à vos parents de donner leur accord pour une quelconque mesure », commence l’une, immédiatement relayée par l’autre : « … ou alors, pour passer outre, il aurait fallu la preuve d’une situation de danger avérée, une urgence, et ça, la collègue ne l’avait pas, de toute façon ».
A cet instant, je me
vois replongée dans le sentiment d’oppression de cette époque, il y a 15
ans : je relis mentalement ce p… d’article du Code Civil « l’enfant
doit honneur et respect à ses parents » Jamais l’inverse, pour sûr !
Sur le minitel, sur lequel il s’affiche, désespérément, je cherche une issue.
« Emancipation » : raté. Cet article-là du Code Civil, au titre
pourtant prometteur, précise, certes, que « le ou la mineur/e » peut
être émancipé/e dès ses 16 ans. Mais uniquement par le mariage. Et …
uniquement, bien sûr, si ses parents sont d’accord. Impasse. Impasses. Haine
viscérale contre les adultes, tou/te/s les adultes, qui ont fait ces lois,
contre leur monde où je n’ai qu’un droit : obéir et me la boucler, car
mineure.
Quoi de plus semblable,
apparemment, à une « bête crise d’adolescence » qu’une telle révolte
contre l’autorité ?
Retour au
présent : l’entretien revient sur des bases égalitaires, tranchant avec
ces souvenirs, lorsque nous discutons, entre adultes, des questions qu’il
aurait fallu que leur collègue pose à l’époque, pour déceler ce qui n’allait
pas, et de mon travail universitaire de master 1 … un instant, à la fin de
l’entretien, dans cet élan, je pense même à leur demander si pour mon mémoire
de master 2 je ne pourrais pas avoir des entretiens avec certaines de leurs
collègues. Mais je me tais, pensant : « c’est déjà assez mélangé
comme cela, entre mon histoire personnelle et ce mémoire, sans en
rajouter ».
Qu’il est bon,
agréable, de discuter entre adultes gagnant un salaire. Qu’il est bon,
agréable, d’être enfin sortie de l’état de « minorité » et du
chômage. Et, traversant ce quartier porteur de souvenirs pesants, je tremble
encore à l’idée d’être à nouveau au chômage, ou de me réincarner plus tard en
enfant, en « personne mineure » … à la merci du pouvoir de ces
« adultes » qui se soutiennent toujours tou/te/s entre eux/elles, et
pour lesquel/le/s ma volonté, c’est du vent, du bruit, un caprice d’adolescente
ou d’enfant. Comme si je n’étais pas une personne, finalement.
Me voilà, au moins, en état d’oser contacter une maison du Rhône pour mon travail universitaire, maintenant. M’étant procurée la liste de toutes les maisons du Rhône via internet, j’en contacte une par téléphone. Je ne sais pas du tout comment m’y prendre, aucun organigramme n’étant accessible de l’extérieur : quel/le est le/la bon/ne interlocuteur/trice ? « Maison du Rhône », pour moi, est synonyme de boîte noire. Je sais juste, depuis mes entretiens personnels récents, que l’agent d’accueil standardiste semble aiguiller les demandes sans hésiter, donc qu’en interne, il existe des « circuits » bien rôdés.
C’est pourtant avec beaucoup d’appréhension que je me dirige vers le téléphone : en termes de préparation, très concrètement, il m’a fallu rédiger intégralement le texte de présentation de ma demande. Puis le relire à haute voix plusieurs fois, hors téléphone, les premières fois en bégayant horriblement ( !), jusqu’à parvenir, au bout d’un certain nombre de répétitions, à lire ce texte d’un ton naturel et assuré, en me disant : « c’est comme à l’atelier théâtre, ce n’est pas TOI, c’est un rôle à jouer ».
Au téléphone, mon interlocutrice écoute ma demande, prononcée de manière audible après tout cet entraînement, et m’explique la marche à suivre : envoyer un courriel à telle personne, responsable de cette maison du Rhône, dont elle me donne l’adresse électronique, puisque c’est une demande relativement urgente (sinon, un courrier aurait suffi).
Le 29 janvier 2009, j’envoie le courriel.
Puis, le 9 février, n’ayant toujours pas reçu de réponse, je décide de contacter une deuxième maison du Rhône : cette fois, je choisis d’y aller directement. Je suis néanmoins obligée de marquer une pause, avant de sortir de la station du métro. Pause à propos de laquelle je note :
J’ai l’impression d’avancer
cachée, qu’il ne faut pas que je leur dise l’objet réel, sinon …
L’objet réel ?
Voir, dénoncer, ce qui ne va pas chez eux. Leur naïveté complice envers ma famille, envers les familles
(Je les déteste, eux et leur silence gêné en réponse à mes demandes) (notes du 10/02/2009)
Ravalant ma haine ancienne et persistante, ainsi ravivée de façon intense et démesurée par le silence suite à mon courriel du 29 janvier, je sors de la station du métro et me dirige vers la maison du Rhône. Sur l’immeuble, dehors, je lis les horaires d’ouverture : il est 16h15, j’en ai mis du temps à arriver jusque-là … ça ferme dans un quart d’heure !
Arrivée devant l’agent d’accueil, il me faut répondre à la question, inévitable, de l’objet de ma visite. Cette fois, je n’ai pas préparé de texte … intérieurement, je me dis qu’il vaut mieux employer des termes plus courants et généralistes que « inceste ».
Je reste un instant
sans voix devant la banque d’accueil, les yeux fixés sur le cahier, et la
standardiste qui le tient.
(Il faut que je lui
explique pourquoi je suis là devant elle)
(Je reprends mon souffle,
cassé par les escaliers … seulement par les escaliers ?)
(notes du 10/02/2009)
J’explique donc : « Je suis étudiante et je fais un travail sur les enfants maltraités, et comme c’est ici que sont centralisés les signalements … je viens vous voir d’abord pour comprendre comment vous procédez avec tout ça ».
Après moult relectures de la documentation accessible depuis internet, j’avais en effet compris que les « informations préoccupantes » n’étaient pas centralisées dans les services centraux, mais bien dans chaque maison du Rhône, via un service particulier. Pourtant, impossible de comprendre lequel à partir de ces documents.
(Sophie, pourquoi tu
ne dis pas « et en particulier les cas d’abus sexuels sur
mineurs » ? Parce que j’ai peur de leur faire peur et d’essuyer un
refus direct) (notes du 10/02/2009)
L’agent d’accueil m’indique alors une salle située juste à côté de sa banque d’accueil, et comportant des bureaux : « il faudrait que vous voyiez avec le service enfance ». J’entre. Là, plusieurs employées de bureau, deux ou trois : elles ne se présentent pas, je leur répète l’objet de ma venue de la même façon qu’au standard.
Celle qui s’occupe de me répondre me précise alors qu’il faudrait peut-être plutôt que je puisse voir une assistante sociale, mais que là, il est tard. Elle me demande ce qui m’intéresse, me parle de leurs procédures : elles ont un classeur les expliquant. Dans l’espoir de couper court, je lui explique que j’ai lu les « guides pratiques – Protection de l’Enfance ».
Elle sort le classeur, les guides ne semblant pas lui parler plus qu’à moi ne me parle le fonctionnement de cette maison du Rhône … Elle me montre des fiches avec des procédures détaillées : je vois défiler toutes les mesures expliquées dans les « guides pratiques » que j’ai lus. « C’est peut-être la même chose que ce que vous avez lu ? », me fait-elle enfin. Je réponds oui. Mais elle ajoute ensuite : « c’est peut-être surtout celle-là, qui vous intéresse, en fait ? », me montrant la fiche de procédure « signalement ».
Comprenant qu’on ne parviendra pas à se comprendre, et que ma demande lui semble aussi peu claire qu’à moi le lieu où je suis là, je réponds oui à tout. Elle décide alors de noter ma demande sur leur cahier de transmission, pour que les assistantes sociales y répondent. A cette occasion, elle me demande en quoi je suis étudiante : « en anthropologie ». Surprise, elle m’explicite alors un élément du malentendu entre nous : « Ah ? C’est pas en travail social, alors ? ».
Cette première visite me permet de comprendre que, à la fois, il est peut-être habituel dans ces lieux de recevoir des étudiant/e/s pour des renseignements, et qu’il est inhabituel qu’ils/elles soient dans un autre cursus que le travail social. Je note encore l’importance des procédures, premier objet présenté à l’étudiante venue se renseigner. Je n’aurai, par ailleurs, jamais aucun retour de la part des personnes chargées de répondre aux messages du cahier de transmission. Ayant moi-même été agent d’accueil et administratif d’une agence ANPE, j’ai alors pensé : « demande qui ne rentre pas dans les circuits standard, donc elles ne savent pas plus que moi qui est l’interlocuteur à qui transmettre, donc il faudrait qu’elles transmettent à la direction, mais déranger spontanément la direction pour cela … ». Une deuxième visite, le lendemain, dans la maison du Rhône à qui j’avais envoyé ma demande par courriel, achèvera de me convaincre que le bon circuit, pour moi, était effectivement de passer directement par la direction, probablement seule à l’aise avec les demandes qui ne rentrent pas dans les circuits préétablis.
C’est ainsi que le lendemain, je me rends à la banque d’accueil de l’autre maison du Rhône. Là, je trouve la personne que j’avais eue au téléphone. Pas moyen de commencer à converser :
« heureusement que
j’ai pas trois oreilles, sinon j’aurais trois téléphones »
(notes du 10/02/2009)
commente l’agent d’accueil, en train de se débattre avec brio entre deux combinés différents, qui sonnent de concert, et … l’accueil physique proprement dit. En ancienne agent d’accueil standardiste, j’apprécie assez rapidement la charge du poste, et me dis que si dans cette maison du Rhône, les postes sont tous aussi intenses, ce qui est probable, j’ai peu de chances qu’on me donne du temps pour des entretiens. Je réalise aussi combien les différences sont importantes entre maisons du Rhône : autant celle du quartier où je résidais durant mon enfance, située dans une banlieue pavillonnaire d’agglomération, semblait calme et reposante, autant celle-ci, située en cœur de ville, semble … speed.
Entre deux sonneries, en pointillés, mon interlocutrice s’enquiert de ma demande : elle n’a nullement l’air étonnée du fait que mon courriel du 29 janvier n’ait pas eu de réponse en étant envoyé au secrétariat de Mme X (dont je ne sais toujours pas quelles sont les fonctions). Profitant d’un répit laissé par un des combinés, cependant que l’autre sonne, elle compose illico le numéro du secrétariat concerné, leur précisant bien qu’il s’agit « d’un courriel qui date de JANVIER », accentuant leur retard de réponse en ne précisant pas « fin janvier ». Mme X étant en réunion jusqu’à 15h, on va lui transmettre mon numéro, et elle me recontactera dès la sortie de sa réunion. La standardiste, continuant à voguer au milieu des sonneries téléphoniques, me précise qu’il m’a été demandé d’envoyer un courriel ou un courrier car « de toute façon, on ne prend aucune demande par téléphone, et il n’y a que Mme X qui peut décider ».
J’enregistre l’importance du respect des circuits hiérarchiques dans cette administration, qui du même coup, m’a de plus en plus un air familier : si ce n’étaient pas les maisons du Rhône, lieux locaux des services sociaux du département, ce seraient des ALE (Agences Locales pour l’Emploi), de l’ANPE. Donc il y a dans chaque maison du Rhône au moins un service administratif, dont j’ai rencontré un agent lors de ma visite de la veille, et les équivalents des conseillers à l’emploi : les assistantes sociales. Comme à l’ANPE, les procédures sont centrales et omniprésentes, avec un arrière plan de respect de textes juridiques incontournable, et, ce qui va de pair, une importance de la structure hiérarchique pour toute décision. D’un coup, je comprends que je ne suis pas en univers si étranger que cela.
En partant, j’aperçois,
scotché en bas d’une affiche, un petit autocollant, peu visible :
« en danger ? Appelez le 119 », ou « enfant en
danger ? Appelez le 119 » (notes du 10/02/2009)[29]
Bien sûr, Mme X ne m’a recontactée ni dès la sortie de sa réunion, à 15h, ni plus tard.
Quant à moi, il me fallait maintenant m’atteler à la rédaction d’un courrier type, à destination de « Monsieur ou Madame le directeur de la maison du Rhône ». Cette rédaction s’est, bien sûr, révélée aussi fastidieuse que mes premières prises de contact relatées ci-dessus, si bien que mes courriers furent envoyés aux différentes maisons du Rhône fin février. Ceci cependant que, avec autant de difficultés, je parachevais l’élaboration de mes grilles d’entretien.
Pour une des maisons du Rhône, j’ai pu écrire « de la part de Mme Y, assistante sociale », qui y connaissait la direction, Mme Y. ayant repris des études en anthropologie quelques temps auparavant. Je n’ai eu aucune réponse de cette maison du Rhône-ci.
En revanche, en date du 5 mars, je reçois une réponse négative d’une maison du Rhône, qui m’explique que ses professionnels étant « très sollicités et déjà surchargés de travail ne pourront pas vous accueillir ». Puis, en date du 10 mars, d’une autre maison du Rhône, un autre refus : « le contexte de découpage cantonal ne nous permet pas de donner une suite favorable », dans ce dernier courrier, on m’informe que « Néanmoins je transmets votre demande au service des Ressources Humaines du Conseil Général du Rhône pour étude ».
Chacun de ces courriers est signé à la main du directeur ou de la directrice, comme cela aurait été le cas aussi à l’ANPE : la signature manuscrite étant nécessaire pour qu’un courrier procédural ait valeur juridique, tous les courriers y étaient mis dans un « parapheur » que le directeur ou la directrice d’ALE signait à la chaîne, alors que dans l’administration où je travaille actuellement, aucun papier administratif n’est paraphé à la main, le « cœur de métier » de cette administration n’ayant que très peu à voir avec le respect de procédures et de textes.
Après encore quelques jours d’attente, je reçois cette fois un courriel, le 16 mars, d’une maison du Rhône qui m’informe qu’elle va me recontacter pour me proposer un entretien avec deux travailleurs sociaux pour courant avril.
Enfin, le 17 mars, je reçois sur mon répondeur un message téléphonique de la responsable enfance d’une autre maison du Rhône, et la rappelle, deux jours plus tard, dans les créneaux qu’elle m’a indiqués.
Mon courrier était assez vague quant à l’objet précis de ma recherche, ce qui s’est avéré un bon choix, puisque mon interlocutrice m’a posé deux questions :
1) « Est-ce uniquement sur les abus sexuels incestueux, ou sur la maltraitance de façon globale ? Car si c’est uniquement sur les abus sexuels incestueux, c’est non. » Par contre, elle est partante si c’est pour parler de la maltraitance en général, et m’ajoute en conclusion : « de toute façon, on n’a pas de cas d’abus sexuels intra familiaux ».
2) Ai-je envoyé ma demande à plusieurs maisons du Rhône, ou juste à la sienne ?
Je réponds « oui » aux maltraitances dans leur ensemble, pour la première question, me disant bien que sur place, des cas d’inceste seraient probablement retrouvés peu à peu. Et après avoir répondu à la deuxième question, j’apprends que la crainte de mon interlocutrice était que sa maison du Rhône soit « trop au centre » de mon étude : j’avais visé juste, en pensant qu’une monographie serait plus difficile.
Là aussi, des entretiens avec deux travailleurs sociaux me sont proposés. Une fois l’accord obtenu, tout s’avère très simple et flexible : est-ce que je préfère les voir ensemble ou chacun séparément ? Prise de rendez-vous immédiate avec celui qui est présent, l’autre me recontactera durant ses plages de présence pour fixer un rendez-vous. Je note qu’à aucun moment, il ne me sera d’ailleurs demandé, ici ou ailleurs, de papier signé de mes directeurs de mémoire ou toute autre preuve de ma situation. De même, aucun contrôle n’est exigé sur les entretiens ou l’archivage des enregistrements : ou bien c’est « non » tout de suite, ou bien on me fait confiance, et ceci pas à moitié.
Enfin, le 11 mars, je reçois par ailleurs un message téléphonique venant de la maison du Rhône au standard si speed : en effet, j’ai voulu voir quel serait l’effet dans ce cas précis du « courrier type » envoyé au directeur, après mon courriel au secrétariat de Mme X, laissé sans réponse, Mme X étant forcément une des subordonnées du directeur.
Re-contactant l’assistante sociale qui m’avait laissé ce message, me voilà gratifiée d’un, prévisible, « c’est pourquoi déjà ? », qui m’évoque, à tort ou à raison, une personne en charge de multiples dossiers simultanés comme une standardiste l’était de multiples combinés simultanés. « Recherche en anthropologie, sur l’inceste », ne suffisant pas à lever l’interrogation, j’ajoute « mon courrier … », ce qui suscite un « Ah, oui ! » éclairé en retour. Le bon dossier ayant été mentalement retrouvé, mon interlocutrice m’explique alors illico qu’en accord entre Mme X et le directeur de la maison du Rhône, ils ont transmis, après discussion, mon courrier aux services centraux du département, qui sauront (mieux ?) quoi et comment y répondre. Intéressante utilisation de la hiérarchie que celle qui consiste à déléguer … au niveau supérieur la charge de répondre à une demande, décidément, si embarrassante ici.
Mon interlocutrice prend soin de me préciser que normalement, ces services centraux vont me recontacter, et que s’ils ne le font pas, je peux la recontacter elle sans hésiter. Elle me donne, pour cela, son numéro.
En date du 24/03/2009, je reçois un courrier signé manuellement par le chef du service central concerné. Le courrier m’indique :
« Mademoiselle,
Vous avez choisi notre
collectivité pour effectuer un stage et je vous remercie de l’intérêt que vous
portez au département du Rhône.
J’aurais souhaité vous
donner satisfaction mais les services susceptibles de vous accueillir assurent
déjà la prise en charge de stagiaires. Or vous savez que la qualité du suivi
dépend de la disponibilité de votre encadrement.
Je vous souhaite bonne
chance dans votre recherche. »
Mon courrier me semblait pourtant explicite :
« Je cherche
maintenant à effectuer des entretiens (qui seront anonymisés) avec différents
professionnels qui ont pu être confrontés, dans l’exercice de leur profession,
à des mineurs ayant subi ce type d’abus. »
C’est cette demande, dans laquelle ne figure nulle part l’ombre du mot « stage », qui a été réinterprétée en « demande de stage » par le service central.
Le courrier suivant, en date du 01/04/2009, m’aide d’ailleurs à comprendre un peu moins mal le refus pour cause de « découpage cantonal » : il s’agit exactement du même courrier concernant ma « demande de stage », et il est signé, tout aussi manuellement, du même chef de service !
J’en conclus que mon courrier a bien été transmis par chacune des deux maisons du Rhône qui m’avait dit le faire, et qu’il a donc été reçu à deux reprises, à quelques jours d’intervalle, par les services centraux. Le fait que les réponses, identiques, aient pu être signées en double par le chef de service sans qu’il s’en rende compte, me montre que les « demandes de stage » doivent être courantes, et traitées « à la chaîne ». En revanche, les demandes d’étudiant/e/s en anthropologie en quête de simples entretiens semblent inhabituelles au point de ne même pas être audibles, puisqu’elles sont ainsi réinterprétées en « demande de stage », ce, deux fois de suite.
Même logique administrative à la Cité de l’enfance, lieu d’accueil d’urgence des mineur/e/s qui dépend du département : on m’oriente vers le bâtiment administratif et « la secrétaire », dont on ne me précise, bien sûr, ni de quoi ni de qui. Lorsque j’arrive vers elle, elle ne se présente pas plus : c’est en apercevant, en fin d’entretien, un parapheur au nom de « Mme Z » sur son bureau, que je comprendrai qu’elle est la secrétaire de la directrice. Durant la présentation qu’elle fait, à ma demande, des activités et de l’organisation de la Cité de l’enfance, elle me précise d’ailleurs « nous sommes en vase clos ». Ce qui m’explique un peu pourquoi mes interlocuteurs/trices ne pensent jamais à se présenter : entre eux/elles, qui ils/elles sont, c’est évident. Et là, je retrouve un comportement majoritaire dans l’administration où je travaille aujourd’hui, qui partage cette caractéristique de « clôture » sur elle-même, contrairement à l’ANPE, où il était inconcevable d’aborder quelqu’un d’extérieur autrement qu’en commençant par « bonjour, je suis Madame X, occupant telle fonction dans tel service ». La secrétaire, à ma demande, me donne la procédure à suivre pour être mise en contact avec des professionnel/le/s du lieu pour des entretiens : il faut que j’écrive à Mme Z, la directrice. Comme leur structure est divisée entre les « petits enfants » et les « plus grands », constatant que je ne m’étais pas posée la question du choix entre ces catégories, elle me suggère :
« affinez votre projet,
est-ce que ça va être plutôt sur les petits ou les plus grands
enfants ? » (notes du 11/02/2009, prises sur place)
Aurais-je, une fois de plus, été prise pour une étudiante en travail social sans m’en rendre compte ?
N’ayant toujours pas reçu de réponse à mon courrier mi-mars, je recontacte la Cité de l’Enfance, qui n’en a aucune trace dans ses fichiers : il a du se perdre, c’est très rare, m’explique-t-on. J’apporte alors une deuxième fois mon courrier, en mains propres, à la secrétaire, fin mars. Bien plus tard, toujours sans réponse, je téléphone une fois de plus : on m’apprend que cette fois, le courrier a bien été enregistré et traité. Du coup, on sait précisément où il est : au service psy, qui va me répondre, m’assure-t-on. En pratique, bien sûr, je n’ai eu aucun retour, mais me suis demandée comment et pourquoi ce courrier avait été orienté dans ce service précis, plutôt qu’un autre.
Les interprétations et orientations de mes courriers dans les services dépendant du département, dans un contexte de méconnaissance de l’organigramme de ces services de ma part, ont d’ailleurs été source de surprises pour moi. Ainsi, dans la première maison du Rhône où j’ai eu des entretiens, ma demande a été orientée vers des professionnels qui travaillaient au suivi des enfants et/ou parents faisant l’objet de mesures administratives ou judiciaires, tandis que dans la deuxième maison du Rhône, c’est vers deux assistantes sociales « de secteur », c'est-à-dire polyvalentes et nullement centrées sur le suivi des mesures de protection d’enfants, que j’ai été aiguillée. A chaque fois, c’est sur place et au fur et à mesure de l’entretien que j’ai compris quelles étaient les fonctions exactes de mes interlocuteurs/trices, et donc découvert qu’elles n’étaient nullement les mêmes … les premières questions de ma grille d’entretien portant, précisément, sur « en quoi consiste votre travail ? ».
Dans tous les cas, d’ailleurs, les personnes et groupes sur lesquels est transférée ma demande ne sont pas n’importe lesquels : services psychologiques à la Cité de l’Enfance, assistante sociale et infirmière lorsque je contacte des CPE en établissements scolaires, à l’exclusion des enseignant/e/s et surveillant/e/s auxquels mes interlocuteurs/trices ne pensent pas sur ce sujet.
Une assistante sociale de centre de planification familiale est la première, chronologiquement parlant, à me faire comprendre un peu ce qui se passe là, lorsqu’elle m’explique « oh, mais vous savez, j’ai eu seulement un ou deux cas dans ma carrière, je ne vais sans doute pas pouvoir bien vous aider ». Au cours de l’entretien, elle me citera les noms d’associations spécialisées locales, ou de spécialistes, ou encore la police spécialisée, qui, eux, ont de nombreux cas sans doute, et seront donc probablement plus intéressants pour moi.
Ainsi, les spécialistes dans la Cité de l’Enfance étaient certainement estimés être ce service psychologique. Ceux de l’éducation nationale : l’infirmière et l’assistante sociale. Ceux de la sphère associative : certainement pas un centre de planification familiale, mais telle association s’occupant d’enfance maltraitée ou de violence faite aux femmes.
Autre phénomène : le renvoi sur « plus expérimenté/e que moi » : renvoi de la jeune assistante sociale (« c’est mon premier poste ») sur une qui a plus d’ancienneté dans le métier, communication par un jeune psychiatre des coordonnées d’un psychiatre ayant plus de « métier » … donc plus d’expérience, plus de cas ?
Le paroxysme de ces phénomènes de renvoi fut certainement atteint via le circuit suivant : le CPE d’un établissement que j’avais fréquentée en tant qu’élève, absolument désolé de l’absence de réponse du chef d’établissement à mon courrier, se met en quatre pour me trouver des « tuyaux » de rechange. Parmi ces tuyaux, « l’ADES », une association qui fait un travail de prévention concernant la santé des jeunes.
J’arrive devant les locaux de l’ADES :
Là, affiche dans l’entrée,
qui, parmi d’autres mots-clefs, comporte « maltraitances ». Mais là,
quand je présente ma thématique de recherche – « maltraitances »
[prudemment, je reste dans ce flou] - mon interlocutrice, depuis sa table-bureau,
m’explique qu’ils montent des projets pour la santé des jeunes de façon
générale, mais que la maltraitance, « c’est quand même un peu spécial, et
il y a des spécialistes de cela qui existent déjà, donc on ne va pas se mettre
là-dessus vu qu’ils y sont déjà ».
Puis elle me propose d’aller
sur le site internet de l’ADES pour voir la liste de ces spécialistes :
elle me lit ainsi sur son ordinateur : « telle association de défense
des enfants » - « je leur ai déjà écrit ». « telle autre
association » - « Aussi ». « l’AFIREM » - « ils
ont un message sur leur répondeur ».
Et c’est tout …
Elle est désolée de ne rien
pouvoir faire de plus pour moi, et on se quitte là-dessus.
En sortant, je relis l’affiche
pour être sûre : oui, il y a bien marqué « maltraitance » parmi
les autres mots clefs, sur cette affiche de l’ADES.
(notes du 31/03/2009,
concernant ma visite du 24/03/2009).
Ainsi, même des associations affichant « maltraitance » parmi leurs préoccupations s’avèrent ne pas s’occuper en réalité de cette question.
Ainsi, parce que mes interlocuteurs/trices ne se sentent pas « spécialistes » de ce sujet décidément si spécial, je suis renvoyée sur « plus spécialiste qu’eux/elles ». Cela rend compte de leurs fréquentes habitudes de travail « en réseau », qui consistent à trouver des « relais » plus compétents quand ils/elles ne maîtrisent pas eux/elles-mêmes le sujet. De fait, les renvois m’orientent sur le circuit suivi dans une telle recherche de relais plus « spécialisés », ou bien sur les interlocuteurs/trices les plus centraux lors d’un signalement. Mais va à l’encontre de mes projets : voir non pas des spécialistes, mais des professionnel/le/s à peu près « quelconques » qui ont pu être confronté/e/s à des situations d’abus incestueux.
J’ajoute que les associations figurant sur la liste internet de l’ADES, déjà peu nombreuses, s’avèrent souvent petites, ou avoir une permanence téléphonique par mois (cas de l’AFIREM, qui regroupe et s’adresse à des travailleurs/euses sociaux). En outre, comme relaté à propos de celles s’occupant de venir en aide aux jeunes victimes, elles sont souvent plus spécialisées dans l’aide technique et matérielle pour la conduite d’une procédure juridique quand c’est possible, et/ou l’orientation sur des travailleurs/euses du psychisme si besoin, que sur la construction d’analyses du phénomène « maltraitance » ou « inceste » à proprement parler[30]. Enfin, pour revenir plus précisément sur la question des abus sexuels sur enfants, parmi elles, les associations qui affichent « conduite d’actions de prévention dans les écoles » ne le font pas toujours en réalité, faute de personnes et de dynamique suffisante pour cela.
Finalement, à l’issue de ces renvois, je suis restée perplexe sur qui s’occupait réellement de mieux comprendre comment lutter contre la maltraitance et, plus particulièrement, contre les abus sexuels incestueux. Peut-être les professionnel/le/s du psychisme, sur lesquels avait été renvoyé mon courrier à la Cité de l’Enfance, étaient-ils/elles les spécialistes de la réflexion sur ce sujet ?
Mais, tout comme mon courrier était resté là lettre morte, c’est dans cette profession que je me suis le plus heurtée au silence. Ici, même pas de renvoi sur « plus spécialiste que moi ». Ici, on ne sait rien, ou si peu.
Une première tentative de prise de contact, faite via une enseignante de la faculté de psychologie, aboutit à un de ses collègues (« écrivez-lui de ma part »). J’attends toujours l’ombre d’une réponse de ce collègue à mon courriel, envoyé fin février 2009.
Devant cet échec, je décide de prendre l’annuaire « pages jaunes », déchire la page comportant les coordonnées des « médecins : psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Puis d’en appeler quelques un/e/s au hasard, en expliquant : « Bonjour, je suis étudiante en master 2 recherche anthropologie et je travaille sur l’inceste. Dans ce cadre, je cherche à avoir des entretiens avec des professionnel/le/s qui peuvent être confronté/e/s à ces situations dans le cadre de leur profession », donc notamment des psychiatres pour enfants. Après quatre appels, effarée, épuisée, je me suis arrêtée. J’ai pris en note, immédiatement après chaque appel, l’essentiel des réponses de mes interlocuteurs/trices :
Premier psychiatre pour
enfants : « j’en ai rarement. Je ne vous serai probablement pas d’une
très grande utilité ». Je lui réponds en lui précisant que ce sont des
entretiens, enregistrés, anonymes, et que tous mes interlocuteurs ont eu
« un, deux ou trois cas, pas beaucoup plus », donc que j’ai
l’habitude (et que c’est la norme), puis je lui propose de lui laisser mon
numéro de téléphone, « le temps de la réflexion car là c’est un peu à
brûle pourpoint sans doute », afin qu’il me recontacte si ça l’intéresse
d’y participer. Il le prend en note.
Deuxième psychiatre pour
enfants (une psychiatre) : à peine ai-je fini de me présenter,
que la réponse fuse « je n’ai pas le temps de recevoir des étudiants en ce
moment, je suis complètement débordée ».
Je lui propose de …
« …là, je suis en entretien » … lui donner mon numéro de téléphone.
Sa réponse :
« envoyez-moi un courrier ».
Troisième psychiatre pour
enfants (une psychiatre) : « Pour l’instant, je n’ai pas cette
situation en soins, donc je ne peux pas vous aider ».
« Vous n’en avez pas eu,
c’est ce que vous voulez me dire ? »
« Oui »
« Au revoir » -
« Au revoir ».
Quatrième psychiatre pour
enfants (une psychiatre) : « Je n’en ai pas actuellement »
« Et par le
passé ? »
« Je n’en ai pas eu, je
crois que je n’en ai pas eu … attendez que je réfléchisse. Non, je n’en ai
pas eu. Enfin pas que je sache. Il se peut que j’en ai eu sans le détecter,
mais non, je n’ai pas eu de personnes pour des pathologies et me parlant de ça.
Désolée »
(extraits de mes notes du lundi 23/03/2009)
J’ai mis quelques jours à assimiler ces réponses, sources d’ultimes désillusions pour moi : qu’une psychiatre n’ait « pas de temps » à consacrer à des étudiant/e/s est une chose bien compréhensible. Mais constater qu’une personne se pose « en direct » la question du « j’ai peut-être des cas comme cela, mais je ne le sais pas », semble-t-il parce que je la lui pose … c'est-à-dire comprendre que, peut-être, cela ne lui était jamais venu à l’idée auparavant … Bien sûr, j’avais passé plusieurs années de mon enfance à aller toutes les semaines chez une de ses collègues, durant les années 1980. Ce, durant les années où je subissais moi-même ces abus sexuels, et pas un instant, ceci n’a pu être rendu pensable dans ce lieu, qui était donc devenu un lieu de silence, physique, palpable, pesant, interminable, entre elle et moi. Comprendre que plus de 20 ans plus tard, ses collègues « tiré/e/s au hasard » dans l’annuaire, ne pensaient pas plus qu’elle cette éventualité, m’a fait un choc, replongée dans une sorte de désespoir impuissant.
Malgré cet état de désespoir, j’ai rédigé un courrier, que j’ai fait très précis, et envoyé à toutes les coordonnées présentes dans l’annuaire, soit une vingtaine d’adresses.
Le premier psychiatre appelé, qui ne pouvait pas m’aider parce qu’il avait trop peu de cas, n’a jamais donné suite ni à cet appel, ni au courrier qui l’a suivi. Finalement, j’ai reçu en tout et pour tout une réponse à ces courriers, d’une psychiatre intéressée par participer à mon travail car elle avait notamment « des enfants petits » qui lui étaient amenés dans ce cas de figure. Il s’avère qu’elle avait elle-même rédigé un travail, plus ancien, sur le sujet des abus sexuels entre enfants d’âges proches : ce n’est donc pas « n’importe quel/le » professionnel/le qui m’a répondu là.
Souhaitant appréhender un peu moins mal le contenu des nombreuses non réponses, j’ai donc relancé quelques praticien/ne/s début avril 2009. Voici leurs réponses telles que je les ai prises immédiatement en notes :
Une psychiatre pour
enfants : « J’ai été débordée, j’ai pas eu le temps de m’en occuper,
je suis désolée » (je lui propose de me rappeler si elle est intéressée,
on se dit au revoir [bien sûr, je n’ai jamais été recontactée ensuite])
Une secrétaire [de
psychiatre] : « J’en sais rien [si on a reçu votre courrier], il
faudrait rappeler le médecin ». Elle me donne ses horaires de demain.
Une secrétaire [de
psychiatre] : (une fois le thème du mémoire – inceste – cité)
« d’accord. Je lui laisse le message en tout cas, hein ».
Un psychiatre pour
enfants : a bien reçu mon courrier, n’est pas intéressé, c’est d’ailleurs
pour ça qu’il ne m’a pas répondu.
Je lui demande :
« vous n’avez pas de personnes dans ce type de cas ? »
Il me répond :
« Non, non non ».
Un psychiatre pour
enfants : il lui est arrivé que des parents avaient eu des problèmes
incestueux, mais il reçoit surtout des enfants, et parmi les adultes, il n’a
pas eu le cas pour l’instant (il n’est pas encore très expérimenté). Il me
donne les coordonnées d’un collègue à qui il a précisément envoyé une mère dans
ce cas. (notes du jeudi 09/04/2009)
Rapidement fatiguée par ce que je venais encore d’entendre, je n’ai contacté ensuite ni collègue, ni médecin durant ses horaires du lendemain.
Ces réponses, sauf la dernière, m’ont apporté assez peu d’informations nouvelles : des secrétaires ne savent pas ce qu’il en est des courriers parvenus au cabinet dont elles sont secrétaires, un psychiatre qui n’est pas intéressé n’a, de surcroît, bien sûr pas de cas. Mais en aurait-il eu deux ou trois, que cela n’aurait pas beaucoup pu m’aider bien sûr. Bref, parler des abus sexuels incestueux à une anthropologue pour une recherche n’intéresse pas, sauf exception, les psychiatres pour enfants, pour ne pas dire pire. En outre, ce n’est pas vraiment un sujet qui concerne les psychiatres pour enfants : soit on n’avait pas imaginé cette éventualité (avoir un cas comme ça) avant qu’une étudiante téléphone, soit on ne l’imagine toujours pas. Le dernier psychiatre pour enfants cité est ici caricatural : puisque je m’occupe d’enfants, je ne peux avoir de tels cas !
Il resterait d’ailleurs ici à savoir ce que recouvre l’expression « problèmes incestueux », ou encore « une mère dans ce cas », pour ce praticien.
Ainsi, au milieu de tous les écrits sur l’interdit de l’inceste, le complexe d’Œdipe, etc, le réel de l’inceste semble aussi impensé (ou à éviter) pour ces psychiatres pour enfants, qu’il l’est en anthropologie au milieu de tous les écrits sur la prohibition de l’inceste et des différents types prohibés (premier degré, second degré …).
Cherchant à diversifier mes entretiens, j’avais dans le même temps pris contact avec un « pôle CMP », c'est-à-dire un service qui chapeaute et dirige plusieurs Centres Médico-Psychologiques sur un territoire donné. Ceci dans l’optique d’obtenir un entretien avec un/e pédopsychiatre (ou psychologue) travaillant cette fois non pas en profession libérale, mais en tant que salarié/e du service public de santé mentale.
Premier bureau. (…)
J’explique. C’est pour une recherche universitaire, sur l’inceste, je cherche
des pédopsychiatres. Elle me dit que ce n’est pas ici l’accueil pour cela, mais
juste en face.
Elle contacte par téléphone
le bureau d’en face : « c’est une étudiante pour une recherche (elle
ne dit pas l’objet de la recherche) ». (…) En face, on prend ma demande en
note sur une feuille de papier format A4 avec mon numéro de téléphone :
elle le transmettra à la responsable de pôle qui se nomme [nom].
Je lui demande s’il existe
d’autres pôles comme celui-ci. Elle me dit que oui, me demande si je préfère
qu’elle me les trouve/donne tout de suite ou que la responsable me les file
quand elle me contactera. Je lui réponds qu’il n’y a qu’à attendre que la
responsable me recontacte.
(notes du 31/03/2009, à propos du 23/03/2009)
A ce jour, je n’ai toujours pas été recontactée par la responsable. J’ai ainsi appris l’intérêt qu’il y aurait eu à accepter de suite que l’on me fournisse les coordonnées d’autres pôles, sans attendre le retour d’une responsable ! Heureusement, j’ai pu quand même avoir accès à une professionnelle du psychisme travaillant en CMP, via mes connaissances personnelles et non via cette institution qui ne m’a finalement pas répondu.
Pour donner une idée de l’impact important sur moi des retours reçus par les professionnel/le/s du psychisme dont je reproduis les propos plus haut, voilà ce que j’ai noté fin avril, soit plusieurs semaines après ces conversations téléphoniques :
Cela fait donc un mois,
quasiment, que je n’ai pas réussi à prendre de notes.
Trop violent.
Les rappels de psys.
Trop violentes. Les
réponses.
« Ca ne m’intéresse
pas ».
Pauvre type.
Pauvre de moi surtout …
(notes du 25/04/2009)
La violence a d’ailleurs été pour moi une constante de ce travail. Violence des refus, des non réponses, puis violence des récits faits durant certains entretiens. Comme des coups reçus, à chaque fois.
Quant à la psychologue que je connaissais, elle a été parmi les personnes les plus demandeuses de renseignements préalables : s’il ne s’agissait bien sûr pas ici d’avoir des preuves de mon identité, comme un papier signé par les enseignant/e/s dirigeant ma recherche, il m’a été en revanche demandé :
- de pouvoir lire mon mémoire de master 1 avant l’entretien, et en fait elle m’a expliqué, le jour de l’entretien, n’avoir pas eu le temps d’en lire plus que quelques pages finalement
- si l’entretien portait bien uniquement sur le plan professionnel : cette dernière demande reste énigmatique pour moi aujourd’hui encore.
Je précise que nous ne nous connaissions pas plus qu’avec mes autres relations militantes ou universitaires, et que, comme mes autres relations récentes du monde militant ou universitaire, elle était au courant des grandes lignes de mon histoire de victime d’inceste.
Les contraintes dues à la prise de contact par l’intermédiaire d’institutions ou administrations, les orientations sur des « plus spécialistes que soi », « plus expérimenté/e que soi », ainsi que celles sur « nulle part » ont créé un corpus d’entretiens qui, s’il s’était agi d’un échantillon quantitatif, aurait été fortement biaisé. Parmi les « zones d’ombre », toutes les personnes qui peuvent recevoir des confidences, des révélations, mais ne sont pas des nœuds centraux du circuit du signalement ou bien du réseau des relais spécialisés.
Devant mes difficultés pour trouver des interlocuteurs/trices en passant par des institutions ou l’annuaire, j’ai heureusement pu compter sur des professionnel/le/s que je connaissais, sur des rencontres et des discussions notamment lors de réunions universitaires ou encore militantes. Cela m’a permis d’accéder, en plus de la psychologue travaillant en CMP auprès d’enfants et adolescent/e/s, à une enseignante et une assistante sociale en lycées professionnels, ainsi qu’à une assistante sociale et une conseillère conjugale en centre de planification familiale. Je n’avais aucunement pensé à cette dernière profession pour ma recherche, et cette opportunité s’est avérée un entretien très riche. Hormis la psychologue travaillant en CMP et l’assistante sociale scolaire, toutes ces personnes sont dans mon corpus d’entretien par le hasard de nos rencontres.
C’est dans le cadre d’une réunion universitaire que je rencontre une personne du centre de planification familiale, qui est volontaire pour relayer ma demande d’entretiens auprès de ses collègues. C’est ainsi qu’elle me propose, à l’issue de leur réunion, deux personnes à contacter : une assistante sociale et une conseillère conjugale.
Toutefois, le numéro téléphonique de l’assistante sociale s’avérant être celui du standard, un dernier obstacle m’attendait …
J’aboutis au standard, auquel
je dis « Sophie Perrin, étudiante en anthropologie, je cherche à joindre
Mme X, de la part de [nom de mon intermédiaire], car je fais un mémoire sur
l’inceste ».
Elle me répond qu’ils en ont
rarement, que c’est pas leur spécialité (mais elle va faire barrage ou
quoi ?).
Je rétorque tout de go :
« C’est rare partout et ça arrive partout, voyez ». Ce qui débloque
illico la situation : « Je vais vous chercher Mme X, je vous la
passe ». (notes du 18/03/2009).
Ouf, obstacle franchi. Obstacle qui me rappelle une étrange idée que j’avais au tout début de cette entrée sur le terrain : l’idée selon laquelle si je prononçais le mot « inceste », on risquait de me dire « non » illico. Une étrange idée, vraiment ?
L’assistante sociale me répond alors :
« C’est pour votre
questionnaire ? »
Puis elle enchaîne :
« dans ma carrière, j’ai eu un cas d’inceste, qui a abouti à une grossesse
non désirée et IVG. C’était par le demi-frère ». Puis elle aussi me dit
que c’est rare, ça fait pas beaucoup. Je lui réponds que « mes
collègues » du master pro d’anthropologie, pour celles qui étaient en
reprise d’études, ont toutes rencontré « quelques » cas dans
l’exercice de leur profession, mais aucune beaucoup. Je cite l’exemple de celle
qui est en maison de retraite.
Là, d’un coup, mon
interlocutrice s’exclame : « Ah, oui ! En fait j’en ai deux, de
cas, mais je sais pas si c’est un inceste, la deuxième ». Elle commence de
nouveau à me raconter, mais je l’interrompt : on ne va pas faire
l’entretien au téléphone, prenons plutôt RDV. (…) Et en finissant, elle me dit
qu’en fait, elle a eu trois cas. (notes du 18/03/2009)
Etranges oublis. Un peu plus tard, c’est après plus d’une heure d’entretien avec moi qu’un éducateur travaillant dans une maison du Rhône où il y avait des enfants maltraités, mais pas incestés, se rappellera d’un cas d’inceste rencontré durant son stage, et qu’il avait entièrement oublié jusqu’à cet instant. Et c’est lui-même, qui lorsque nous nous quittons, me répète : « il serait intéressant de travailler sur l’oubli ». Judicieuse observation … Etranges oublis, mystérieux pour moi autant que pour lui, mais récurrents. Comme si mon intervention ramenait ces histoires-là hors de l’oubli. Etrange rôle que le mien. Des entretiens semi-directifs ? Seulement ? Comment prétendre à la neutralité de l’enquêteur ici, alors que ma présence et mes questions ont un tel impact mnésique, parfois dès la première prise de contact téléphonique ?
Le numéro de téléphone donné pour contacter la conseillère conjugale est bien sa ligne directe. Elle semble avoir de nombreux cas et vouloir tout naturellement m’en parler.
Le hasard d’une conversation dans un lieu militant fait aussi que j’y rencontre Francine, que je n’avais pas revue depuis plusieurs années.
Il me faut préciser ici que la rédaction de mon mémoire de master 1 m’avait obligée à franchir des pas sur un plan plus personnel. Notamment, à informer par un courriel, le premier mai 2008, l’ensemble de mes connaissances militantes des motifs de mon absence à cette manifestation : j’en avais assez de prendre, à chaque grande manifestation, le risque de croiser mon incesteur, lui aussi militant. Moyennant ce courriel, j’ai pu reprendre la rédaction du mémoire, devenue jusqu’alors extrêmement douloureuse, ce qui m’avait contraint à l’interrompre pour agir en envoyant cette information.
Francine faisait partie des destinataires de mon courriel.
C’est donc tout naturellement qu’elle me parle, ce soir-là, de mon travail de recherche, que ça l’intéresse, que sa fille, qui est étudiante en psychologie, pourrait être intéressée aussi, et … de proche en proche, elle se met spontanément à me raconter en détails l’histoire de l’élève dont elle me reparlera plus tard devant un magnétophone. Puis m’évoque une autre histoire : celle d’un ami connu par elle depuis la fac, qui a été condamné à près de 10 ans de prison pour ce qu’il a fait. A force de tant de détails, je peste à voix haute de n’avoir pas ici mon magnétophone, tant et si bien que nous finissons par convenir d’un rendez-vous pour que je puisse enregistrer son récit.
Mais après cette discussion, je vais faire mes courses, et là, dans le magasin, suis obligée de faire une pause parce que, événement qui surgit rarement au hasard, dans une sorte de bouffée d’angoisse, je me mets à saigner du nez.
Mes contacts pour ce mémoire avec les deux personnes que je connaissais depuis longtemps seront marqués de phénomènes de ce genre : angoisses, somatisations diverses.
La deuxième personne dans ce cas de figure, précisément, était le CPE d’un des établissements où j’ai été élève. C’était la seule personne à avoir compris que j’avais ce qu’il appelait des « problèmes familiaux », alors que pour tout le reste du personnel, ma famille était on ne peut plus normale. Je me souvenais de sa facilité à parler des problèmes de maltraitance subis par les enfants ou adolescent/e/s, de son intérêt pour ces questions. C’était encore une histoire difficile, que cette nécessité de retourner en ce lieu : pour lui dire mon histoire à moi en privé, ou pour avoir un entretien pour mon mémoire de master 2 ?
En octobre 2008, lorsque, dès ma soutenance de master 1 effectuée, je retourne dans cet établissement où je ne suis pas venue depuis tant d’années, je peux me permettre de ne pas bien savoir.
Pour moi, tout est
resté figé dans le temps, figé à l’époque où j’étais élève là. Et d’un coup,
par cette visite, le temps s’est comme remis en mouvement, a franchi les années
qui se sont écoulées. Franchit les années de la vie d’un chat qui était à peine
né à l’époque, et qui finit sa vie pendant que je commence ce mémoire … D’un
coup. Entre le moment où je suis entrée et celui où je suis sortie de cet établissement,
en octobre 2008, d’un coup, toutes ces années sont passées. J’ai presque de la
chance qu’il soit encore là, le CPE : la liste est longue de tous les
gens partis à la retraite, subrepticement, durant mon absence …
Dans le fil de la
conversation, mon histoire à moi ne trouve pas de place, mon travail de
recherche, si. Alors ce sera mon travail de recherche.
De retour chez moi, j’ai noté qu’il m’avait dit que de nombreux enfants avaient des problèmes de maltraitance, également en centre-ville, mais que c’était moins connu car il existait une autocensure de ces enfants. Ces enfants donnent des signes : ils se comportent souvent comme des zébulons en cours. Et j’ajoute : mon interlocuteur me parle ici de violences physiques, ne pensant pas, a priori, que les maltraitances puissent être des abus sexuels.
Lorsque je décide de revenir le voir comme nous avions convenu en octobre, courant février 2009, je crois donc que je me prépare à y retourner pour lui expliquer l’objet exact de mon travail, et lui demander s’il est possible d’avoir un entretien avec lui, et/ou avec d’autres membres du personnel de cet établissement.
J’avais prévu d’y aller le
matin, d’arriver juste après la récréation de 10h pour bien être là pendant une
heure « creuse », où on peut discuter tranquille.
Mais le matin, une fois le
réveil entendu, lorsque je tente de me lever, le monde est vacillant, tourne
légèrement, me donne la nausée.
Je m’assieds lentement sur le lit, garde les yeux fixés sur quelques planches du plancher, me concentre dessus pour tenter d’arrêter leur course, de les immobiliser. J’y arrive un peu, et peux donc me lever entièrement. Le monde continue néanmoins d’être instable, menace de tanguer à chaque pas, me donne le mal de mer (…). Quelle poisse. Pourquoi ce matin ?
Je subodore pourquoi.
D’ailleurs, je vois.
Au milieu de ma nausée, toutes
les images reviennent, de moi et cet établissement, jadis. (…)
(Larmes. Je ne vais pas
pouvoir y aller comme prévu ? Il va falloir que je lui dise ?).
Il va falloir que je lui dise
… sacrifier mon terrain potentiel à cette révélation ?
Et je ne peux pas le faire
après avoir eu un entretien avec lui ?
Réponse du monde :
« je tangue, et tu as la nausée ».
(notes du 25/02/2009 à propos
du 24/02/2009).
Réponse pour le moins claire du monde : tant que je ne me serais pas résolue à y aller pour lui dire, il continuera de tanguer, scénario connu par cœur de ma part.
Sur mon chemin (toujours vacillant), un accès internet me permet de reprendre pied en « vidant mon sac » d’images de ce passé via différents mails
Heureusement, ça marche
[comprendre : le monde arrête enfin de tanguer]. Je vais y aller … pour le
début d’après midi, tranquille, vu l’heure qu’il est.
(ça me fait mal d’écrire … que
tout ça est réel …)
(…) Images qui reviennent en
écrivant, du collège, du lycée, de l’école … de ma vie dans tout ça … de
pourquoi elle a été comme ça (…) (notes du 25/02/2009)
Arrivée dans son bureau, ma prise de notes, plusieurs fois interrompue et reprise, relate :
(Suite, ou tentative de suite :
c’est vraiment du puzzle reconstitué, là …)
Je lui rappelle notre
discussion sur mon mémoire, la dernière fois (octobre 2008). Il me demande sur
quel sujet c’est exactement (coincée) je lui réponds que le mieux, c’est de lui
montrer par quoi et comment j’ai commencé en master 1.
Je prends ma pochette, que je
sors de mon sac.
Je sors le mémoire de ma
pochette, et lui montre le titre, la couverture [« L’inceste :
anthropologie d’une entreprise de démolition systématique de la
personne »].
Mon interlocuteur change de
face. Prend, d’un coup, un air assombri.
(Pêle-mêle : )
« Ah … l’inceste. On en a
de temps en temps. Le dernier, c’est récent ». (dit assez tôt, voire en
premier : ) « mais il y a le secret professionnel ».
Je lui explique comment j’ai
procédé avec le juge d’instruction [que j’avais vu lorsque j’étais en
licence] : je lui ai demandé, et on a discuté ensemble, à la fin de la
cassette, des modalités d’anonymisation (…).
Il me dit que le chef d’établissement est « un peu spécial », et qu’il vaut mieux lui envoyer un courrier pour avoir son feu vert (…). Il n’y a plus d’assistante sociale dans l’établissement : juste une infirmière qui est là une fois, ou deux, dans la semaine, et en temps partagé avec plein d’autres établissements. (notes prises le 01/03/2009, à propos du 24/02/2009).
Après avoir convenu du contenu du courrier, et discuté de l’histoire récente survenue dans l’établissement, je me retrouve au fil de son récit sur ce cas dans un état de plus en plus désagréable, ce qui était prévisible :
Je sentais mes doigts s’engourdir, l’angoisse monter, et je me sentais devenir blême
(notes du 01/03/2009 à propos du 24/02/2009)
Ce qui me conduit à lui préciser, cependant qu’il range l’exemplaire de mon mémoire de master 1 que je lui ai prêté : « dans la première page, je parle de moi. Après, tout le reste du mémoire, je parle des autres ». C’était la révélation lettre à la poste. Etonnant, mes doigts sont d’un coup libérés de leur gangue, l’angoisse retombe, mon visage a du changer de couleur plusieurs fois puis a l’air enfin redevenu normal … Ouf. Etonnant, mais tellement habituel …
Lorsque je rapporte le courrier rédigé, le CPE m’informe que le chef d’établissement souhaiterait lire le mémoire également avant de me répondre. Une fois de plus, en mon for intérieur, je regrette la première page. Tant pis. Le chef d’établissement le lira, et fuira ou non.
Le chef de cet établissement plutôt typé « centre ville », avec une bonne réputation, n’a jamais répondu à mon courrier, que ceci soit en lien avec une fuite devant le contenu de mon mémoire, un refus de mettre « trop au centre » d’un tel travail cet établissement jouissant d’une bonne réputation, par manque de temps et d’intérêt pour me faire une réponse, ou pour toute autre raison que, dans le silence du mutisme, j’ignore à jamais.
C’est par ce CPE que j’ai pu être mise en relation avec la jeune assistante sociale qui travaillait ponctuellement dans l’établissement. Et c’est cette jeune assistante sociale qui m’a renvoyée sur sa collègue plus expérimentée qui travaille en lycée professionnel.
Je ne peux m’empêcher de remarquer la zone d’ombre qui subsiste alors, de fait, sur les établissements d’enseignement général dans mon mémoire. Une autocensure sur les maltraitances subies par les enfants de « centre ville » ? Vraiment ?
Je laisse subsister là le point d’interrogation, ne pouvant interpréter plus avant les silences rencontrés : un deuxième CPE, contacté par courriel en me recommandant d’une enseignante de l’université, m’avait répondu avoir transmis ma demande à l’assistante sociale et à l’infirmière de son collège, situé en banlieue. Mais je n’ai eu de retour ni de cet assistante sociale, ni de cette infirmière.
Enfin, j’ai cherché à contacter certaines des associations spécialisées sur la question des enfants maltraités. Je vais donner deux exemples, opposés, de ces prises de contact. A chaque fois, j’avais déjà eu des premiers contacts fin 2007 dans le cadre d’une recherche de stage.
Le premier exemple est l’association au sein de laquelle j’ai eu d’une part un entretien où m’a été présenté le fonctionnement de l’association, d’autre part un entretien enregistré avec une bénévole.
J’ai contacté cette association tout d’abord par téléphone : j’étais restée sur le souvenir de bons contacts, exclusivement par téléphone puisque, en 2007, c’est par téléphone qu’un bénévole m’avait expliqué qu’ils n’avaient pas une assez importante masse de dossiers pour que ce soit intéressant de faire un stage chez eux. En revanche, si je voulais une présentation de l’association et de ses activités, c’était tout à fait possible de prendre rendez-vous pour cela durant une des permanences : il suffisait que je rappelle.
Je rappelle donc pour demander une présentation de l’association, dans un premier temps. Présentation à l’occasion de laquelle j’apprends qu’hormis des élèves infirmières, car elles ont un module de formation sur la maltraitance, et des lycéen/ne/s parfois, pour des travaux sur ce thème, il est très rare qu’on vienne ainsi leur demander une présentation de leur association. Et que je suis donc la première étudiante à le faire.
Le rendez-vous pour cette présentation se situe durant mes premières prises de contact avec des maisons du Rhône, et j’en sors plus à l’aise pour contacter ces dernières ou d’autres institutions, car je me rends compte que « ça se passe bien », puisque je peux utiliser mon mémoire de master 1 dans la discussion quand nécessaire, ce qui m’évite de placer un « oui mais dans mon expérience (de victime d’abus) à moi, ça n’était pas comme ça ». En effet, je peux prendre les exemples de ces personnes là à la place. Ainsi, j’évite tout risque de « basculement » personnel du statut d’anthropologue dans le statut de « victime ».
Comme mon interlocuteur conclut par un « si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous recontacter », après beaucoup d’hésitations car j’avais encore du mal à oser demander des entretiens, je décide de procéder par courrier. C’est suite à ce courrier que je suis recontactée par une bénévole pour un entretien.
Autre association, issue radicalement différente : il s’agit de celle, déjà mentionnée plus haut, où j’avais eu un entretien pour un éventuel stage fin 2007. Tout en me demandant si dans une petite association, moins de deux ans après, il était réellement possible que « l’anthropologue victime d’inceste qui travaille sur l’inceste » ait été oubliée, j’ai voulu au moins tenter. Peut-être allais-je pouvoir être perçue comme « une anthropologue qui travaille sur l’inceste », simplement ?
Pour cette prise de contact-là, j’ai attendu d’avoir eu la présentation de la première association, et ai procédé ici par courrier. J’ai envoyé cette demande autour du 9 mars.
Fin mars, toujours aucun retour, qu’il soit positif ou négatif : je téléphone, on m’informe que le courrier est « sur le bureau de la présidente », et qu’elle rentre le 31 mars.
Fin avril, toujours aucun retour … la même personne, au téléphone, me demande de rappeler « lundi à 9h » car la présidente sera là. Il se trouve qu’à 9h, ce lundi-là, je suis en train de chercher un Vélo’V pour me rendre à un entretien un jour de grève des bus inopinée, et bien sûr, le Vélo’V est un objet particulièrement rare les jours de grève. Matériellement, je ne peux appeler dans ce créneau. Tant pis. Je rappelle donc le lendemain, mardi 21 avril.
Et là, je saisis la gravité, extrême, du non respect du créneau indiqué :
J’explique de nouveau qui je
suis, pourquoi j’appelle. Réponse : la présidente n’est pas là, je vous
avais dit de rappeler lundi à 9h. Non, je ne peux rien vous dire de plus tant
qu’elle n’est pas là. Non, je ne sais pas quand elle sera là la prochaine
fois : je la vois samedi, et là je saurai mais pas avant. Il fallait
appeler lundi à 9h elle était là. Et puis vous voulez quoi exactement ?
[Je réponds : ] Ca fait
deux mois que j’ai envoyé mon courrier, et je n’ai toujours aucune
réponse ! C’est pourtant pas sorcier de répondre au moins
« oui » ou « non ».
Elle m’informe qu’ils ne
répondent plus aux courriers d’étudiants car ils en reçoivent trop.
Je lui rétorque :
« la maltraitance est un sujet de recherche si populaire ? ».
Sa réponse : en psycho et
en droit, il y a beaucoup d’étudiants qui cherchent des stages, et peu de lieux
de stages.
Je lui fais remarquer que moi,
ce n’est pas pour un stage, mais juste pour des entretiens.
Elle me demande
[encore …] ce que je veux exactement.
J’explique : des
entretiens sur l’expérience de bénévole dans ce domaine de l’enfance
maltraitée. J’ai eu des entretiens avec des gens de l’éducation nationale, du
Conseil Général, des psys … et au final, c’est un comble, pas un seul avec un
membre d’une association spécialisée dans la lutte contre la
maltraitance !
Elle accuse un peu le coup,
puis me fait remarquer le peu de différences entre eux et mes autres
intervenants.
Je lui réponds qu’ils n’ont
pas les mêmes « cas », eux et le Conseil Général [maisons du Rhône],
et que c’est ça qui m’intéresse. Je développe en expliquant qu’ils ont les
familles avec un parent protecteur et le CG les autres, celles dont eux ne
peuvent s’occuper.
Mon interlocutrice me répond alors, ulcérée : « mais nous ne sommes pas en concurrence avec le CG ! Nous collaborons entièrement avec eux ! ». Je lui réponds que je n’ai pas dit ça du tout. La conversation s’échauffe alors, mon interlocutrice veut conclure : « excusez-moi, mais j’ai du travail ! ». Ainsi s’achève ma conversation avec « l’association parano ». Je mets le restant de l’après midi à m’en remettre. (notes du 27/04/2009).
Et décide d’arrêter là les frais avec cette association-ci, me rendant compte de comment moi-même je m’emporte dans mes interactions avec elle. Encore une fois, je m’aperçois d’ailleurs de l’impact sur moi d’un refus sur ce sujet, puisqu’il me faut réellement tout l’après midi pour sortir d’un état indescriptible où je me martèle de « je suis trop nulle », « je vaux pas qu’on me réponde », « je suis rien qu’une merde » suite à cette conversation.
Sans doute, mon courrier est-il encore, quant à lui, sur le bureau de la présidente. Ce qui me conduit à souligner la diversité des fonctionnements associatifs : ici, une hiérarchie très importante, incontournable, rien ne peut être fait sans passer par elle. Alors que dans l’association où j’ai pu être reçue le fonctionnement semble beaucoup plus collégial : les dossiers (ainsi que les courriers tels le mien) sont traités par tout le monde, les bénévoles les plus ancien/ne/s ayant semble-t-il surtout un rôle d’instruction, de formation « sur le tas » des plus récent/e/s.
Par ailleurs, alors que le bénévole qui m’a reçue insistait sur le fait que eux ne sont pas des professionnels, je constate que la secrétaire de cette autre association affirme ne pas voir de différence notable entre « eux » et la liste de professionnel/le/s que je viens de lui citer. Bien sûr, ce pourrait être un moyen de se débarrasser de ma demande si agaçante et étrange. Mais son interprétation de ma réponse montre qu’effectivement, il n’y a pas de différence notable, donc je pourrais même m’imaginer, horreur, qu’il y a concurrence entre eux et le CG … !
Un dernier point est, précisément, le caractère étrange de cette demande : puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de stage, qu’est-ce que je peux bien vouloir exactement ? Ma demande d’entretiens, et non de stage, semble extrêmement difficile à comprendre ici, peut-être un peu comme elle l’a été pour les services centraux du département également, les conduisant à la réinterpréter en quelque chose d’audible : une demande de stage, précisément ...
Finalement, ces prises de contact montrent tout d’abord le caractère incongru, voire inaudible, de mes demandes dans la plupart des sphères professionnelles ciblées : la rencontre avec un/e anthropologue est aussi exceptionnelle que celle avec un/e mineur/e victime d’abus incestueux ! Dans un certain nombre de cas, « l’anthropologue » peut être assimilée en étant ramenée à des schémas plus habituels : l’étudiante en travail social et son mémoire professionnel, doublé bien sûr de son incontournable, et bien embarrassante, demande de stage ; l’étudiante, peut-être étudiante en psychologie, qui souhaiterait avoir un entretien avec un/e praticien/ne surbooké/e : autant de figures existantes et dans lesquelles je me suis, de fait, laissée glisser. D’autre part, mon thème d’étude était lui-même difficilement audible : non pas la profession de ces personnes, comme par exemple l’a fait Delphine Serre, et auquel cas j’aurais pu être assimilée à une sociologue du travail social ; non pas les situations, les « cas », rencontrés dans l’exercice de ces professions, ce qui pouvait me faire ressembler à une étudiante en travail social, mais les réactions des professionnel/le/s à ces situations. Qui plus est, ces situations, nommées sous le terme « inceste », étaient exceptionnelles. Parler de « maltraitances » pouvait alors ramener ma demande à un domaine moins exceptionnel, la maltraitance étant un problème social, contrairement à l’inceste.
Néanmoins, les « maltraitances » sont elles-mêmes un problème social bien encombrant : une affaire de spécialistes. Par delà les affiches qui utilisent le terme de façon inspirée peut-être du marketing, en réalité, peu d’instances et d’associations s’occupent réellement des maltraitances. Le mot est en réalité souvent détourné pour qualifier des situations d’écart des mineur/e/s aux normes : absentéisme scolaire suite à une séparation des parents, entrée dans la délinquance, questions de santé des mineur/e/s … et l’anthropologue se trouve, quant à elle, aiguillée sur le même circuit qui est indiqué aux incesté/e/s : vers telle association, ou telle profession, ou tel/le collègue, plus spécialiste, plus expérimenté/e que moi ou nous, en la matière. Mais une fois arrivée au bout du circuit, l’anthropologue, comme les incesté/e/s, se trouve d’une part devant de petites associations reposant intégralement sur le travail de bénévoles, d’autre part devant « les psys », qui s’avèrent parmi les plus silencieux/euses ou fuyant/e/s dès lors qu’il s’agit de parler de cela, ou, simplement, d’imaginer qu’un/e mineur/e reçu/e en cure pourrait être concerné/e.
Sur cette thématique, si l’anthropologue peut parfois avoir le sentiment de ressembler, tel/le un/e incesté/e, à une « patate chaude » transférée à des relais, il faut en outre remarquer que la méthode de la « boule de neige » pour obtenir des entretiens sur le sujet « maltraitances/incestes », auprès des professionnel/le/s, s’avère absolument vaine. La boule de neige s’effrite et se désagrège dès le premier maillon de transmission ! C’est ainsi qu’aucun entretien avec un/e professionnel/le n’a débouché ensuite, dans les faits, sur une recommandation vers des collègues. Les intermédiaires institutionnels ont été, sauf au Conseil Général, d’un silence remarquable en réponse à mes demandes. Seuls les intermédiaires constituant des relations de sympathie personnelle ont été, parfois, des relais efficaces. La sympathie personnelle a d’ailleurs également été, dans plusieurs cas, le seul moyen efficace d’accès à certain/e/s professionnel/le/s pour des entretiens …
Enfin, par delà toutes ces caractéristiques communes, ce qui est frappant, c’est la diversité des univers professionnels et associatifs traversés. Entre l’administration qui voit le monde à travers le prisme des procédures et de collectifs hiérarchisés les appliquant, chacun/e ayant sa place bien définie dans ce système, et une pédopsychiatre exerçant seule en cabinet libéral, quels points (et quel langage) communs ? Entre l’association qui fonctionne comme un collectif collégial, où les plus ancien/ne/s ont un rôle de formation « sur le tas » des nouveaux/elles, et celle qui fonctionne en mode hiérarchique strict, présidentiel, pourrait-on dire, il y a également un monde.
Et c’est dans ce monde si divers, que la parole nommant les abus incestueux comme constituant des abus, va avoir à se trouver un chemin. C’est pourquoi, afin d’étudier quand et comment s’effrite le silence, il nous faut tout d’abord visiter et appréhender plus précisément cette diversité.
IV - Quand le silence s’effrite : communiquer le secret
Elle me reçoit dans son
bureau.
Au milieu, l’outil de
travail central : l’agenda. Toujours grand format, souvent ouvert, où l’on
case les gens.
« DRING ! »,
le téléphone sonne, j’appuie sur la touche « pause » du magnéto :
« je suis en entretien, tu peux me rappeler dans X minutes ? »,
ou bien « je suis en entretien, attends, on peut se voir … (trouver un
trou dans l’agenda déjà bien rempli) ». Puis parfois : « je vais
demander qu’on ne nous dérange pas ».
Le bureau, orné, décoré, de papiers avec diverses procédures administratives,
et d’illustrations plus personnelles.
Du moins, quand il existe un bureau personnel : au centre de planification familiale, par exemple, je suis installée, avec mon interlocutrice, tantôt dans « tel bureau disponible », tantôt déménagée, en cours d’entretien, dans le local cuisine – photocopieuse, car ce jour-là, à cette heure-là, il ne reste plus de bureaux disponibles. Le lieu et la temporalité de la majorité des entretiens apparaissent ainsi contraints, et pour moi, et pour le ou la professionnel/le.
L’exemple le plus extrême est sans doute, à cet égard, Irène, qui, malgré l’agenda grand format et le bureau, n’est pas travailleuse sociale, mais pédopsychiatre en exercice libéral. Elle me propose de me recevoir un samedi à 8h du matin. Nous arrivons en même temps à son cabinet. Elle me fait patienter … dans la salle d’attente, le temps de … ? Peut-être le temps de la préparation rituelle de son cabinet, de poser ses affaires … « Entrez ». Me voilà assise devant un bureau, à la place du patient, puisqu’elle, a pris sa place habituelle. Le magnétophone, pourtant mentionné dans le courrier confectionné pour elle et ses confrères/consœurs, fait d’abord un peu tiquer mon interlocutrice, ce qui cesse lorsque je lui rappelle que « ce sera anonymisé ». Et puis, surtout, l’entretien se termine à son initiative : « mais je crois qu’il faut qu’on s’arrête là », dit-elle, dans une formulation qui pourrait elle aussi ressembler à une formule de fin de séance. En effet, Irène m’a reçue avant son premier patient du samedi matin, et il est, précisément, l’heure de sa séance.
Fabrice, Francis et Micheline me reçoivent chacun/e dans leur bureau, où je suis installée à la place de l’usager/e, et présentée implicitement comme telle pour l’extérieur (« je suis en entretien, là »). Pourtant, là non plus aucune confusion : je ne connaîtrai pas les malheurs d’un Samuel Lézé, personne ne m’a transformée en « patiente au magnétophone » ou « usagère au magnétophone ». Ouf …
Pourtant, sous forme de jeu, Fabrice me reçoit d’abord en se positionnant comme questionneur : il mène l’entretien, en bon professionnel de l’entretien qu’il se sait être, me demandant qui dirige mon travail, si je suis « dans les bons réseaux » à l’université pour entrer en doctorat, de quelle « école » anthropologique je suis, etc, pour m’expliquer au final : « non parce que vous comprenez, j’aime bien savoir à quelle ethnie appartient mon interlocuteur ». Habile clin d’œil. Nous enchaînons, d’un commun accord, sur les choses sérieuses : le décor se met alors en place, à sa demande. Stylo, feuille avec les questions, magnétophone. Pour un entretien réduit à un créneau d’une demi-heure, Fabrice ayant dû auparavant décaler l’heure prévue pour notre rencontre. Mais à la fin de la demi-heure, il me propose de lui-même, si je suis disponible, de nous revoir pour répondre à « la suite » de mes questions. Nous nous revoyons dans un « trou » de son emploi du temps, un peu plus tard dans la journée, pour une deuxième et dernière partie d’entretien, à l’occasion de laquelle je lui rapporte ma bibliographie de master 1, comprenant que les livres de sciences humaines l’intéressent, et que, peut-être, après toutes ses études (bac+5 en sciences humaines), il n’a pas pu faire de doctorat et aurait pourtant bien aimé.
Pour mes contacts avec les travailleurs/euses sociaux, je n’avais pas précisé avant l’entretien qu’il serait enregistré. Le magnétophone n’a pourtant jamais posé problème ici. Francis, lui, me répond tout simplement, quand je le lui montre et l’informe que ce sera anonymisé : « ça ne me pose pas de problème, je l’ai fait pour mon mémoire moi aussi ». Nous voilà partis pour 2h20 d’entretiens …
Cependant que je vois les dizaines de minutes défiler, sur l’écran du magnétophone numérique, nous sommes occupés à évoquer cette famille rencontrée alors qu’il était stagiaire, et dont il se souvient enfin, après 1h20 d’entretien avec moi. C’est alors que, au bout d’un temps infini, dans un réflexe d’employé de bureau habitué à utiliser l’ordinateur présent, il prend la souris, et, d’un clic, rallume l’écran qui s’était mis en veille, commentant : « quelle heure est-il, au fait ? ». Largement l’heure de manger, lit-il alors, en bas à droite de l’écran : nous terminons l’entretien, dont ni lui ni moi n’avions prévu qu’il durerait si longtemps.
Fabrice et Francis travaillent dans la même maison du Rhône. L’un est éducateur, l’autre assistant social, mais ils exercent grosso modo les mêmes fonctions : suivre les parents et/ou les enfants dans le cadre de mesures d’aide éducative, qu’elles soient à la demande des parents (« mesures administratives ») en difficultés avec leur enfant, ou à la demande du juge des enfants (« mesures judiciaires »). Ils dépendent de la responsable enfance de leur maison du Rhône, et s’inscrivent donc, de façon individualisée (ils ont leur bureau personnel et leurs « suivis » chacun), dans un collectif de travail hiérarchisé. Ils travaillent également en lien étroit avec les instances judiciaires, auxquelles eux ainsi que la responsable enfance sont subordonnés dès lors qu’il y a mesure judiciaire.
Avec Micheline, j’entre dans un établissement scolaire. Il me faut passer par l’accueil, où l’on m’indique le chemin vers son bureau, lui aussi individuel, et qui jouxte celui de l’infirmière. Ce premier rendez-vous se conclut rapidement par une nouvelle prise de rendez-vous : je suis arrivée en retard, et Micheline a de son côté prévu un créneau d’une demi-heure alors que je lui avais annoncé une heure d’entretien. Elle s’aperçoit d’ailleurs qu’elle voudrait peut-être plus d’informations sur « le cadre », donc je lui explique mon travail, et elle réalise que « peut-être serait-il bon que j’aie l’aval de ma hiérarchie ». Nous nous retrouvons quelques jours plus tard pour une heure d’entretien, qui commence, à mon initiative, par une discussion autour du magnétophone, et autour de mes entretiens avec « des victimes d’inceste » pour mon mémoire de master 1 … nous discutons ainsi « entre » professionnelles de l’entretien, cependant que je m’installe sur la chaise prévue pour les élèves, et déploie le reste de mon matériel.
Micheline, contrairement à Fabrice et Francis, voit uniquement des jeunes, et ce pour tous types de demandes. Aide financière, confidences … le champ de son intervention est vaste, le nombre d’élèves du lycée également. Elle est pour cela présente toute la semaine, à plein temps, ce qui n’est pas la règle actuellement dans tous les établissements.
Hélène et Françoise sont assistantes sociales de secteur dans une maison du Rhône. Cet entretien se déroule vers la fin de toute la série de mes entretiens pour ce mémoire : je n’ai alors aucune envie d’y aller, d’entendre encore de nouvelles paroles éprouvantes. Je sature. En effet, la temporalité contrainte des entretiens ne me permet pas de choisir d’étaler les dates des rendez-vous à ma convenance, contrairement à mes entretiens avec les incestées. Ici, on m’a proposé une date en avril, que je ne me permets pas de faire reporter vu l’intervalle de temps important qui s’est déjà déroulé entre ma demande initiale et ce rendez-vous. Auquel j’arrive en retard, malgré moi : d’une manière typique, sans m’en rendre compte, j’ai pris systématiquement les rues dans le sens inverse à celui que je lis sur mon plan … tant et si bien que, le temps d’arriver à remettre mon sens de l’orientation à l’endroit et mes pieds dans la bonne direction, l’heure prévue pour l’entretien s’est transformée en (petite) demi-heure potentielle. Cerise sur le gâteau, à la fin de l’entretien, Hélène et Françoise me hèlent depuis l’entrée de la maison du Rhône : « vous avez oublié ceci ». « Ceci », c’est, tout simplement, le magnétophone avec tous les entretiens dessus … récupérant mon magnétophone, je pars en me disant « heureusement que c’était le dernier entretien de la série, il était temps que ça s’arrête ! ».
Hélène et Françoise décident de nous installer dans la « salle parents enfants », ornée de traces enfantines telles meubles de taille réduite, ou jouets, ou dessins. C’est un entretien collectif, à leur initiative que je n’ai pas discutée, et c’est l’unique entretien collectif de mon corpus. Rétrospectivement, j’ai l’impression que, durant cet entretien, j’ai eu beaucoup plus accès à « la norme » qu’aux pratiques concrètes de chacune : si j’avais eu Francis et Fabrice en entretien collectif, j’aurais eu la parole de l’institution, mais pas les souvenirs que Francis avait occultés jusque-là, par exemple. Il a été frappant pour moi d’entendre comment elles se rectifiaient l’une l’autre : par exemple, lorsque l’une emploie l’ancien terme, « signalement », l’autre complète : « information préoccupante, maintenant, on dit information préoccupante ». Ce n’est que lors de la réécoute puis de l’utilisation des entretiens qu’un second fait m’a frappé : l’enchaînement souvent formé par leurs propos, l’une poursuivant l’idée de l’autre avant même que celle-ci ait terminé sa phrase.
Le travail d’Hélène et Françoise est généraliste : « tous publics, tous problèmes », me résument-elles de façon concise et précise. La Protection de l’Enfance fait partie de leurs missions, parmi bien d’autres missions. En fait, leur travail est essentiellement de recevoir les gens qui viennent les consulter, pour des aides par exemple, et qui dépendent de leur secteur géographique, d’où le terme « assistante sociale de secteur », l’intitulé complet étant d’ailleurs « assistante sociale polyvalente de secteur ». Bien sûr, certaines familles sont « connues » car elles ont souvent besoin des services sociaux. C’est parfois dans ce cadre qu’Hélène et Françoise détectent d’autres problèmes, en sus de ceux dont viennent leur parler les gens. Enfin, ce qui nous intéresse plus précisément : elles sont celles qui, localement, reçoivent la fiche « information préoccupante » transmise au Conseil Général (donc, matériellement, transmise à une maison du Rhône) par un médecin, une assistante sociale scolaire ou de planning familial, etc. Elles doivent alors rencontrer la famille, plusieurs fois en général, la puéricultrice de la maison du Rhône devant, de même, rencontrer l’enfant concerné. Il s’agit là pour elles de produire une « évaluation » de la situation, donc un rapport écrit, qui doit sauf exception être lu à la famille. Ce rapport est transmis à leur responsable avec une proposition (placement, aide éducative, ou rien du tout, par exemple).
La dernière assistante sociale de mon corpus est Laurence, qui travaille en centre de planning familial depuis environ 20 ans. A l’inverse des précédent/e/s, elle travaille dans une structure non hiérarchisée, et me signale d’ailleurs, d’un ton peut-être un peu narquois, qu’elle n’aurait jamais pu travailler en maison du Rhône. Elle fait partie de l’équipe polyvalente du planning familial, et à ce titre accueille les gens qui y viennent pour des demandes d’IVG, de contraception ou d’information sur la contraception, de pilule du lendemain, etc. Elle fait là le même travail que les conseillères conjugales du centre de planification, et s’en différencie par sa connaissance des circuits adaptés pour l’accès aux droits ou encore effectuer un signalement, alors qu’une conseillère est plus spécifiquement formée à l’écoute. Elle m’explique, plus précisément, que « derrière » des demandes classiques de contraception, se cachent des situations de précarité pour lesquelles l’écoute d’une conseillère conjugale doit alors être complétée par l’action d’une assistante sociale.
Cécile est, précisément, conseillère conjugale. Elle est rarement présente dans les locaux du centre de planification, puisqu’elle travaille essentiellement dans des établissements scolaires (du privé, notamment), avec lesquels le planning familial a des accords. Elle y anime des séances d’éducation à la sexualité pour les élèves adolescent/e/s. Elle tient également une permanence tous les quinze jours, dans un lieu situé hors de ces établissements, et où les élèves peuvent ensuite venir s’informer, discuter, poser des questions. Ceci, dans un secteur géographique couvrant des zones rurbaines et rurales. Nous prenons rendez-vous pour un créneau qui se situe durant sa plage hebdomadaire de présence au centre de planification. L’entretien débute dans le même bureau que celui où s’était déroulé celui avec Laurence, puis à la demande d’une collègue, nous déménageons dans le local cuisine qui jouxte la photocopieuse. Cet endroit étant doublement le lieu de vie collectif du centre (par la présence de la photocopieuse et celle de la cuisine), nous sommes fréquemment interrompues jusqu’à la fin de l’entretien, que nous concluons, à l’initiative de Cécile, par une discussion non enregistrée autour d’un thé partagé.
Patricia est la dernière personne que je rencontre. Il s’est écoulé un intervalle de temps de plus d’un mois entre mon courrier fait à son association et notre entretien. Ici, la charge d’activité étant moindre, il n’y a pas d’agenda sur le bureau. L’entretien se déroule durant une des permanences de l’association. Une permanence ordinaire, de celles propres à décourager les nouveaux bénévoles : pas de passage, pas de coups de fils pour appeler à l’aide non plus. Patricia participe à l’association depuis 2 ans. Durant une partie importante de l’entretien, le bénévole, présent depuis plus longtemps, et qui m’avait présenté les activités de l’association, règle des affaires diverses autour de nous, concernant l’administration de cette association. Occasionnellement, il participe de fait à l’entretien, sur l’invitation de Patricia lorsqu’elle estime qu’elle n’a pas assez d’ancienneté, d’expérience, pour bien savoir répondre.
Ici, bien que j’aie pris les devants, tout comme pour les pédopsychiatres libéraux/ales, en écrivant dans mon courrier que les entretiens étaient enregistrés, le magnétophone s’avère problématique … une fois mis en marche, mon cadrage ayant peut-être ouvert la porte à la question.
L’anthropologue – Hop. [magnétophone allumé] Donc cet
entretien il a lieu dans le cadre de mon mémoire de master 2 d’anthropologie
qui se fait à l’université Lyon 2, heu, sur le thème de l’inceste tel qu’il est
rencontré par différents acteurs qui travaillent en lien avec l’enfance, donc
l’enfance maltraitée, euh, c’est enregistré, ça sera anonymisé dans le mémoire,
et les enregistrements c’est uniquement moi qui, qui y ai accès et qui les
traite, puisque la voix elle est pas anonyme. Donc c’est pas obligé de répondre
à toutes les questions que je vais poser, si y’en a qui posent problème, euh,
et je vais pas non plus, c’est pas un questionnaire rigide, je vais pas non
plus les poser à la file, comme je vous le disais, ça sera plutôt au fil de
l’entretien.
Patricia, bénévole
associative - Et pour quelle raison vous préférez enregistrer plutôt que de
prendre des notes ? (d’un ton qui laisse entendre : « je n’ai
pas trop envie, moi »).
Anthropologue – Alors.
Parce que prendre des notes le problème c’est que ça, forcément vous retenez
pas tout, et en plus vous retenez avec un filtre. Puisqu’il y a ce que la
personne a voulu vous dire, et y’a ce que vous en retenez, déjà en prenant des
notes, voyez.
Patricia – Hmmhmm.
Anthropologue - Donc forcément
vous déformez ce que la personne elle a voulu dire.
Patricia - Ah bon.
Anthropologue – eh … ben oui, ça, c’est, donc, enfin vous
retenez pas tout, vous déformez, vous transformez, et bon, c’est vrai que pour
être un peu rigoureux, on a besoin d’avoir ce que les gens ont voulu dire, y’a
déjà suffisamment de malentendus possibles comme ça, sans rajouter nos propres
déformations en filtre de la prise de notes.
Pour une présentation
d’association, ça va, mais dès qu’on est sur de, de l’entretien, c’est pas
forcément …
Patricia - Comme vous
voulez. (rires, je ris aussi, et nous commençons)
Patricia travaille en tant que bénévole, dans une petite équipe (entièrement bénévole) où personne ne suit un dossier en particulier. Au contraire, les dossiers sont suivis par la personne qui tient la permanence à ce moment-là, qui peut donc changer selon les moments. Elle rencontre des parents qui viennent demander « quoi faire » lorsqu’ils réalisent qu’un autre parent maltraite, voire abuse sexuellement, leur enfant, ou bien que l’instituteur/trice, le prof de musique particulier, etc, s’avèrent s’être comportés de ces manières vis-à-vis de leur enfant. Comme Fabrice et Francis, elle s’occupe donc principalement de familles où des enfants ont subi des actes graves. Comme eux également, elle travaille en articulation étroite avec le système judiciaire, son premier rôle étant d’inciter les signalant/e/s à porter plainte, son rôle suivant étant de suivre leur dossier lorsque la plainte est en cours …
Christine travaille en revanche dans un domaine très éloigné du système judiciaire (sauf lorsqu’il y a des injonctions de soin) : le soin psychologique. Elle exerce dans un CMP (Centre Médico-Psychologique), c'est-à-dire dans le cadre du service public de santé mentale. Le CMP couvre un secteur géographique, et les patient/e/s habitant ce secteur peuvent être suivis gratuitement via le CMP. Les activités du CMP incluent, notamment pour les mineur/e/s, des possibilités d’activités thérapeutiques en groupes. Les CMP sont des collectifs, plus ou moins strictement hiérarchisés selon les périodes et les endroits. Ainsi, si là où elle exerce actuellement, Christine suit « ses » familles en tant que psychologue, autant que le font les psychiatres, dans d’autres CMP où elle a travaillé, ou à d’autres périodes, il a été important que chaque catégorie se distingue par ses activités, les psychiatres devant se situer « au-dessus » des psychologues. Si les formes prises par la hiérarchie varient, il n’en reste pas moins que, manifestement, le médecin-chef est chef : fondamentalement, le CMP constitue une équipe, hiérarchisée. Christine me décrit le fait de participer à une équipe comme constituant un plus par rapport à l’exercice en libéral tel que le pratique par exemple Irène, où il n’y a pas l’appui et l’apport du collectif.
L’entretien a lieu chez elle, après un long échange de nouvelles réciproques sur nos univers communs, et la présentation du chat du logis, Christine ayant repéré que j’aimais bien les chats. L’entretien n’est borné que par les échéances personnelles de Christine, puisqu’il se déroule en week-end. Il dure 1h40, mais aurait pu être plus long encore, s’il n’avait, précisément, dû être interrompu par une telle échéance.
Enfin, Francine est enseignante en lettres-histoire dans un lycée professionnel. Son travail n’est pas du tout de s’occuper de mineur/e/s maltraité/e/s. Elle donne cours à des classes, principalement constituées de garçons dans ce lycée. Certaines comportent de faibles effectifs et, de surcroît, lui sont attribuées plusieurs années de suite. Dans ce contexte bien particulier, elle en arrive à bien connaître ses élèves, au fil du temps, et me relate d’ailleurs les propos d’un père qui lui disait : finalement, vous les voyez plus longtemps que moi, dans la journée, mes enfants.
L’entretien a lieu chez moi, après un long échange de nouvelles réciproques sur nos anciens univers communs. Il est parfois brièvement interrompu par les excuses de Francine auprès du chat du logis, très âgé, qu’elle a le sentiment d’empêcher de dormir en faisant bouger son canapé lorsqu’elle me parle … cependant que l’animal, lui, s’ingénie au contraire à se lover le plus près possible de l’épicentre des secousses. En bruit d’arrière-plan, on entend parfois du thé qui se verse dans une tasse, qui ponctue la discussion. Discussion qui se poursuit, de manière informelle, une fois le magnétophone éteint.
Francine n’aurait pas eu, en tant qu’enseignante, de bureau pour me recevoir. Son travail est essentiellement individuel devant ses classes, même si elle peut être en liens avec ses collègues de l’équipe enseignante à son initiative ou à la leur, essentiellement pour échanger autour d’élèves, mais pas pour préparer des cours en commun. La hiérarchie, hormis via une inspection de son cours de temps en temps par l’inspecteur et l’imposition par les textes de « programmes » que doit suivre le cours, s’avère très peu présente dans ce travail autonome.
Finalement, cette diversité des professionnel/le/s (et bénévoles) rencontré/e/s peut s’articuler autour de trois axes :
- le rapport à un collectif, une équipe de travail, globalement assez bien retranscrit par l’usage du « je » et du « nous » (ou « on »).
- La distance au monde judiciaire et policier, qui a des conséquences sur le statut des paroles entendues (paroles à écouter, ou paroles qui doivent faire agir mais sont, du même coup, souvent questionnées quant à leur crédibilité).
- Le fait de suivre des personnes sur une durée qui permet de les connaître, ou au contraire d’être majoritairement un agent ponctuel dans leur vie.
Ainsi, Micheline, assistante sociale scolaire, Laurence, assistante sociale en centre de planification familiale, Hélène et Françoise, assistantes sociales de secteur, emploient le plus souvent le « nous », ou le « on », pour me parler de ce qu’elles font ou doivent faire professionnellement : « on », « nous », les assistantes sociales ?
Irène, pédopsychiatre libérale, emploie très souvent le « on », par exemple pour dire « quand on voit des enfants », « quand on voit des adultes ». « on » : nous, les pédopsychiatres ou les psychiatres.
Christine alterne souvent entre « on », « nous » et « je », mais le « on » et le « nous » semblent se rapporter à l’équipe concrète du CMP, plutôt qu’à un corps professionnel.
Puis il y a tou/te/s ces professionnel/le/s qui emploient le plus souvent « je » : Cécile, conseillère conjugale qui travaille en autonomie, via ses permanences en zone rurbaine et rurale, tout en faisant partie du centre de planification. Fabrice et Francis, qui ont chacun leur bureau et leurs « suivis » personnels. Francine, qui a ses classes et ses cours. Mais aussi, fréquemment, Patricia, qui a pourtant une activité on ne peut plus collectivisée, dans l’association où elle est bénévole.
Puis suivent les positionnements professionnels : Laurence nous expliquait que la différence entre elle, assistante sociale, et une conseillère conjugale, c’était qu’elle était formée aux procédures administratives, tandis que la conseillère conjugale était plutôt spécialisée dans l’écoute.
Plus précisément, nous pouvons regrouper l’ensemble des personnes employées par le Conseil Général : Francis, Fabrice, Hélène, Françoise ; ainsi que Micheline, assistante sociale scolaire, Laurence, assistante sociale en planning familial, et Patricia, bénévole associative. Nous avons ici des assistant/e/s social/e/s, un éducateur et une bénévole dans une association spécialisée sur les maltraitances. Tou/te/s, lorsque leur est apportée une parole de mineur/e relatant des violences (sexuelles ou non) subies de la part d’un parent, se positionnent en terme de mesures, de signalement à faire ou non dans ce cas précis, de parole à croire ou à mettre en doute … ou encore à refuser de mettre en doute car ceci, ce sera le rôle de la police.
Ensuite, en position peut-être intermédiaire, nous trouvons Cécile, conseillère conjugale, qui écoute, mais tout en incitant les jeunes qui lui confient avoir subi des violences sexuelles à porter plainte, d’une part, à se faire suivre par un/e spécialiste de l’écoute : un/e « psy », d’autre part. Elle ne pose jamais la question de la crédibilité des paroles qu’elle reçoit.
Irène, Christine et Francine n’ont aucune connaissance ni des procédures administratives, ni du système judiciaire. Irène et Christine écoutent leurs patient/e/s sans jamais poser de questions autour de la crédibilité de ce qu’ils/elles lui rapportent, ni proposer d’agir (plainte, signalement …). Francine se positionne également en écoutante des élèves qui en ont besoin, même si elle me précise bien que ce ne doit pas être son rôle principal. Et, pour Christine et Francine, il existe une défiance manifeste vis-à-vis de la police, Christine craignant le « viol de la confidentialité », Francine redoutant le « fichage policier des élèves », par exemple absentéistes, au nom du sécuritaire.
Ainsi, soit nous nous situons plutôt dans un registre d’écoute, où le/la mineur/e est cru/e, mais il n’y aura pas forcément d’action. Soit dans un registre d’action, mais la parole du/de la mineur/e devient alors elle aussi inscrite dans un crible judiciaire, et donc suspectée.
Enfin, une partie des personnes rencontre dans le cadre de relations régulières les gens dont elle s’occupe : Irène et Christine, en tant que professionnelles du psychisme. Francine, lorsqu’elle a des élèves plusieurs années de suite et finit par bien les connaître. Francis et Fabrice, qui suivent des parents ou des mineur/e/s dans le cadre de mesures.
Mais si Cécile fait peut-être, là encore, figure d’intermédiaire, par la régularité de ses permanences qui peuvent la mettre en lien suivi durant longtemps avec des jeunes, la situation des autres professionnel/le/s s’avère bien différente.
Laurence, Hélène et Françoise, Micheline, Patricia, ne suivent pas des personnes, mais traitent des situations, servent de relais et d’intermédiaires vers d’autres personnes ou instances. Même si certain/e/s usager/e/s deviennent des « habitué/e/s des services sociaux », ou du planning familial, ou du bureau de l’assistante sociale scolaire, ou de la permanence associative, cela induit un rapport différent aux usager/e/s.
C’est dans ce « paysage » très diversifié, que vont émerger, ou non, hors de la sphère familiale, les paroles nommant et dénonçant les abus sexuels incestueux subis.
Dorothée Dussy et Léonore Le Caisne (2007, p 13-30) remarquent que
la situation incestueuse a pour élément fondateur le silence. Silence qu’elles
ne définissent pas, et que j’avais proposé pour ma part, dans mon travail de
master 1 (Perrin, 2008, p 6), de conceptualiser comme suit : « le
silence est (…) à la base de la subjugation. Le silence dont il est question
ici est celui des victimes qui ne parlent pas de l’abus, même si elles en
souffrent. La première cause de ce silence est simple : l’absence de
recours. Si un enfant est victime d’abus de la part d’un parent, vers qui
peut-il se tourner pour recevoir de l’aide ? Se taire signifie pour lui
survivre, mais à un prix incroyablement élevé. La deuxième cause est
l’entourage. Lorsque l’enfant demande de l’aide, son discours et son expérience
sont souvent niés par la famille immédiate qui évite de faire face à la
situation. Le silence n’est donc pas qu’une absence de paroles. C’est une
relation créée et maintenue par des individus selon des règles implicites.
[souligné par moi] Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter
mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque
l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son
père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (Stéphane La
Branche, 2003, p. 28).
Dorothée Dussy
ajoute (Dussy, 2004) que seule la rupture de ce silence peut perturber une
situation incestueuse, donc que tant que rien n’est dit (et, j’ajoute :
cru, entendu …), rien ne bouge.
Cette rupture est
provoquée, explique Dussy, par un « annonciateur », qui,
contrairement à l’annonciateur décrit par Jeanne Favret-Saada (Favret-Saada,
2005), « ne cherche pas nécessairement à informer la victime. C’est
celle-ci qui, en l’entendant ou le lisant, se dit : « mais c’est bien
sûr ! ». [Autre différence :] Pour désigner l’inceste, la parole
doit avant tout être légitime, c'est-à-dire avoir été prononcée par une
autorité sociale, morale et psychique » (Dussy et Le Caisne, 2007,
p 18), par exemple un/e policier/e, un/e juge, un/e intervenant/e à la
télévision, un/e « psy », une autre victime d’inceste via son
témoignage légitimé par sa publication en livre ou en passage filmé (« vu
à la télé »). De plus, à la différence de l’annonciateur du bocage qui
parle par sous-entendus, par allusions (« vous pensez-pas qu’y en a qui
vous voudraient du mal ? »), « Pour être entendus, les propos de
l’annonciateur doivent (…) être rigoureux, c'est-à-dire désigner les faits sans
détour et avec autorité. [Et, finalement, ] les faits vécus passent
[alors] d’un statut anomique – une expérience subjective et individuelle non
désignée et incompréhensible - au statut de fait social communicable, dans
lequel chaque acteur est positionné : l’incesté est une victime d’inceste et
son incesteur va devenir un agresseur. » (Dussy et Le Caisne, 2007,
p 20).
Ainsi,
l’annonciateur, pour Dussy, doit :
-
constituer une
autorité socialement et/ou moralement légitime
-
ne pas rester
dans le sous-entendu, nommer les faits avec précision (« votre récit est
le récit d’un viol, d’un abus sexuel incestueux, … »).
L’annonciateur a
pour effet de modifier radicalement, par son annonce, la vision des abus
incestueux qu’a l’incesté/e : d’un référentiel où c’est
« normal » ou bien indicible et même impensé, l’incesté/e passe à un
référentiel qui lui permet de penser aux abus sexuels comme à des abus sexuels.
Dussy propose alors de décrire par sa recherche les modalités de la mise au secret des familles tout le temps que dure la période des abus sexuels, de s’interroger sur ce qui pérennise le silence une fois que les enfants sont devenus adultes, et sur ce que l’on tait, par exemple le nombre d’incestes dans la famille, la généalogie de l’inceste, etc.
Ce terme de « mise au secret », que j’ai employé moi aussi dans ma recherche de master 1 sans le penser plus avant, m’a fait réfléchir.
En effet, de mon côté, je l’avais utilisé alors (Perrin, 2008, p 22-23) pour décrire les comportements d’associations et de proches d’incesté/e/s en réponse à mes demandes pour mon master 1. Ici, il ne s’agissait pas de silence au sens commun du terme, mais d’étouffement de mes demandes d’entretiens, non relayées auprès des incesté/e/s, ma démarche étant pensée comme potentiellement dangereuse pour ces incesté/e/s, ou encore, tout simplement, dangereuse pour le maintien du secret. Ceci est très clair par exemple dans ce courriel : « Pour mes amies/connaissances, la réticence est aussi mienne, elles m’ont fait partager leur secret et il y a une sorte d’accord tacite entre nous autour de ça » (courriel du 08/01/2008).
Aucun silence dans ces échanges, ni aucune incrédulité face aux récits d’abus. Mais ils ne doivent pas devenir publics : ils doivent rester de l’ordre de la confidence faite par l’incesté/e à une amie, ou à une association. A tel point que les incesté/e/s ne peuvent et ne doivent pas être mis/es au courant de ma proposition de publicisation de leurs récits via mon travail d’anthropologue, par ces intermédiaires réticents !
En fait, à travers tous ces échanges de paroles et d’écrits, ce qui se dévoile, c’est une mise au secret sociale, non concertée mais bien réelle, des incesté/e/s.
En revanche, dans les familles où se produisent des abus sexuels incestueux, la mise au secret se double souvent du silence comme système de relations, tel que le décrit Stéphane Labranche. En ce cas, non seulement lorsque l’incesté/e parle, cela doit rester dans le domaine strictement circonscrit de la confidence, mais en outre, ce n’est pas cru, ou bien c’est jugé normal et anodin. La mère de Paulette ne croit pas sa fille, celle de Lydia rigole :
« Lydia-J’en ai
jamais parlé. Sauf une fois, où j’ai essayé de faire comprendre à ma mère ce
qui se passait, je devais avoir 17 ans. (…) Et elle m’a dit « qu’est-ce
qu’il y a Lydia, ton père te viole ? », en rigolant. »
Ainsi, étudier les relations dans une famille où se produit un abus sexuel incestueux induit d’étudier le silence, non au sens commun d’absence de parole, mais au sens de Stéphane La Branche.
En revanche, une fois les abus sortis du silence, c'est-à-dire crus et entendus par un/e confident/e, il devient nécessaire, me semble-t-il, de mettre l’accent sur l’étude de la mise au secret. Parler de « silence » dédouane les confident/e/s de leur responsabilité dans la (re)production de l’absence de parole publique sur l’inceste. Ceci alors même que cette parole publique apparaît fondamentale pour aider les nouvelles victimes d’inceste à comprendre et révéler ce qui leur arrive (Dussy et Le Caisne, 2007). Parler de « silence » est un lieu commun non questionné des ouvrages existants sur la thématique. Les abus eux-mêmes sont supposés se produire « dans le silence », au sens courant d’absence de parole[31], alors que, comme les procédés tortionnaires décrits par Françoise Sironi, ils semblent au contraire fréquemment accompagnés de paroles. Et pas n’importe quelles paroles. C’est le cas pour Lydia, à qui son géniteur-incesteur demande « est-ce que je te fais mal ? » lorsqu’il la viole. Danielle relate les nombreux discours de son abuseur qui visent à lui inculquer la normalité de ce qu’il est en train de lui faire et aussi à la faire se sentir complice de ses exactions. Etc. (Perrin, 2008, p 37-38 et p 69).
Françoise Sironi explique que, dans le cas de la torture, « Ces paroles, prononcées par les tortionnaires sous la torture et redoublées par des actes, peuvent n’avoir rien de terrifiant en soi, quand elles sont entendues « hors contexte ». [Pourtant elles] iront pénétrer le noyau de la personne torturée. Elles pourront être « oubliées » à un niveau conscient, mais elles infiltreront toute l’activité de pensée et tous les actes. », et elle ajoute : « ce qui me surprend, c’est le fait que les cliniciens y accordent si peu d’importance du point de vue psychopathologique, alors que ce sont elles, les paroles, qui sont actives » (Sironi, 1999, p 64-65). Elle cite par exemple les paroles qui font redondance avec les actes commis : « Quand les tortionnaires énoncent des injonctions comme « tu ne seras plus jamais un homme » pendant qu’ils appliquent un courant électrique sur le pénis d’un homme, ils induisent une modification brutale et parfois irréversible de la représentation de l’ordre des choses chez la personne que l’on torture. Ce qui peut être une crainte fantasmatique devient la réalité » (Sironi, 1999, p 45).
Ainsi, à l’étude du silence qui entoure les abus sexuels incestueux devrait se surajouter celle des diverses paroles qui les entoure également : paroles de l’abuseur, paroles rigolardes de la mère de Lydia, etc. Que disent-elles, qu’inculquent-elles aux incesté/e/s ?
Ce nouveau questionnement constitue le premier acte de mon distancement d’avec les lieux communs que j’ai longuement lus et repris (tout comme Dorothée Dussy) parce qu’ils constituaient la seule ébauche de pensée existante sur cet « impensable » qu’est l’inceste.
Mais comment théoriser autour de la « mise au secret », alors que d’un côté, la psychologie analyse le secret aliénant nommé « secret de famille », cependant que les sciences sociales cultivent une vision, unilatéralement positive, du secret, construite essentiellement à partir des secrets initiatiques et/ou de l’étude de sociétés secrètes ?
Par exemple, Andras Zempléni, s’inspirant fortement sur ce point des analyses de Simmel, explique que la communication d’un secret « le transforme en objet de jouissance et d’échange, en chose commune et en ciment d’un lien social fort et ambivalent qui se nourrit de la tension constante entre un dehors et un dedans. » (Zempléni, 1984, p 104). Comment faire lien entre ce secret-là, et le secret de famille des psychologues ? Comment penser la mise au secret autour des abus sexuels incestueux comme le ciment d’un lien social ? Comme un objet de jouissance et d’échange ?
Andras Zempléni s’intéresse au secret en situation coloniale ou dite post-coloniale. Il part d’un questionnement autour du lien entre le goût occidental, récent, pour les secrets médico-magiques ou coutumiers d’une humanité exotique que ce même Occident laisse, dans le même temps, mourir de faim. Finalement, « dites-nous les secrets des Autres » est la demande, diffuse, que sa propre culture adresse à l’ethnologue. Zempléni relate alors que les épisodes de résistance ouverte à la colonisation n’ont été « que l’infime partie visible d’un iceberg de résistances déguisées », et qu’ « une forme de résistance bien plus générale, simple et discrète (…) n’a guère retenu encore l’attention des historiens : le secret est le moyen le plus commun dont les peuples soumis et les groupes opprimés se servent pour préserver leur identité sociale et culturelle » (Zempléni, 1984, p 102). Il s’agit donc, pour lui, de questionner une relation entre l’ethnologue et son terrain marquée par le secret comme mode de résistance à des rapports de sujétion, notamment coloniaux. C’est dans ce cadre qu’il théorise le fonctionnement du secret.
Pour Zempléni, le secret constitue un mode de relation et de communication paradoxale. Se basant sur l’étymologie du mot, « se-cernere », qui désigne « ce qui a été mis à part », « le contenu ou la substance qui a été séparé, mis à part », il explique que l’acte constitutif du secret est un acte de refus.
Cet acte de refus implique au moins deux êtres humains liés par un rapport négatif :
- le détenteur de ce « contenu mis à part »
- le destinataire, visé par ce contenu refusé (par exemple, l’ethnologue qui cherche à percer le contenu d’un secret qu’il sait ou pense exister dans la société étudiée).
La substance mise à l’écart constitue quelque chose de foulé, de serré, de contraint, est chargée de tension. Chargée de la tension du refus de communication qui a institué le secret, et qu’il faut maintenir pour le préserver.
Zempléni décrit trois modes de décharge, ou de régulation, de cette tension, par lesquels se manifeste « la tendance incoercible du secret à se frayer une voie vers ses destinataires » (Zempléni, 1984, p 103) :
- la révélation
- La communication
- la sécrétion
Dans la révélation, il s’agit de dire, divulguer ou encore trahir le secret. Ces procédés constituent un relâchement brusque de la tension. Ce relâchement-ci abolit la séparation et par conséquent le secret. Ce serait le cas, par exemple, d’une parole publique d’une personne révélant les abus incestueux qu’elle a subis.
Mais en procédant ainsi, le détenteur révèle en fait qu’il n’a pas l’objet susceptible de combler le manque de ses partenaires, explique Zempléni, et c’est pourquoi aucun secret ne peut remplir ses promesses en étant révélé. D’où l’intérêt des autres modes de décharge de la tension, nous dit-il.
La communication, au lieu d’abolir la séparation, déplace sa limite. De cette façon, elle préserve le secret tout en en « soulageant le poids », en abaissant la tension. Par exemple, la confidence faite à une amie sur les abus sexuels incestueux qu’on a subis, entre dans ce cadre.
Et, alors qu’on peut révéler un secret, directement ou indirectement, à ses destinataires, en le disant devant tout le monde ou n’importe qui, on ne peut le communiquer qu’à des dépositaires (ami/e/s, proches, pairs, initiables …) par définition distincts des destinataires.
Et en le confiant ainsi, « nous ne (…) demandons pas seulement [au dépositaire] de le conserver intact et de nous soulager du poids de notre refus : nous lui demandons aussi de le prendre en charge et de le « partager » c'est-à-dire de l’étayer et de le soutenir de la force de son propre refus » (Zempléni, 1984, p 104). Ainsi, la communication a pour effet crucial de transformer le secret en un fait social doué d’effets spécifiques. Plus précisément, la communication transforme le secret « en ciment d’un lien social fort et ambivalent qui se nourrit de la tension constante entre un dehors et un dedans. » (Zempléni, 1984, p 104). C’est par exemple le lien qui unit les membres d’une société secrète entre eux.
Mais un effet de la communication, qui nécessite de choisir un/e dépositaire, un/e confident/e, est l’apparition de l’intrus.
Le détenteur A (« je », ou « nous ») a confié le secret à un dépositaire B (« tu » ou « vous »), à l’exclusion d’un destinataire C (« il » ou « eux »). L’intrus est alors l’individu ou le groupe D qui ne fait partie ni de ceux qui savent le contenu du secret (B), ni de ceux qui savent qu’il existe un secret qu’on ne veut pas leur dire (C). Finalement, l’intrus est donc « le destinataire d’un second secret, du secret de son exclusion de la communication et du partage » (Zempléni, 1984, p 105).
Enfin, la sécrétion constitue un dernier mode de régulation de la tension générée par le secret. En effet, la communication abaisse momentanément la tension, mais ne la supprime pas et finit même parfois par l’attiser. Zempléni appelle sécrétion « l’ensemble de processus plus ou moins involontaires ou organisés au moyen desquels les détenteurs ou les dépositaires (A et B) exhibent des fragments du secret devant ses destinataires (C et D) sans pour autant le révéler ni le communiquer » (Zempléni, 1984, p 106).
Il peut s’agir, par exemple, de regards furtifs, d’avis, de manières ou de paroles inaccoutumées, de présences ou absences remarquées, d’actes manqués et lapsus …ou encore, lorsqu’il s’agit d’un secret traditionnel détenu par un groupe, d’exhibitions organisées, cérémonielles, qui requièrent la présence des destinataires, et comportent l’exhibition ou l’occultation ostensible d’objets insolites, des bruitages, des chants cryptiques, etc.
La fonction de la sécrétion est de régler, de réguler, et aussi d’entretenir la tension du secret. Zempléni en conclut : « dans le fond, le secret est menacé tout autant par l’abaissement que par l’élévation excessifs de sa tension. Faute de contrainte externe et sans les échanges de signaux déclenchés par son exhibition, il est, pourrait-on dire, voué à l’extinction » (Zempléni, 1984, p 106). Comme si, finalement, son contenu n’avait aucune « charge » intrinsèque, une fois connu ou, à l’inverse, une fois complètement occulté, invisibilisé.
C’est certainement le cas des secrets initiatiques, dont les contenus, par eux-mêmes, sont anodins : flûtes, masques, paroles secrètes, une fois révélés, ne seraient que des flûtes, des masques ou des paroles ordinaires. C’est la mise sous secret qui les pare d’une valeur spéciale. On comprend alors pourquoi lorsque le détenteur révèle, il montre en fait qu’il n’a pas l’objet susceptible de combler le manque de ses partenaires, donc que ce secret ne peut remplir ses promesses en étant révélé.
On comprend aussi, en creux, ce qui manque : lorsque Zempléni déclare qu’aucun secret ne peut donc remplir ses promesses en étant révélé, il présuppose que tous les secrets sont conformés sur le modèle de ceux auxquels il a affaire lui. Et aussi, que tous ont des promesses à tenir … mais quelles promesses comporte le secret délétère qui constitue mon objet d’étude ?
Ce qui manque, c’est peut-être l’idée que le contenu du secret pourrait ne pas être aussi anodin qu’une flûte, un masque ou des paroles secrètes de chants.
En outre, lorsque Simmel, dont Zempléni s’inspire, étudie le secret, il le fait reposer sur la confiance qui lie alors ses détenteurs, lorsqu’ils sont unis par ce secret : « La première relation interne essentielle à la société secrète, c’est la confiance réciproque de ses éléments. » (Simmel, 1991, p 64). Et, ajoute-t-il, « il s’agit ici d’une confiance tout à fait spécifique : celle dans la capacité de se taire. (…) Il faut ajouter à cela qu’à quelques exceptions près, aucune autre forme de confiance n’a autant besoin d’être constamment renouvelée subjectivement (…). C’est pourquoi les sociétés secrètes, dont les formes rudimentaires commencent avec le premier secret partagé à deux et qui sont répandues universellement, en tous temps et en tous lieux (…) sont une école extrêmement efficace de la solidarité morale entre les hommes » (Simmel, 1991, p 68-69).
Or, dans le secret qui lie l’incesté/e à son incesteur/euse, le ressort du maintien du secret est, selon des incestées[32], leur honte, leur sentiment d’être mauvaises, et qu’elles risquent d’être jugées responsables ou fautives en partie de ce qui leur est arrivé si elles en parlent. Et non la confiance entre deux détenteurs/trices égaux d’un bien, d’un privilège commun que serait le secret tel que le décrit, de manière pourtant intéressante, Simmel : « D’abord, l’exclusion fortement marquée des autres fait naître un sentiment de propriété non moins fortement marqué. Pour bien des natures, ce qui donne son véritable sens à la propriété, ce n’est pas de posséder, au sens positif du terme ; mais elles ont besoin de savoir que les autres sont privés. (…) En outre, s’il est vrai que les autres sont exclus d’une possession si celle-ci a une grande valeur, il est psychologiquement aisé d’inverser les termes : ce que l’on refuse au grand nombre doit être particulièrement précieux. Et c’est ainsi que la forme du secret donne à la propriété intérieure une valeur caractéristique, parce que dans cette forme, la valeur propre du contenu disparaît assez souvent derrière le fait que les autres n’en savent rien. (…) Des plus petites relations aux plus grandes, on voit se manifester cette jalousie envers celui qui sait ce qui est caché aux autres. » (Simmel, 1991, p 43-44). Ainsi, Simmel théorise le secret en termes économico-politiques : il est comme un bien, un privilège qui distingue ses dépositaires des destinataires. Mais à qui profite le privilège lorsque le secret porte sur un crime tel que des abus sexuels incestueux, et que ses dépositaires sont simplement le criminel et sa victime ?
Ceci pose la question d’une théorie plus générale du secret, englobant aussi bien le secret instrument d’oppression, comme celui imposé par le/ la collégien/ne racketteur/euse au ou à la racketté/e, ou encore celui imposé par l’incesteur et ses soutiens, que le secret de résistance à la sujétion ou encore celui qui permet de créer l’intimité.
Néanmoins, hormis les questionnements à mener autour du rôle du contenu du secret, qui n’est pas obligatoirement indifférent, et du ressort de son maintien, qui n’est pas obligatoirement la confiance ou le pacte entre ses détenteurs/trices, la catégorisation de Zempléni peut nous servir à commencer à penser la mise au secret autour de l’inceste.
C’est un lieu commun, bien connu, et on y croit : « aujourd’hui, les enfants peuvent parler ». D’ailleurs, le n°119 est probablement submergé de leurs appels, à en croire les écrits, récurrents et experts, sur ce thème. « L’inceste et les attouchements à enfant sont pratiquement sortis du registre des tabous et de l’ombre des secrets de famille. Les enfants sont invités à parler et à manifester leur prévention à l’égard des adultes abuseurs (…). C’est le message transmis à tous à la suite des diverses grandes affaires qualifiées de « pédophiles » » (Gavarini, 2004, p 172). Bref, de grandes choses ont été faites et il y a eu de grandes évolutions ces dernières années. Au point qu’on friserait l’excès, poursuit la sociologue : « Les enfants sont invités à parler et à manifester leur prévention à l’égard des adultes abuseurs, mais aussi des adultes quels qu’ils soient, qui leur porteraient une trop grande attention ou feraient preuve de trop de gentillesse. (…) « Mon corps c’est mon corps », dit le message canadien diffusé dans les écoles (…) En quelques années, la mise à distance du corps des enfants est en tout cas frappante. Désormais, leur corps, c’est leur corps. » (Gavarini, 2004, p 172-173-174).
Retenons le point positif : maintenant, les enfants reçoivent tous une information et peuvent parler. Vraiment ? Et parler de quoi ?
J’aurais aimé continuer à y croire, moi aussi, mais j’ai hélas discuté avec des professionnel/le/s qui m’ont fait comprendre que ces croyances que nous partagions, eux/elles et moi, étaient fausses.
Voici la réalité, en France, durant la première décennie des années 2000.
Auprès des différent/e/s professionnel/le/s ou bénévoles avec qui j’ai eu des entretiens, en pratique, les communications faites par des enfants avant l’adolescence sont rarissimes, et ce sont certaines d’entre eux/elles qui en concentrent la grande majorité : la pédopsychiatre libérale, d’une part, la bénévole associative, d’autre part.
Concrètement, ce ne sont pas les enfants qui parlent directement à ces adultes : c’est un de leurs parents, le plus souvent la mère. Dit autrement, pour un enfant abusé sexuellement par un/e apparenté/e, l’interlocuteur privilégié reste ses parents. Pas le numéro vert visible sur le petit autocollant d’une maison du Rhône (« en danger ? Appelez le 119 »), ni même, le plus souvent, « un adulte de confiance » comme l’institutrice ou l’instituteur.
L’anthropologue -
D’accord. Oui parce que ça arrive que ça soient euh, les deux, ‘fin… pas
toujours le même parent … ?
Patricia, bénévole
associative - Oui, oui oui, souvent oui, c’est des, en plus des enfants, des
demi-frères ou des demi-sœurs hein, y’a aussi maintenant des, des demi-frères
qui, qui font … qui ont des gestes sur leur petite sœur, par exemple
Anthropologue – Hmmhmm
Patricia - ou leur
petit frère. (…) Donc là euh, voilà. Là c’est la maman souvent - là on a un cas
comme ça - qui signale que le, le demi-frère fait des choses à son fils à elle.
Anthropologue - On m’a
pas mal parlé de choses comme ça effectivement dans mes autres entretiens
aussi.
Patricia - Oui. Oui oui, oui oui, ça devient vraiment terrible hein, ça …
Les cas d’abus sexuels par un germain, pour terribles qu’ils semblent, sont aussi ceux qui posent le moins de questions de crédibilité autour des accusations d’abus. Même s’il faut noter, au passage, qu’il m’est décrit ici des abus par « demi-frère », et non par frère du même sang, qui existent pourtant également.
En revanche, lorsque les abus sont commis par un des parents, le contexte est généralement celui d’une séparation, dont on verra plus loin qu’il pose de graves problèmes :
Anthropologue – Et, ben
c … quand vous dites c’est lors des séparations : c’est, ça commence lors
des séparations ? C’est, ça se dit lors des séparations ? Vous savez,
ça, ou … ?
Patricia - Ben quand
les gens viennent là, c’est qu’ils sont déjà séparés, et que la garde est déjà
installée, euh, la garde alternée.
Anthropologue –
D’accord.
Patricia – Donc euh,
c’est vrai, pfffou …euh, c’est rarement, comment dire, au sein d’une famille,
et que le, le parent soit spectateur de ce qui se passe dans la famille.
Anthropologue – Hmmhmm.
Ouais, ouais.
Patricia – Sur … les
deux années que je suis là.
Anthropologue - Ouais.
Sur le temps depuis que vous êtes là, vous avez pas eu de cas où ce, où c’était
comme ça ?
Patricia - Non. Non,
non. (silence, puis : ) Hein X, t’en as des cas toi où c’était dans,
euh, sans séparation des parents, mais que ça cont, ça se passait dans la
famille et que le, le parent était spectateur de ça ? Qu’il soit venu
dénoncer, euh, que ça se passait sous ses yeux ? Enfin … Non ?
[Il répond, mais ses
précisions sont inaudibles sur l’enregistrement]
Patricia – Oui, c’est
ce qu’il me semble, oui
Anthropologue - Donc
c’est après séparation dans tous les cas …
[Il continue ses
précisions]
Patricia
– Oui. C'est-à-dire qu’il arrive un moment aussi où l’enfant veut plus y aller,
chez le … chez le, chez le papa, donc là quand même ça interpelle la
maman, « pourquoi tu veux plus y aller ?, donc petit à petit, il
commence à parler : « il me gronde, il me parle mal, il me laisse
enfermé, je sors pas, ou y’a une autre dame qui est là, une autre dame qui est
là et qui m’aime pas, qui me parle mal », y’a aussi tout ça (…) la parole, ça fait aussi beaucoup de
dégâts là hein, sans parler de, de, de subir des gestes, des attouchements
hein.
Ceci, que les révélations concernent des abus sexuels ou d’autres maltraitances : Patricia me donne comme exemples de paroles : « il me gronde, il me laisse enfermé, y’a une autre dame … », c'est-à-dire surtout des propos qui ne se rapportent pas à des abus sexuels.
Quant à Irène, pédopsychiatre exerçant en libéral, le message qu’elle avait laissé sur mon répondeur pour me dire son intérêt pour ma recherche, s’étendait longuement sur ces enfants « petits », qui n’ont parfois pas encore le langage, et qui lui étaient apportés à son cabinet pour des signes suspects … on en reparle, suite à question de ma part durant l’entretien :
Irène, pédopsychiatre -
Alors, les enfants sur lesquels il y a des doutes, … souvent le doute est
d'abord un doute présenté par la famille, hein. C'est-à-dire qu’il y a beaucoup
d'enfants qui sont amenés justement, avec des suspicions d'attouchements, ou
parce qu'ils ont … prononcé quelques paroles qui met le doute auprès de leur
père, ou auprès de leur mère
Anthropologue – Hmmhmm.
Irène - Et du coup la
consultation a lieu à la suite de ça, pour euh, "savoir ce qu'il en
est".
Anthropologue – Ah,
d’accord.
Irène – Je sais pas, ça
peut être, ou bien des, ça peut être des enfants qui d'un seul coup, revenant
de chez la nourrice ou … revenant … d'un moment passé dans la famille,
rapporter telle scène qui paraît étrange aux parents, ou des propos qui leur
paraissent bizarres, pas de l'âge de l'enfant. Et là le doute est installé,
souvent d'abord au niveau de la famille.
Anthropologue -
D'accord. Quand vous dites de la famille ?
Irène - C'est des
parents : le père, la mère qui entendent euh, une parole de l'enfant, et qui
disent "mais comment il dit ça, pourquoi il sait ça ? Et de quoi il en
parle ?", et qui soit l’ont déjà abordé, franchement cela avec
l'enfant, soit ne l'ont pas abordé mais ça les, ça …ça les dérange énormément.
Anthropologue - C'est …
enfin c’est quel genre de paroles, si vous avez des exemples ?
Irène - Là j'en n'ai
pas, j’en n’ai pas en tête. Souvent les paroles sont … souvent, souvent les
paroles sont assez … sibyllines, en fait, hein.
(silence, réflexion)
Je sais pas, ça peut
être euh ... c’est, c'est difficile et euh ... quelques fois, c'est, je, ... ça
peut être "il m'a tapé la fesse", des choses comme ça
Anthropologue – Ouais,
ouais. Hmmhmm.
Irène - enfin quelque
chose qui est quand même autour d'une partie du corps de l'enfant qui est, dans
le propos de l'enfant, mis en avant, souvent effectivement c’est une partie
sexuelle du corps.
(…) la plupart du temps
les parents l’ont entendu et le rapportent, donc on n'a pas le premier jet de
parole.
Anthropologue – Ouais,
ouais.
Irène - En tout cas ce
qui est certain, c'est, quelques fois ça peut être, surtout au moment des
séparations entre la … la mère qui, qui est gênée de ce que l'enfant rapporte
de ses liens avec son père, alors ça peut être soit parce que le père prend
l'enfant dans son lit, ou parce que le, le père assure maintenant les soins
corporels d'un enfant petit, sur, c’est surtout les petites filles d'ailleurs,
mais ça pourrait être un petit garçon tout autant. Et que … les, la mère
ensuite … Ou bien ne les assure pas, peut-être, d'ailleurs, mais en tout cas la
mère ensuite va être intriguée, d'une rougeur inhabituelle, de quelque chose de
cet ordre là : vraiment, on sent que les, que le moment de séparation des
couples ça attise beaucoup euh, les craintes des mamans. Quelques fois parce
qu'elles même elles ont eu à subir cela dans l'enfance, hein donc …
Anthropologue – Ca
arrive ?
Irène - donc elles perdent tout à fait la, la confiance, en fait, la confiance dans l'adulte se perd facilement, quoi.
On entrevoit, à travers ces récits, qu’il est difficile de cerner ce que les enfants ont pu dire ou montrer au parent : paroles sibyllines ? Commencé à parler ? Ou bien simplement, des signes, comme une rougeur, un vocabulaire surprenant … on retrouve la présence des contextes de séparation. Il faut y ajouter l’allusion au passé de ces mères, qui ont été « quelques fois » elles-mêmes incestées jadis, ce que mon interlocutrice relie avec leur perte de confiance envers « l’adulte » qu’est leur ex-compagnon : comme si elles-mêmes étaient restées enfants ?
Pendant ce temps, Dorothée Dussy relate les difficultés que peut rencontrer la révélation d’un enfant pendant la période des abus : « si, avec les mots qu’ils ont à leur disposition à ce moment-là de leur expérience, la plupart des jeunes incestés interrogent leurs proches ou racontent ce qui leur arrive, ils sont rarement entendus ou très souvent éconduits. Comme Nathan, par exemple, qui se souvient des acquiescements répétés de sa mère à qui il demandait, lorsqu’il avait 8 ans, s’il était obligé de suivre son père dans la forêt. Aussi, puisque parler ne sert à rien, les incestés se taisent » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 16).
Comme Aurélie, dont le demi-frère abuseur est puni à coups de ceinture par son père, cependant que sa mère reste sans réaction, lorsqu’elle leur révèle, à 8 ans, qu’il la « tripote ». Ensuite, il continue à tenter de la tripoter, mais de nuit.
Aurélie – Je l’ai pas
caché, moi je l’ai dit, j’avais environ 8 ans. (…) Après, heu, moi j’ai vécu
ça, quand il me réveillait la nuit, ben, je lui dis « arrête, sinon je
vais le dire ! », donc là, il arrêtait, parce que … et il revenait,
la nuit d’après. Donc euh, je me réveillais en sursaut : ah, je le voyais
…[et le scénario de la veille recommençait]
La menace de le dire de nouveau à leurs parents l’arrête. Mais seulement jusqu’à la nuit suivante : ainsi, Aurélie est réveillée en sursaut durant des années, jusqu’au départ de ce demi-frère du domicile. Ici, l’inceste a été mis au secret par les parents d’Aurélie après sa révélation.
Mais souvent, les enfants n’ont tout simplement pas de mots pour dire : « Claire, 38 ans, agressée par son oncle : « (…) Ca fige complètement le mental. Avec des mots d’adultes, qui vont dire … tu vois passer une voiture, peut-être qu’à un moment tu peux dire : « la voiture est verte, il va y avoir un accident si elle ne s’arrête pas au feu ». Peut-être que tu peux te dire ça. Mais là, je ne sais pas, moi, il me semble que c’est vraiment une sensation corporelle d’engourdissement de la pensée. » Aucun mot, donc, pour qualifier cette affaire qui s’étale la plupart du temps sur plusieurs années » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 16). Par-delà l’engourdissement, encore une couche peut être rajoutée par l’abuseur lui-même, comme le relate Danielle.
Danielle-Déjà. C'est-à-dire que, l’idée qu’il touche
à ma petite cousine, ça me mettait en colère, alors que ça me (…) venait pas à
l’idée que moi c’était grave. C’est, c’était pas grave de toute façon.
(silence) (…)
Je pense que justement, le fait qu’il m’en parle, ça faisait que je … heu … c’était pas suffisamment à moi pour que je puisse le dire à quelqu’un d’autre. Je sais pas comment … en fait, en m’en parlant, il faisait en sorte de me culpabiliser, de m’impliquer dedans. »
Le silence se construit donc par la sidération de l’incesté/e, produite par les actes, auxquels peuvent s’ajouter les mots de l’incesteur comme verrouillage, voire ceux d’une mère rigolarde comme dans le cas de Lydia comme deuxième verrouillage.
Enfin, non seulement parler peut ne servir à rien, ou à aboutir à un compromis délétère comme pour Aurélie, mais cela peut être dangereux : lorsque c’est le père l’un des abuseurs, souvent, la mère est également victime de cette terreur, subissant des violences conjugales et une sexualité « aux ordres » du conjoint (Perrin, 2008, p 35). Et complice, au point de répéter à l’incesteur tout ce que lui confient ses enfants. Comme c’était le cas de Lydia, mais aussi d’Agnès. Pour cette dernière, le silence se solde d’ailleurs par un oubli qui se termine des décennies après, en 2004. Lorsqu’elle a des problèmes au travail note-t-elle, mais aussi, de fait, après le décès, en 1997, de son père-incesteur … La peur de la rouste, par delà les décennies ?
Néanmoins, si des mots alternatifs à ceux de l’abuseur sont donnés aux enfants, par exemple via un petit livret de prévention à l’école primaire, cela peut déboucher sur des révélations :
Christine,
pédopsychologue en CMP - La première fois qu’il avait fait ça - parce que la
petite, donc, elle me raconte que en fait, donc, ça c’est passé en fait deux
fois, peut-être plus, enfin, je sais ... Mais comme elle venait de lire le
petit livret, la deuxième fois elle avait compris qu’il devait pas faire ça, si
tu veux, parce que la première fois, moi je sais pas, moi … elle devait avoir 6
ans la première fois, si j’ai bien compris, puis la deuxième 8, tu vois, enfin
...
L’anthropologue – Ouais
ouais ouais.
Christine - … euh,
voilà. Et entre temps, parce que, alors je lui dis « mais tu t’étais pas
rendu compte qu’il y avait quand même des choses un peu bizarres de te tripoter
ta culotte, ou des trucs comme ça ? ».
Elle m’a dit « ben
je savais pas, et puis il était gentil, et puis il me disait c’est un secret
entre nous hein, tu en parles pas ». Ca c’est classique, hein, tu as du
l’entendre plusieurs fois.
Mais ici, l’abuseur est un épicier dont le magasin se situe à la sortie de l’école, et nullement un parent ou un proche de l’enfant. Représentant caricatural du « vilain monsieur inconnu qui donne des bonbons », il donnait, précisément, des bonbons de son magasin à l’enfant lorsqu’elle y passait. Il s’agit d’une révélation d’attouchements pédophiles, mais non incestueux, faite dans le cadre de son suivi par Christine au CMP.
La parole enfantine peut aussi émerger à l’école … sur d’autres sujets.
Françoise, assistante
sociale polyvalente de secteur - On a, les petits ne viennent pas
spontanément, ils sont accompa…voilà.
Hélène, assistante
sociale polyvalente de secteur - non les petits viennent pas, mais euh,
ils peuvent parler
Françoise – A
l’institutrice.
Hélène - avec leur
institutrice. Par exemple, enfin, moi je pense à la situation d’un petit de 8
ans qui, qui a dit à son institutrice, euh, que il lui est arrivé de fumer de
la drogue avec son frère par exemple.
Mais concernant les suspicions d’abus sexuels, ce sont des comportements qui font indice :
Françoise - ou un
enfant à l’école, un petit en maternelle, il y a quelques années, qui avait dit
des propos obscènes à un petit camarade de classe, l’institutrice l’avait
entendu, et donc effectivement, il avait dit des choses très sexuelles,
sexualisées
L’anthropologue –
Ouais, ouais, ouais.
Françoise – donc c’est
vrai que du coup l’institutrice a été interpellée, ça a nécessité justement une
évaluation, hein.
Anthropologue – Hmmhmm.
Oui, oui.
Françoise – Donc euh,
on retrouve, on retrouve, l’enfant parle, ou alors met en scène des choses avec
les, les, les copains, de classe. Donc c’est, voilà, c’est repéré.
La liste des signes possibles concernant les maltraitances en général serait longue : enfant triste, enfant turbulent … Concernant les abus sexuels, l’essentiel vient d’être dit : sexualisation des attitudes ou parfois des propos de l’enfant ; cet enfant peut aussi être triste, turbulent, etc, comme pour les autres maltraitances. Cette liste ne vient pas de nulle part : le département du Rhône l’a établie pour nous. Et, avant nous, pour ses travailleurs/euses sociaux/ales.
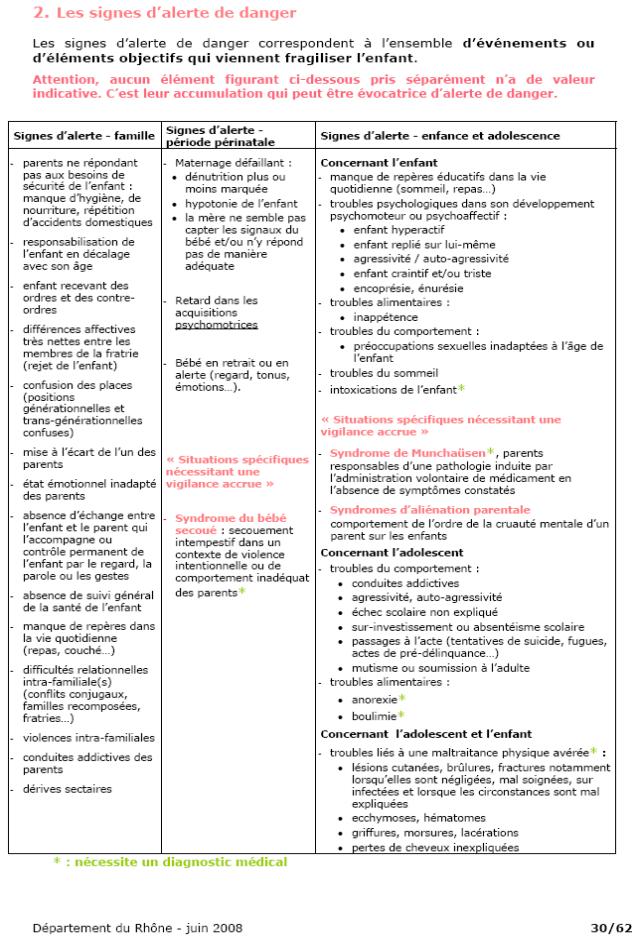
Et, page suivante, nous trouvons :
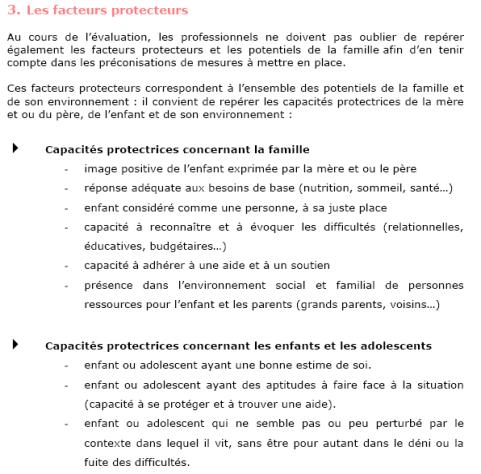
Mais comment situer Paulette dans ces grilles ?
Moi – Et à l’école, ça
se passait comment ?
Paulette – Je
m’ennuyais. Je m’ennuyais parce que j’allais très vite. Donc la maîtresse, elle
écrivait un problème au tableau, et quand elle avait fini d’écrire, je lui, je
lui, je levais le doigt pour lui donner la réponse. Alors je me faisais
engueuler, parce que « ah mais tu as pas réfléchi », je dis
« mais c’est facile ». Et cette imbécile au lieu de me donner un
autre problème, pour me tenir tranquille, et un difficile, « alors tais
toi, croise les bras et tais-toi ». Alors moi, je regardais mon chevalet
un petit moment, puis je me tournais et puis je faisais une grimace, alors ça
se marrait. Alors évidemment je faisais de l’autre côté, et ça se marrait.
Alors elle se retournait, et puis elle disait « ah, qu’est-ce que c’est
encore ça ? Ah ! C’est encore toi ! ». Mais on pouvait
difficilement m’embêter parce que j’avais toujours les meilleures notes, je,
j’avais, j’étais toujours la première de la classe, et c’est parce que j’étais
la première de la classe que j’ai pu m’en tirer toujours. »
Paulette, victime d’abus sexuels dans la famille d’accueil où elle est hébergée durant la guerre, puis par un cousin, ressemble terriblement à une bonne élève qui s’ennuie en cours, et s’occupe donc comme elle peut. De plus, comme la majorité des incestées avec qui j’ai eu des entretiens, elle s’emploie en fait activement à paraître « comme les autres » à l’école, c'est-à-dire à ne surtout pas montrer quoi que ce soit de ce qui lui arrive. Paulette, victime d’abus sexuels, est invisible pour les grilles données par la documentation du département.
Mais revenons à l’institutrice qui a repéré des signes suspects venant d’un élève. Contrairement au cas des mères qui s’inquiètent de rougeurs ou d’un vocabulaire suspects, ce repérage n’interroge pas à priori sur le « manque de confiance » envers « l’adulte » ou l’histoire personnelle de l’institutrice. Or, les enfants semblent révéler le plus souvent à leurs familiers, alors que ce sont les adultes non familiers qui sont ainsi les plus « crédibles ».
Enfin, si l’institutrice/teur, qui voit l’enfant plusieurs heures par jour durant toute une année, peut voir des signes l’alertant, il semble que le/la « psy », qui pourtant est une des rares personnes adultes à voir l’enfant de façon régulière et répétée, ne soit pas un interlocuteur possible pour une révélation par la parole. Les deux travailleuses du psychisme que j’ai eues en entretien ne relatent aucune révélation enfantine d’inceste dans le cadre d’un suivi par elles. Christine, qui travaille en CMP, me confie d’ailleurs son soulagement d’arriver le plus souvent quand la révélation a déjà été faite. Irène, qui travaille en libéral, me répond que cela ne lui est simplement jamais arrivé. Il faut noter qu’en CMP, le travail psychologique est souvent fait en lien fort avec un parent, et que d’autre part, les enfants viennent le plus souvent aux séances en cabinet libéral également accompagnés d’un parent, même s’il n’assiste pas à la séance. Enfin, les réponses des autres pédopsychiatres libéraux à mes demandes téléphoniques montrent que pour beaucoup, cette éventualité d’un enfant incesté parmi les enfants qu’ils/elles ont en suivi est, tout simplement, un impensé.
Francis, éducateur en service enfance, remarque quant à lui :
Francis, éducateur -
c'étaient des actes qui étaient innommables et inimaginables puisque de toute
façon c'est prohibé. Hein, prohibition de l'inceste, je veux dire, c’est, euh,
donc c'est im-pen-sable.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Francis – Impensable.
Sauf que ça existe, maintenant, la plupart des gens le savent, que ça existe.
On en parle et on a beaucoup plus le regard autour de ça.
Peut-être est-ce toujours un peu impensable aujourd’hui pour un certain nombre d’adultes … dès lors, comment des enfants pourraient penser ce qui leur arrive là ? Il faut remarquer que dans l’extrait que j’ai cité au départ de ce chapitre, la sociologue Laurence Gavarini, implicitement, parle de pédophilie hors famille et proches, et non d’abus sexuels intra familiaux, le mot « inceste » présent au début de la citation laissant la place aux inquiétudes sur la mise à distance corporelle générale des enfants.
A l’adolescence, les révélations directes relatées par mes interlocuteurs/trices deviennent plus nombreuses. Pour une première raison bien simple : à l’adolescence, on peut tomber enceinte de son incesteur. La révélation, qui aurait pu ne pas se faire, fait alors suite de quelques mois à l’abus sexuel.
C’est le cas de deux personnes dont se souvient Laurence, assistante sociale en planning familial. Une situation ancienne, une asiatique, me précise-t-elle, qui était enceinte, venue pour une IVG. Elle ne voulait absolument pas dire de qui elle était enceinte, puis a fini par le dire, lors de l’entretien IVG : c’était de son frère.
Laurence, assistante
sociale en planning familial – Et c’est vrai que nous, à l’occasion des fois,
d’un, d’un entretien pour une IVG, (…) bon on n’est pas de la police, mais on
part du principe que c’est important de mettre des mots sur ce qui se passe
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Pareil que
la petite Claudie, c’est de dire « bon, t’es enceinte, d’accord, mais
qu’est-ce qui s’est passé ? C’est pas pour moi. C’est pour que tu
comprennes ».
Anthropologue – Oui.
Laurence – Parce que
vous avez des fois des nanas qui vous disent « oh ben euh, non, j’ai pas
eu de rapports … »
Anthropologue – (rire
étouffé)
Laurence – quand on est
enceinte de six mois, on a eu des rapports, hein. Et, c’est important pour euh,
parce que la vie est pas un rêve, hein.
Anthropologue – Oui,
oui.
C’est justement de cette adolescente enceinte de six mois qu’il s’agit, dans la deuxième situation, beaucoup plus récente. Sa mère affirme, en dépit du bon sens, qu’elle n’est pas enceinte. Il est beaucoup trop tard pour une IVG. L’assistante sociale décide de « faire reposer », comme elle dit, et leur demande de revenir le lendemain. Le lendemain, l’adolescente, âgée de 15 ans, affirme alors être enceinte d’un petit copain, mais l’assistante sociale a un « feeling » qui lui fait l’envoyer, seule cette fois, à sa collègue et copine médecin dans le centre de planification. C’est là qu’elle dit, enfin, qu’elle est en réalité enceinte du fils de la nouvelle femme de son père à elle, qui l’a violée sous les yeux de son frère. Suite à cette révélation, une autorisation d’IVG dérogatoire sera obtenue.
Laurence – Mais je
crois que c’est ça, c'est-à-dire c’est que, y’a des fois où on ne peut pas
croire, parce que c’est pas pensé et que ça dépasse notre entendement.
L’anthropologue –
Hmmhmm. C’est ?
Laurence – Je peux pas
vous dire mieux, mais
Anthropologue – Ouais.
Laurence – c’est ça
pour moi. On peut pas y croire, on peu, on pense que ça n’existe pas.
Anthropologue – Hmmhmm.
Et d’où euh, le fait que ben, on n’y pense pas en fait ?
Laurence - Voilà.
L’anthropologue –
Ouais. Et donc, par exemple, si la, si Claudie avait, avait pas dit au
médecin,
« en fait c’est ça », le médecin
aurait pas forcément pensé « en fait c’est ça », c’est ça ?
Laurence - Ben non,
elle aurait été enceinte de son copain.
Anthropologue – Ouais.
Ouais. Hmmhmm.
Laurence - Et elle
l’aurait gardé.
Anthropologue – Hmmhmm,
oui. Tssfff … oui.
Laurence – Et ce
qui nous a fait déclencher, c’est qu’elle a dit « je n’en veux pas ».
Elle lâchait pas là-dessus …
Anthropologue – Ouais.
Laurence – donc quand
on dit « je n’en veux pas je n’en veux pas je n’en veux pas je n’en veux
pas je n’en veux pas », eh bien euh … ça me revient maintenant. C’est là qu’on
dit « il y a sûrement anguille sous roche », quoi.
Quant à la mère, qui a cru et soutenu sa fille, elle a eu beaucoup de mal à arriver à porter plainte
Laurence – En plus la
maman de Claudie, elle avait mis deux jours pour aller déposer plainte aux flics,
et je comprenais pas pourquoi. Alors elle me rappelle, elle me dit « je
suis pas allée », je lui ai dit « écoutez si vous y arrivez pas moi
je viens avec vous ».
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – « Non
non non, je vais y arriver, machin ». Et, et je, elle m’a expliqué après
pourquoi, parce qu’elle était déjà allée au commissariat, donc, de [lieu], (…)
pour poser des mains courantes pour violences conjugales.
Anthropologue –
Fhm !
Laurence – Elle avait
trop honte.
Anthropologue – D’accord.
Un autre cas qui peut conduire à des révélations d’abus, plus tardives, par des adolescentes, ce sont les refus d’examen gynécologique :
Laurence - Et la fille
qui résiste, qui résiste, et j’te saute le rendez-vous, et je viens pas, et
machin et trucmuche
Anthropologue – La
fille qui était venue au départ pour euh …
Laurence - Pour une
pilule.
Anthropologue –
D’accord. Hmmhmm.
Laurence – Et puis, et
puis et puis, mais des fois, c’est euh, c’est des choses que le, que le médecin
va découvrir trois ou quatre ans après, hein.
Du simple fait de la puberté, les adolescentes sont donc plus souvent conduites que les petites filles à être entourées d’interlocuteurs/trices attentifs/ives à leur rapport, dégradé par les abus, avec les parties sexuelles de leur corps.
Mais il arrive aussi que ce soit l’adolescente qui prenne l’initiative de venir parler, « pour être crue » :
Micheline, assistante
sociale scolaire – Ben, on voit que les mamans ont du mal à croire. Et puis
alors quelques fois en plus y’a des gamins qui en ont parlé aux mamans
L’anthropologue –
Hmmhmmhmm.
Micheline - et les
mamans n’y croient pas, en fait. Et du coup elles viennent, les, les élèves
viennent nous voir pour nous en parler
Anthropologue –
Heinhein.
Micheline – Pour être
crues. Oui, oui oui. Oui oui oui oui oui.
Anthropologue – Hmmhmm.
Ca ça vous est arrivé ?
Micheline – Ben le, le,
le, la dernière situation, c’était ça, quoi, la, la, l’élève en avait parlé à
sa maman, et la maman lui dit : « oh, mais non, ton papa est très
affectueux, il, il aime bien être près de vous et tout » … et bon euh, ça
allait un peu au-delà quand même.
Il faut noter que « pour être crue », signifie ici concrètement que l’assistante sociale a effectué un signalement, suivi d’effets bien concrets, et pas uniquement « être écoutée ».
L’anthropologue - et
quand vous dites euh, vous me disiez « ça … ça fout en l’air une
famille » ?
Micheline – Ben tout ça
hein parce que … Ben là, la dernière fois, la maman elle en veut quand même à
sa fille, hein, parce que du coup le papa il s’est retrouvé euh, il s’est
retrouvé en garde à vue, [inaudible], les flics n’ont pas été très tendres,
hein, ils ont dit que qu’il risquait de faire de la prison, ce qui est vrai
aussi, hein, heu, donc la maman en fait elle en voulait à sa fille parce qu’il
risquait de se retrouver au chômage, lui, de devoir vendre la maison … de, de …
il fallait que la gamine elle encaisse tout ça quoi. C'est-à-dire que la, la
maman elle en voulait à sa fille, elle comprenait la démarche de sa fille, tout
en lui en voulant.
La famille, habituellement conçue comme le lieu des relations affectives désintéressées par excellence, se trouve ici crûment mise en lumière dans ses aspects économiques les plus triviaux. Nécessités économiques auxquelles, on le voit, des sacrifices sont faits par la mère …
Micheline précise par ailleurs une spécificité des révélations d’abus sexuels (dont les incestes) par rapport à celles d’autres maltraitances. Alors que pour ces autres maltraitances, cela peut lui être rapporté par des copains ou copines de l’élève, les abus sexuels lui ont toujours été rapportés uniquement par l’élève directement concerné/e. Elle pense que c’est resté tabou vis-à-vis de ces copains-copines, parce que c’est sexuel, et qu’en collège :
Micheline - ils parlent
pas trop de leur sexualité à mon avis aux copains ou aux copines, ou quand ça
se passe bien, oui, mais ...
Dans le lycée professionnel où elle exerce actuellement, les révélations de maltraitances passent beaucoup plus par l’élève directement concerné/e, ou par les enseignant/e/s.
Je remarque que le fait que des adolescentes sachent spontanément que ce que leur fait leur père, c’est mal, au point de venir voir tout naturellement une assistante sociale, semble une évidence pour Micheline.
Pourtant, même dans le cas où l’incesté/e sait être victime d’un crime par son père, il semble très difficile qu’elle en parle hors de sa famille pendant les années où durent les abus. Lydia a été violée de ses 11 ans à ses 18 ans par son père.
Moi – Et quand tu
disais, tu voulais te fondre dans la masse, c’était pour … ?
Lydia – Toujours
pareil, c’est pour survivre, c’est pour me dire, c’est (…), si je laissais
transparaître mon mal, on allait se rendre compte de quelque chose, et ça
c’est, c’était primordial que je le fasse pas. Je ne pouvais pas montrer à
quelqu’un à quel point j’avais qu’une envie c’était de crever, et de toute
manière, je, je me suis toujours dit, ça par contre ça a toujours été fort,
« je m’en sortirai toujours ».
M – Hmmhmm.
L – J’ai toujours eu
cette petite lueur déjà des 18 ans : « faut que je tienne, que
j’aille vivre chez ma marraine (…). Ma marraine, le jour des 18 ans : ça
c’était ma, ma raison de vivre. Ca a été « il faut que je vive
jusque-là ».
M – Hmm. Que tu vives
jusque-là pour … ?
L – Pour pouvoir me
tirer. (…) [silence] C’est glauque ?
M- J’ai l’habitude (…). Tu sais je ne suis pas dépaysée …
Mais pourquoi attendre ses 18 ans, l’âge de la majorité, pour parler ou, simplement, faire transparaître le mal, alors que peut-être des adultes seraient prêts à agir ?
Lydia - je le faisais
pas transparaître, ce qui se passait, ça, non, parce que je, si ça se savait,
qu’est-ce qui allait m’arriver après, ça a toujours été ça. (…) si je le
disais, mais qu’est-ce qu’il va me faire, il va me tuer ?
Ici, ni révélation, ni communication, ni même sécrétion, et la tension devient tellement forte que Lydia a « envie de crever ». Envie qu’elle met à exécution entre ses 14 et 15 ans, mais le camion sur la nationale a, « hélas » me précise-t-elle, eut le temps de bifurquer.
Enfin, Lydia savait que ce qui lui arrivait n’était pas normal. Mais ceci pour une raison bien précise : un livre de témoignage, c'est-à-dire précisément un récit d’abus incestueux rendu public, trouvé dans la bibliothèque de sa sœur aînée.
Lydia – Ca je savais qu’y avait des trucs de pas
normal. (…) Quand j’ai lu le livre, j’ai su que ce qu’il me faisait, c’était
pas normal.
Moi – Euh, le livre de
Nat… ?
L – Nathalie Schweighoffer.
M – Oui, oui oui.
L - Donc, euh, ça a été un peu le déclic. Bon
après, ma vie n’a pas changé …
M – Tu … l’as lu à quel
âge ?
L – Je sais pas, je
devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Et euh …
M – Hmmhmm. Lire
« j’avais 12 ans », à 12-13 ans …
L – Euh, oui, je sais
même plus …
C’est sans doute cette conscience là, de l’anormalité de ce qu’elle subissait, qui lui permettra, dès l’autorité parentale du géniteur-incesteur sur elle rendue caduque, de dire à haute voix ce qu’elle savait depuis cette lecture : elle a été « violée par son père ». Lydia passe alors du silence absolu à la révélation la plus large.
Lydia –Mais euh, de
dire que j’avais été violée, victime d’inceste, j’en ai parlé très tôt, j’ai
commencé à en parler je devais avoir 18 ans, 18 ans et demi (…) Voilà, ça, ça,
ça venait toujours très facilement. (…) C’était un besoin, j’avais besoin de
dire ben voilà ce que, ce que j’ai subi et, p’t’être une manière de dire
« attention, je suis pas bien, je vais pas bien, j’ai des symptômes, j’ai
… », voilà. (…) Après j’ai eu mon boulot, j’en ai parlé au boulot, et bon
après j’ai eu des amis je leur en ai parlé, et puis qui voulait bien l’entendre
…
Moi – Hmmhmm, et
vraiment en ces termes : « j’ai été victime d’inceste » ?
L – Ah oui oui,
« j’ai été violée par mon père », oui.
M – « violée par
ton père ».
L – Oui. Oui oui.
M – Euh, ‘fin …
L – Oui oui, les
termes : « j’ai été violée par mon père ».
M – D’accord. ‘fin,
mais tu disais pas « victime d’inceste », à l’époque, tu disais
« violée par ton père » ?
L – Oh, si. Si si. Je
pouvais dire les deux.
M –Pour toi c’est, ça
existait sous ce nom là ?
L – Ouais ouais.
M – D’accord.
L – Euh, non, p’t’être
pas au début, non, effectivement.
M –C’est ça ma question.
Ainsi, la lecture de l’ouvrage de Nathalie Schweighoffer avait permis à Lydia de sortir de l’absence de mots pour penser et comprendre ce qui lui arrivait, de « penser aux viols comme à des viols » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 17). Mais pas, on le voit, en passant par le mot « inceste ».
De plus, son absence de tentatives de communication à autrui des abus qu’elle continuait à subir pourrait laisser penser qu’il s’est agi d’une « annonce manquée » : « Outre la position d’extériorité et l’autorité morale de son auteur, l’annonce requiert [en effet] d’autres conditions [pour réussir], dont beaucoup concernent l’incesté, le contexte et le moment de l’annonce. Si elles ne sont pas remplies, l’annonce est manquée et l’incesté se renferme sur son silence et sa représentation des faits » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 19).
Lydia s’est certes renfermée sur son silence, mais sa représentation des faits est bien devenue « je suis violée par mon père ». L’annonce n’a pas été manquée, mais n’a pu faire pleinement effet tout de suite, pour une raison non pointée dans l’article de Dussy : l’importance de la peur. Même si Dussy notait parmi les facteurs de réussite de l’annonce « la mort d’un ou des parents, le départ de l’incesteur du domicile familial … » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 20).
Dès lors, on peut commencer à entrevoir tout ce qu’il a pu y avoir derrière la venue d’une élève dans le bureau d’une assistante sociale en lycée professionnel, « pour être crue » …
Pourtant, malgré l’acharnement de Lydia à paraître « comme les autres », quelque chose aurait pu être remarqué lorsqu’elle était au collège : on l’y surnommait « la castreuse » car quand les garçons s’approchaient d’elle, elle avait tendance à lever le genou un peu fort. Elle m’explique que c’était une manière de dire aux garçons « je ne vous aime pas », et qu’elle avait envie de faire mal, même si elle leur faisait cela sur le ton de la plaisanterie. « Sécrétion » involontaire et imperceptible autour de ce secret ? L’agressivité envers les hommes ou les garçons ne fait nullement partie des divers « signes d’alertes » que m’ont cité les différent/e/s professionnel/le/s. Au contraire, concernant les filles, elles/ils se focalisent sur la sexualité « multipartenaires » qui pour eux/elles serait un signe que, peut-être, l’adolescente a subi des choses. Ceci me semble à mettre en parallèle avec cet autre signe d’alerte souvent mentionné concernant les enfants (sous-entendu : petits), à savoir le fait d’agresser à son tour plus petit/e que soi. Je ne sais pas quel est le sexe implicite de cet enfant qui agresse à son tour : est-ce un masculin sous-entendu, ou non ? Je sais en revanche que « l’orientation intime » (Bozon, 2001) multipartenaires « Pour les femmes (…), dans la plupart des sociétés (…) est un élément stigmatisant, qui signale la femme facile ou la prostituée. Seules les stars peuvent parfois échapper à cette dévalorisation. » (Bozon, 2001, p 18). Inversement, pour les hommes, « le réseau sexuel peut constituer une ressource et un élément de prestige et aller de pair avec une position dominante du sujet. » (Bozon, 2001, p 18), nous explique l’auteur après avoir développé plusieurs exemples français illustres. Pour les professionnel/le/s que j’ai rencontré/e/s, à la possibilité que cette orientation intime signale une « femme facile » ou plus ou moins « prostituée », il faut manifestement ajouter la « femme qui a eu des problèmes ». En aucun cas, cette orientation de type « réseau sexuel » n’est donc pensée comme neutre, ou positive, quand il s’agit d’une femme.
Lydia, quant à elle, reste pendant ce temps dans l’ombre, seule avec sa haine des hommes qui n’a éveillée l’attention de personne …
Ce qui ne transparaît pas dans les extraits cités ici de Lydia, c’est le fait que, peu après ses 18 ans, elle apprend que sa petite sœur va rester quinze jours seule avec son père, car leur mère va travailler. Ce fait a été un élément important qui a poussé Lydia à parler de l’inceste à sa marraine : elle avait peur qu’il l’abuse à son tour. Elle m’affirmait par ailleurs « avoir toujours vérifié », les années précédentes, qu’il n’avait pas abusé cette petite soeur …
Ce qui peut arriver à une petite sœur (ou un petit frère) semble un facteur important de communication lorsque soi-même on a grandi. Mais passé par le « filtre » des analyses des professionnel/le/s, cela peut être interprété de manières très différenciées.
Laurence, assistante
sociale en planning familial – Et là,
elle elle avait fait sa vie, donc une nana de 25 ans, mariée. Victime donc
d’inceste de la part du papa. Et elle venait me demander … euh … à ce qu’on
prévienne les flics parce que sa petite sœur était victime d’inceste.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Laurence – Donc elle,
il avait fallu attendre qu’elle quitte le circuit familial, déjà pour qu’elle
ait un soutien chez son, avec son, son mari, et dire « alerte, ma fille,
ma sœur est, victime d’inceste », là j’avais appelé la brigade des
mineurs. Ca avait été vite fait : ils avaient été la chercher.
Anthropologue –
D’accord.
Laurence – Mais là on
était passés par, enfin, la grande sœur était venue déposer ici pourquoi, parce
qu’elle avait confiance en nous.
Laurence met l’accent sur les difficultés qui expliqueraient cette arrivée si tardive, à 25 ans, de la dénonciation par cette grande sœur. Toute autre est la description de Christine :
Christine,
pédopsychologue en CMP - Et le fait d’avoir rencontré ces personnes, qui
pensaient bien faire vraisemblablement, hein, si tu veux a fait qu’un beau jour
j’ai vu débarquer Elise (…) que j’avais pas vue depuis, depuis, depuis, deux
ans, quelque chose comme ça. (…) elle allait menacer son père de porter
plainte, parce que c’était ça qui s’était tramé avec cette personne de
l’association. (…) Donc elle est arrivée avec ce, ce truc là en tête,
complètement vengeresse, donc pas bien du tout, en fait, c'est-à-dire avec,
donc, si tu veux, tout ressortir de tout ce qui s’était passé.
Et (…) elle m’a
re-sorti un truc dont elle m’avait jamais parlé avant (…). En fait il est
ressorti quelque chose qui me semblait euh, être très complexe, c’était que en
fait, après elle, il y aurait eu sa sœur.
Anthropologue – Hmm.
Christine - Et qu’en
fait il l’avait laissée pour sa sœur. C'est-à-dire que elle s’est mise à
construire une espèce de truc « il faut que je protège ma sœur », et
moi je sentais qu’elle était jalouse de sa sœur, en fait.
Anthropologue –Hmmhmm.
Christine – C'est-à-dire, tu vois comme c’est compliqué, là, hein. Parce qu’à la fois elle voulait punir le père, mais moi j’avais l’impression qu’elle voulait le punir de pas avoir fait ça qu’avec elle au moins, à choisir. C'est-à-dire que c’est comme si le père l’avait trahie de leur relation particulière. Comme si elle pouvait lui pardonner parce que c’était arrivé qu’avec elle. (…) En tout cas elle avait des doutes sur la fidélité, je veux dire, de son père à son égard, et le fait d’avoir replongé dans toutes ces histoires avec ce groupe de [une association], enfin du coup elle était dans, en ébullition, elle était dans un état de surexcitation je dirais, psychique, peut être physique aussi, d’ailleurs, j’en sais rien.
Cette personne, qualifiée ici de « vengeresse », avait subi les exactions sexuelles de son père alors qu’elle avait entre 3 et 8 – 9 ans.
Dussy cite quant à elle le cas d’Irina : « « (…) pour moi, c’est très rapidement devenu : « J’ai eu une aventure avec mon père ». J’en ai parlé longtemps comme d’une aventure. Parce que le mot « inceste », je ne connaissais pas. Je connaissais le viol (…), bon, donc c’était pas un viol, ça c’était sûr, et donc, ça ne pouvait être qu’une aventure. (…) j’en ai parlé avec une copine, et elle m’a répondu que c’était pas si grave, qu’il pouvait y avoir de très belles histoires entre un père et sa fille. (…) » » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 20).
Ces deux récits montrent des représentations de relations sexuelles entre un père et sa fille existant dans la société, parmi les victimes qui n’ont que ces mots pour penser ce qu’elles ont subi lorsque les abus se sont faits sans violence visible notamment (donc ce n’est pas un viol), mais aussi parmi les professionnel/le/s, qui pourraient pourtant en avoir d’autres.
Le point commun de ces deux descriptions ? L’occultation de la violence, le primat du « sexuel ». Qui nous mène autour des interrogations développées par Alice Debauche, expliquant que « Finalement, la question posée par cette comparaison [entre les résultats de différentes enquêtes statistiques incluant le viol dans leur champ] est celle de savoir si le viol relève de la sexualité ou de la violence. Susan Brownmiller (1976) considère ainsi que le viol n’est pas sexuel, qu’il s’agit uniquement de violence. Le viol ne se distinguerait pas des autres violences envers les femmes et le pénis serait une arme comme une autre. » (Debauche, 2007, p 92). J’ajoute que ce qui distingue la violence à caractère sexuel des autres formes de violences, c’est probablement de pouvoir être si facilement ramenée à de la sexualité sans violence. Au point que la jeune adulte est perçue comme en état de surexcitation « peut-être physique aussi » … alors que, probablement, elle veut tout simplement protéger, tardivement, sa sœur, après avoir été abusée, elle, durant de longues années.
Christine nous précise d’ailleurs que tout cela, c’est bien son interprétation à elle : « mais moi j’avais l’impression qu … ». Et cette version de l’histoire est bien différente de celle de l’incestée qualifiée de « vengeresse », qu’on lit en filigrane. Mais aussi de celles des incestées que j’ai eues en entretien : Paulette, qui veillait à être la seule abusée, à mettre à l’écart les cadettes dans sa famille d’accueil ; Lydia, qui se faisait du souci pour sa sœur cadette ; Danielle, qui s’en veut toujours pour sa petite cousine ; Aurélie, qui cherche encore comment arrêter l’incesteur, maintenant qu’elle sait qu’elle n’a pas été sa seule victime dans la fratrie … et apprend que, trop tard, il s’est déjà attaqué à ses enfants à lui.
Pourtant, la jalousie existe dans certains récits d’incestées : par exemple[33], Danielle, lors de la restitution auprès d’elle de mon travail de master 1, me relate ainsi que son unique cousine non abusée à l’époque semblait jalouse car l’incesteur s’occupait moins d’elle que des autres … Notons qu’ici, c’est en méconnaissance de la nature réelle de la relation avec l’incesteur, que la jalousie émerge chez ses « délaissé/e/s ».
Hormis quand il s’agit de protéger une petite sœur, les tentatives de rupture du silence autour des abus sexuels incestueux se font, le plus souvent, dans le cadre de relations suivies, personnalisées, qui existent dans certains contextes autour des adolescent/e/s et jeunes majeur/e/s. Elles ne viennent pas forcément du/de la jeune qui voudrait parler mais ne serait pas entendu/e. Elles ne sont pas non plus produites par un annonciateur tel que le théorise Dussy, c'est-à-dire une parole d’autorité qui « doit absolument nommer les faits » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 20).
Ainsi, Francine, si elle constitue une autorité morale en tant qu’enseignante, ne parle nullement d’inceste dans son cours de lettres – histoire.
Lors d’un travail autour des contes …
Francine, enseignante
en lycée professionnel - cet élève est intervenu juste après qu’on ait étudié
ce texte-là, où Bettelheim dit à un moment :
« A certaines
périodes de leur vie, et elles ne sont pas rares, tous les enfants croient qu’à
cause de leurs désirs secrets, sinon de leurs actions clandestines, ils
méritent d’être dégradés, exclus de la société des autres, relégués au rang le
plus vil. Ils éprouvent toutes ces craintes sans tenir compte de leur situation
réelle, qui est sans doute favorable ». Bon puis après il enchaîne sur le
fait de détester ses frères et sœurs, par exemple.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Francine - Donc
l’enfant se sent très coupable, et pense qu’il va être mis, exclu de la
société. C’est peu, quelques minutes après qu’on ait fini d’étudier, de lire ce
texte, que Laurent donc, a demandé la parole et a dit tout de suite « moi
quand j’étais tout petit, ben j’ai volé de l’argent enfin, y’a pas mal
d’années, j’ai volé de l’argent à ma mère et à mon beau-père pour m’acheter des
bonbons ». Donc j’étais assez surprise de cette intervention, parce qu’en
général, y’a pas d’interventions, euh, personnelles, particulièrement personnelles.
J’ai pensé que s’il le disait, il en avait besoin, donc une partie des élèves
ont ri, parce que ça les a amusés.
Et moi j’ai,
curieusement, à ce moment-là, je lui ai répondu qu’il devait être très
malheureux, et qu’il en avait besoin. Qu’il avait besoin de bonbons.
Alors il me semblait que je disais ça pour dédramatiser l’acte du vol, parce que, c’était une sorte de confession publique, et puis, donc quand je lui ai dit qu’il devait être très malheureux, à ce moment-là, pour quelque chose (je pensais : parce qu’il avait été grondé, ou on lui avait refusé un objet …dans ma tête c’était euh, quelque chose comme ça), et que donc ça lui avait fait du bien, il en avait eu besoin, d’avoir des bonbons, en tant qu’enfant, à ce moment-là et, je pensais que c’était le fait d’avoir avoué une bêtise, comme ces enfants qui se sentent coupables. Il m’a regardée avec un air particulièrement épanoui, comme s’il était très content que je lui dise (et là je comprenais pas très bien), que je lui dise qu’il devait être très malheureux et qu’il en avait bien besoin.
Suite à cela, l’élève est absent pour une assez longue période, « malade », explique l’administration à l’enseignante. Lorsqu’il revient, elle le trouve changé, un peu moins souriant, et très concentré.
Francine - Et comme il
était rentré je me suis dit que j’allais appeler ses parents. Parce que
quelque part, je sais pas, ça m’aurait gêné, j’y avais pensé, d’appeler pendant
qu’il était chez lui.
Et en fait j’ai décidé
d’appeler son père
Anthropologue – Hmmhmm.
Francine – Euh …
j’avais les numéros de téléphone des deux, j’ai, je sais pas pourquoi, enfin
j’ai décidé d’appeler le numéro de téléphone du père [parents séparés]. Donc
euh, j’ai appelé de chez moi, pour être plus tranquille, il me semblait que
c’était plus … et non pas du bureau en passant par le bureau [du CPE et des
surveillant/e/s].
Francine avait convenu dès le départ d’appeler s’il y avait souci, et en profite pour lui parler du TOC (Trouble Obsessionnel Compulsif) de l’élève, étrange, qu’il avait en cours, et qui consistait à sans cesse ranger ses affaires
Francine - Il semblait
très content de me parler, le père, et à ce moment-là je lui ai dit que je le
priais de m’excuser, mais que j’aimerais savoir si quand il était plus jeune il
avait eu un problème, un traumatisme, une perte, enfin ça peut être des grands
parents, parfois ça c’est déjà arrivé. Euh, quelque chose qui l’ait vraiment
perturbé à ce moment-là. J’ai pas osé dire « parce qu’il a un air
enfantin », parce que ça j’ai trouvé que c’était euh … un peu délicat,
mais à cause de ces TOC. Et, son père m’a répondu à ce moment-là, qu’il était
bien content de me parler, mais que de toute façon je savais, j’avais compris
(donc à ce moment-là je ne comprenais rien … ), que j’avais compris
que son fils donc était revenu s’installer chez lui, avait quitté sa mère et
son beau-père, et qu’il avait expliqué, donc, très récemment, qu’il avait subi
des viols de la part de son beau-père, justement de, dans cette période, cette
tranche d’âge, peut-être plutôt 10 ans, 13 ans, je sais pas, de 11 ans à 13
ans, je me souviens pas très bien. Donc que plainte avait été
déposée[l’adolescent a alors 16 ans] et que maintenant il vivrait euh, avec son
père. Et le père estimait que j’avais compris.
Francine, très surprise de ce qu’elle apprend là, me confie qu’au contraire, elle n’avait rien compris du tout … l’explication viendra plus tard
Francine - On a compris
après, que cette discussion sur les contes avait déclenché, et sur le fait
aussi que les enfants étaient pas coupables et se croyaient, enfin ça avait
fait interférence
Anthropologue –
Hmmhmmhmm. Hmmhmm.
Francine - même si
c’est pas exactement sa situation, plus la discussion sur la psychanalyse [qui
a suivi en cours celle sur les contes].
Ici, « l’annonce » ne porte pas sur les abus en eux-mêmes, mais sur les sentiments qu’ils produisent chez leur victime : la honte, la culpabilité. Cet exemple, surprenant, est intéressant par son éloignement d’avec la conception des campagnes dites « de prévention »[34] axées autour de la thématique « mon corps c’est mon corps ». Il montre quelques pistes possibles de réflexion sur « comment parler de « ça » aux enfants et adolescent/e/s de façon efficace sans les choquer ? ». Ou peut-être plutôt sans choquer notre vision à nous, adultes de ce que peut et doit entendre un enfant ? Il s’agit d’une annonce « en halo », qui permet d’entrer en résonance avec le vécu de l’incesté, sans du tout évoquer le corps sectorisé en parties intimes et non intimes, ou des actes sexuels. Cela ressemble beaucoup également à un « e-livret » de « prévention » réalisé par une ancienne victime d’inceste, Charlotte, sous le pseudonyme de Canacircus : « petit ballon violet »[35]. Aucun acte n’y est nommé ni montré explicitement, on voit juste le père entrer dans la chambre avec un air malveillant : manifestement la porte s’ouvre sous sa pression ... Petit ballon devient tout sombre, et son monde émotionnel est amplement décrit, à la suite de chaque nouvelle séquence d’abus (qui, eux, ne sont donc pas décrits explicitement, résumés à l’air/l’intention malveillante de l’incesteur). Petit ballon violet se peint tous les matins pour avoir l’air « comme les autres », se fondre dans la masse dirait Lydia. Il retrouvera peu à peu ses couleurs une fois la révélation faite et le mal qui lui est fait arrêté … nommer les émotions et le piège émotionnel dans lequel sont pris/es les incesté/e/s, une autre forme d’annonce ?
Un autre sujet « en halo » peut déclencher la communication autour des abus incestueux : il s’agit, tout simplement, des campagnes autour de la sexualité, telles celles que conduit Cécile, conseillère conjugale, pour le centre de planning familial.
Par exemple, dans le cadre d’une convention avec un certain nombre de maisons familiales rurales, il s’agit de trois séquences successives, d’une heure et demi chacune, devant les classes, où sont abordés des thèmes tels que l’estime de soi, la puberté, la contraception … il m’est précisé qu’un temps est consacré à la thématique des violences, mais avec ce bémol :
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial – Alors c’est vrai que bon, on n’a pas non plus
nous envie de les bombarder de la sexualité euh, qu’ils associent trop dans
leur tête euh, la sexualité avec tous les risques, parce qu’on va leur parler
des IST, sida, la contraception …
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Cécile – de la
grossesse non désirée, patin couffin, euh, des, enfin y’a plein de, plein de
choses qui sont je dirais, repérées d’une manière qui pour eux, sous un angle
quand même un peu euh, problématiques, risques, etcaetera
Anthropologue – Ouais.
Cécile – et donc du
coup euh, euh, par rapport à tous ces risques eh ben on va pas trop s’étaler sur, sur euh, tout ça à la fois,
(…) et faut pas qu’ils ressortent de nos séances avec en tête « la
sexualité égale risque », parce que bon.
D’ailleurs, ce ne sont pas ces communications autour des violences sexuelles qui déclenchent la majorité des multiples communications faites à Cécile : elle me précise que durant ces séances, elle tient surtout beaucoup à parler du plaisir et du désir. Et c’est précisément à partir de cela, que se font les communications auprès d’elle :
Cécile - la plupart du
temps, le, ce qui a été le, le facteur qui, qui a permis de libérer la parole,
c’est de parler justement de ça, c’est. Enfin, en fait, chaque fois, euh …
puisque ça a été, euh, attendez. Toujours des filles.
Anthropologue – Mouais.
Cécile – J’ai pas eu de
garçons. (…) Chaque fois, les filles m’ont parlé, de perte de, enfin qu’elles
avaient pas de plaisir (…), qu’elles avaient rencontré quelqu’un par exemple,
qu’elles aimaient bien, mais qu’elles n’éprouvaient pas, qu’elles arrivaient
pas à, à éprouver du plaisir au cours de la relation. Pas atteindre d’orgasme,
euh, et euh, elles venaient pour ça. Et donc, et de fil en aiguille, voilà,
heu. Jamais à la première séance, hein, au bout de, de trois, quatre, cinq
séances, facile, euh, (…) elles ont été amenées à, à parler de ce qu’elles
avaient vécu, et euh, voilà.
Et c … c …, l’accroche,
enfin, comment dire, l’accroche c’est un [inaudible], c’est pas, mais ce, ce,
ça a pratiquement toujours, j’essaie de réfléchir, mais à chacun c’était,
c’était un, une perte de
Anthropologue – Hmmhmm.
Cécile – C’était,
c’était ça. Elles l’ont abordé comme ça.
Anthropologue – Ca commençait
par elles venaient vous parler de, de cette absence de plaisir en fait ?
Cécile – Ouais.
Anthropologue – Hmmhmm.
Cécile – Et euh, donc
euh, c’est ça qui m’a confortée aussi de parler un petit peu plus du, du
plaisir et de, de ce qui euh, de ce qu’il y avait autour aussi.
Anthropologue – Hmmhmm.
Cécile – Et donc, c’est
un constat, mais euh, je me souviens pas de situations où ça a pas été relié à
ça. (silence) Bon c’est vrai aussi que, c’est peut-être biaisé par ma manière
d’intervenir où … où moi, enfin j’interviens de manière collective et
individuelle en, en parlant beaucoup du, du plaisir dans la relation. Du désir
et tout ça. Alors peut-être que … oui, ça s’est articulé euh, autour de ça
parce que c’était moi qui avais un peu induit ça, indirectement quoi.
Ces communications et discussions-là ne se font pas durant les séances en classe, mais lors des permanences auxquelles les jeunes peuvent venir ensuite, et qu’elle tient, tous les quinze jours, dans un autre lieu que leur établissement. Les jeunes y viennent, souvent en groupes ou en couples, chercher des préservatifs, des informations, puis poser des questions … et parfois, une jeune l’interroge alors sur le thème « moi, je n’ai pas de plaisir, je voudrais comprendre pourquoi ». Entre la première venue à une permanence, et la communication autour des abus incestueux, il s’écoule souvent beaucoup de temps : des mois, voire plusieurs années.
(interruption par
quelqu’un qui a besoin de photocopies, j’appuie sur pause)
L’anthropologue - Donc on
en était … on en était … heinnnn … oui, à la manière dont se font les
révélations, que … vous aviez à l’idée que ça se ferait de manière plus
directe, et que finalement non ça se fait de manière indirecte en fait.
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial – Oui, enfin, enfin, je m’imaginais quand même
pas qu’ils allaient tout de suite, d’emblée … mais que ce soit si long à
émerger, que, il y ait des stratégies un peu, d’approche, enfin voilà, de,
j’imaginais pas à ce point-là quoi. Voilà.
Anthropologue – Hmmhmm.
Et de la part d’adolescents, c'est-à-dire pas de, pas d’enfants tout
petits quoi en fait ?
Cécile - oui, d’ados.
Oui. Non non, de la période adolescente.
Anthropologue – Hmmhmm.
C'est-à-dire que même adolescents, il faut du temps, et …
Cécile – Hmmhmm.
Anthropologue - Et pour
des actes qui sont heu …contemporains, ou passés, heu ?
Cécile – Des fois
anciens. Oui oui.
Anthropologue – Des
fois mais pas toujours ?
Cécile – Oui, pas toujours. Enfin plus ou moins, mais euh, c’est rarement quand même … enfin souvent c’est, moi les actes que j’ai eus c’était plutôt assez ancien.
.
On peut avoir un éclairage sous un autre angle, des communications graduelles en lien avec l’absence de plaisir sexuel : Danielle, non seulement n’a pas de plaisir, mais a un déclic.
Danielle - Et la
première fois que j’ai eu un rapport sexuel, ça a été … (silence) … je me suis
mise à chialer. Je, je, d’un seul coup, d’un seul coup je comprenais qu’y avait
quelque chose qui allait pas du tout, et euh que, ce qui s’était passé c’était
pas normal, que, que … (…)
Moi - Donc tu lui en
avais parlé à lui avant d’en parler à ta grand-mère en fait ?
D - Oui en fait, oui.
M - Hmm. Il avait réagi
euh ?
D - Il avait réagi, je
lui avais pas dit qui c’était, je lui ai dit que, j’avais eu des problèmes
quand j’étais petite avec quelqu’un, et euh, ‘fin, je lui avais pas dit qui
c’était, je lui avais pas dit que c’était de la famille, je lui en ai parlé
vraiment très, très succinctement quoi en fait.
M
- Ouais.
D - Je voulais pas euh,
je sais pas, je je, mais je pense que c’est à ce moment, c’est en lui en
parlant, en, en même temps que je lui en parlais, que je me rendais compte que,
de ce qui s’était passé.
Et il faudra encore plusieurs mois avant qu’elle en parle à sa grand-mère, elle-même abusée sexuellement durant son enfance, qui, en contactant toute la famille, fera mettre au jour que cet incesteur y avait abusé dix enfants, cependant que le beau-père de Danielle s’occupe de contacter un avocat qu’il connaît pour porter plainte en Justice.
La communication est ici graduelle au point de se faire d’abord à soi-même : ce n’est pas suite à la rencontre avec un « annonciateur » qui nomme les faits, que Danielle change de représentation autour des abus qu’elle a subis, mais suite à un acte, à la fois similaire et différent de ces abus. Ensuite, elle n’ose pas dire que l’agresseur est un proche, encore moins qu’il est un incesteur. C’est au bout de plusieurs mois qu’elle ira communiquer cela à une personne qui joue pour elle un rôle maternel important : sa grand-mère. Il faut d’ailleurs remarquer que l’élève de Francine n’était pas venu se confier à Francine, mais à son père : même à l’adolescence, les parents restent finalement parmi les dépositaires de premier choix.
Un autre type de relations personnalisées et suivies est la rencontre avec un/e « psy ». L’unique communication d’abus incestueux faite à l’occasion d’une thérapie par une mineure d’âge, nous est racontée par Christine :
Christine,
pédopsychologue en CMP - elle a mis un an pour me dire de quoi il
s’agissait. Moi je l’ai récupérée parce qu’elle faisait des malaises au lycée.
(…) on est devenues assez proche, euh, je crois qu’elle avait bien compris que
j’avais compris qu’il y avait quelque chose, d’autre, mais que je, j’avais, que
je respectais qu’elle … puisse pas le dire tout de suite. Je lui ai dit
d’ailleurs. Je lui ai dit « écoutez, bon ben je sens bien qu’il y a
d’autres choses qui sont compliquées derrière votre problème de sommeil. Mais
bon, ben vous en parlerez quand vous pourrez, puis on verra bien ».
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Christine - Et puis un
beau jour, elle me, elle me l’a dit entre deux portes. Et elle a filé ensuite.
Anthropologue – Entre
deux portes ?
Christine – Ca c’est
fréquent. Ca c’est très fréquent, alors les gens disent les choses intér,
enfin, intéressantes, non pas que le
reste le soit pas, mais ils disent des choses importantes entre deux portes,
très souvent. Il peut y avoir des gens qui discutent pendant une heure de tout,
de la pluie, du beau temps, de la grand mère, du marché, du prix du j’sais pas
quoi, du chômage
Anthropologue – Hmmhmm.
Christine – de tout ce que tu veux, de l’éducation et tout ça, et puis ils vont dire les trois mots importants quand ils sont déjà à moitié dehors. Ca c’est, c’est très très, c’est très classique.
Ici, Christine parle d’une adolescente dont elle me précise d’emblée qu’elle l’aimait beaucoup, avant de m’en faire une longue description, qui me la fait aimer à moi aussi : c’est communicatif ! Elle n’émet aucun doute sur le fait que « le tonton » l’a incestée, et ne fait cette fois aucune allusion autour d’un caractère « vengeur » ou « jaloux » de l’incestée.
C’est aussi Christine qui tente une explication des raisons pour lesquelles, comme elle l’a observé de son côté également, tant de communications autour d’abus incestueux se font à l’adolescence, pour des faits datant de l’enfance. Elle nous parle ici des nombreuses histoires datant de l’époque où elle en a eu beaucoup, il y a dix – quinze ans (c'est-à-dire entre 1995 et l’an 2000).
Christine - Alors très
souvent, les histoires incestueuses, (…) c’étaient des histoires d’enfant
répercu, qui revenaient à la surface, qui étaient plus ou moins, qui devaient
un peu euh, être un peu oubliées écrasées pendant la phase de latence, et qui
revenaient avec les pulsions adolescentes.
Anthropologue –Hmm.
Christine - Ca c’est un
peu normal sur le plan psychologique pour le coup, si tu suis l’évolution, puis
avec la montée pulsionnelle de l’adolescence, c’est vrai que toutes ces
histoires d’enfance, ça revient hein.
La « montée pulsionnelle » pourrait bien être un résumé, très succinct, de ce que Danielle, Cécile et Laurence nous ont fait parcourir : l’adolescence est, fréquemment et concrètement, le moment des premiers rapports sexuels. C’est aussi, de ce fait, un moment de relative multiplication des interlocuteurs/trices dans notre société : examen gynécologique, contraception, avortement … sont autant d’occasions de remise au jour, réussies ou manquées, de toutes ces « histoires d’enfance ».
Lydia, Francine et Micheline nous rappellent que l’adolescence peut aussi être le moment où se produisent les abus sexuels incestueux, et qu’il reste rare que la situation soit communiquée avant la mise à distance de l’incesteur. Cette mise à distance s’effectuant en termes de perte de pouvoir légal (Lydia), ou bien géographiquement. Enfin, cette mise à distance peut être celle, temporelle, des abus eux-mêmes.
Marcelo Viñar évoque cette question de la mise à distance temporelle dans d’autres contextes : ceux de violences extrêmes dans l’espace public, comme la torture en Amérique Latine ou l’extermination massive lors de la Shoah. Il relate l’exemple de Jorge Semprún : « Peut-être le titre de l’œuvre de Jorge Semprún, L’écriture ou la vie, où l’auteur témoigne de son expérience d’un camp de concentration et qu’il dut couver quarante ans avant de pouvoir l’écrire, indique-t-il avec éloquence l’hétérogénéité radicale entre la chose (innommable) et sa représentation comme récit. » (Viñar, 2005, p 1217-1218). Une caractéristique de la terreur est en effet que « La terreur est destruction de la valeur métaphorique du récit, destruction de l’organe psychique (Gantheret) ; la victoire du bourreau est de rendre le souvenir insupportable. » (Viñar, 2005, p 1217).
C’est pourquoi, dans cette autre expérience de terreur qu’est l’abus sexuel incestueux, des adultes peuvent mettre 10, 20, 30 ou 40 ans avant de … se communiquer à eux-mêmes le secret oublié qu’ils/elles portent, comme nous le relate Irène.
Irène, pédopsychiatre
libérale - il y en a certains qui, qui ont toujours cela, pas présent à
l'esprit, mais enfin qui ont toujours cela dans un coin de leur mémoire qui est
mobilisable. Mais quelques fois effectivement, c'est vraiment de l'oubli. Et
d'un seul coup, au décours d'une conversation, etcaetera, il y a un souvenir
qui leur revient, qui leur revient d'une façon très très précise et ils se
disent "tiens, là ...", et à ce moment-là souvent ils sont, pour
quelques uns ils savent pas si quelque chose s'est passé ou pas, ils ont une,
un espèce de doute qui subsiste tout le temps ("est-ce que c'était
vraiment ça ? Est-ce que c'était pas ça ?", ils ne savent pas). Et puis,
ou bien, ou bien ils ont, ils n'ont pas été victimes de, de, de, d'incestes ou
d'attouchements réels, mais plutôt d'une situation incestueuse ou d’une
situation de séduction de la part d'un adulte, donc ils ont, ils ont un
souvenir qui est là pas très clair, de quelque chose euh, qui est pas net. Et
puis, pour les autres, il y en a à qui effectivement revient une scène de, une
scène comme ça, très très précise, d'un moment de leur vie, où ils ont
réellement été abusés par euh, par un plus grand, par un adulte.
Dussy distingue différentes formes d’amnésies : « L’amnésie, ce moyen psychique génial inventé pour se défendre contre la brutalité sidérante de certains événements traumatiques. (…) Quand on ne l’a jamais vécue, on croit parfois qu’elle agit comme un coup de gomme. Elle provoquerait un trou dans la mémoire, repérable par la personne qui la vit comme une cassure ponctuelle et localisée. (…) Les neurologues disposent d’exemples nombreux illustrant ces cas d’amnésie partielle qui surviennent notamment après des chocs accidentels. » (Dussy, 2004, p 9).
En somme, dans cette forme d’amnésie, le « trou », repérable, constitue comme une sécrétion rappelant à la personne qu’elle porte un secret … vis-à-vis d’elle-même !
Mais en revanche, « Si
l’amnésie est totale, la situation est différente : on ne sait pas qu’on
est amnésique. On ne sait pas qu’on ne se souvient pas, donc on ne sait pas ce
dont on ne se souvient pas. » (Dussy, 2004a, p 9).
On est alors, vis-à-vis de soi-même, dans la position identifiée par Zempléni comme celle de l’intrus ! L’intrus, qui n’est autre que « le destinataire (…) du secret de son exclusion de la communication et du partage » (Zempléni, 1984, p 105). Et « L’événement sous amnésie se présente alors dans la vie quotidienne des personnes qui en sont victimes un peu comme un iceberg dont pas un morceau n’affleure : les désirs et les projets y achoppent de façon inexplicable, sans que les outils habituellement utiles que sont le raisonnement logique et le savoir rationnel permettent d’y voir plus clair ; Et, comme Louise [dont Dussy développe l’histoire], on se construit, on agit, on vit, portant avec soi des émotions et des sensations réactives à une expérience qui organise toute la vie mais dont on est totalement sans mémoire. (…) [Ainsi, ] La honte de Louise l’a quittée à ce moment-là [à l’âge de 54 ans ( !)], quand s’est enfin levé le secret qu’elle se tenait à elle-même » (Dussy, 2004a, p 9-10). Secret qui était d’avoir subi des abus sexuels de son frère, lorsqu’elle était enfant.
Mais c’est dans un autre article que Dussy évoque cette « espèce de doute qui subsiste tout le temps » sur la réalité, dont nous parle Irène : « Comme l’héroïne d’Une femme disparaît d’Hitchcock, qui ne peut compter que sur elle pour attester l’existence de la femme disparue, seule la victime d’inceste peut certifier des abus sexuels qu’elle a vécus (…). Comme dans le film encore, où tout porte à croire que l’héroïne est folle – elle-même finit d’ailleurs par douter, il n’est pas rare que l’aveuglement et le négationnisme ambiant conduisent un enfant incesté, puis l’adulte qu’il devient, à ne plus savoir où est la réalité. » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 16).
Aurélie nous en donne un exemple :
Aurélie – Si moi
j’avais pas subi, j’aurais du mal à y croire. Puis alors euh, bien sûr, c’est
beaucoup plus facile à réaliser mais, quand même, je me disais « mais
est-ce que [inaudible],
Moi – Oui, oui, oui.
A - est-ce que c’est
bien réel ? ».
M – Au fond de
toi-même, euh, pour toi, ça a toujours été réel ?
A – Ca a toujours été
réel. Et quand j’en ai eu parlé avec qui, des fois, remettaient un peu en
question ce que je disais, euh, pendant trente secondes, [inaudible]
« mais c’est un mauvais film, euh, je, je … », je me remettais quand
même un peu en cause.
Réel qu’Aurélie porte, durant des décennies, comme « en sommeil », peut-être dans un coin de sa mémoire, jusqu’à ce que des problèmes au travail, des décennies plus tard, provoquent chez elle des somatisations (chutes de tension, etc) qui la forcent d’une part à démissionner, d’autre part à replonger dans ces souvenirs-là via une psychothérapie.
La communication peut également intervenir après des mois voire des années de cure, les personnes étant venues alors pour des symptômes ou à un moment de crise dans leur vie.
Irène, pédopsychiatre
libérale - il y a souvent des révélations de ce type qui viennent tout de
suite, ou au bout de nombreuses nombreuses années ou ...
L’anthropologue - Hmm.
C’est, oui, c’est … des, heu, les révélations, de, de quelle manière elles vous
parviennent, au niveau des adultes … justement ?
Irène - Ben, c’est un
moment où il se met à en parler, hein. C'est-à-dire que bon, y’a des gens qui
vont raconter ça d’emblée, le poser sur la table, euh, bon, comme quelque chose
qui devient presque des fois un petit peu gênant parce que d’un seul coup on
s’accroche à ça, et puis des personnes qui n’en, qui n’en, qui mettront très
très longtemps à en parler parce que c’est, y’a, elles ont honte de le faire,
ou c’est jamais le bon moment pour euh, parler de ça. (…)
Et puis quand ceux aussi qui vont avoir oublié, et d’un seul coup ça leur reviendra.
Lorsque je demande à Irène de me donner un ordre de grandeur du nombre de patient/e/s concerné/e/s, chez elle, ce serait environ un sur dix, parmi les adultes puisqu’au niveau des enfants, elle n’a jamais eu de communication d’abus incestueux par l’un/e d’eux durant une cure. Et parmi les motifs qui ont amené ces adultes à la consulter, elle me cite des symptômes comme la boulimie, qui éveillent maintenant son attention à cet égard. Egalement, des problèmes de ces personnes vis-à-vis de leur corps et sexualité, ou bien au moment où elles ont des enfants, dans leur rapport avec le corps de ces enfants, dans le souci de trouver la bonne distance avec eux, etc. Ces motifs ressortent tous, finalement, du rapport au corps (le sien ou celui de l’enfant), dans la sphère privée.
En revanche, il nous faut nous tourner du côté d’Aurélie et Agnès pour ajouter un motif important : les problèmes rencontrés au travail, qui entrent pour elles en résonance avec leur passé familial, déclenchant les symptômes (fortes angoisses, chutes de tension, etc), voire la désoccultation des souvenirs, qui vont les pousser à consulter un/e professionnel/le du psychisme (Perrin, 2008, p 50 – 52).
Enfin, si la cure psychothérapeutique s’avère, à l’âge adulte, un lieu fréquent de communication à soi-même et à autrui, les problèmes rencontrés par certain/e/s, mais pas tou/te/s[36] , vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants peuvent les conduire à être suivi/e/s par des personnels de service enfance, dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires, pour leurs enfants.
Ainsi, Francis, éducateur en service enfance, sait qu’il a, parmi ses suivis, deux parents (des mères) qui ont été incestés durant leur enfance. C’est à l’occasion des rendez-vous réguliers qu’il a avec elles, que cela lui a été confié durant leurs discussions. De même, Fabrice, assistant social en service enfance, nous raconte comment dans ce cadre, une mère de 35 ans lui a communiqué ce morceau de son histoire, toujours dans le cadre d’un tel suivi.
Fabrice, assistant
social en service enfance - Donc oui, y’a eu cette situation là, aussi …
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Fabrice –
(pensif : ) Cette situation là …
Anthropologue - Donc
toujours au Conseil Général en fait ?
Fabrice - Non, là
c’était quand j’étais à l’UDAF. C’était quand j’étais à l’UDAF. Là elle me l’a
dit, ouais …
(Silence)
Et là, comment elle me
l’a dit ? Ben parce que, l’entretien, à un moment donné, y’a eu un sous
entendu, et … heum … moi je lui dis : « j’ai l’impression que vous
êtes en train de dire que votre père vous a abusée ».
Anthropologue – Ouais.
Fabrice – Donc elle a
laissé le sous-entendu et moi je l’ai int…
Anthropologue –
D’accord. Spontanément ?
Fabrice – Je l’ai
prolongé.
Ben, ça me paraît,
alors je vais pas, je me rappelle plus hein, de comment c’est. Mais ça je me
rappelle que, elle avait laissé le doute, et moi je lui ai dit « mais j’ai
l’impression que vous êtes en train de me dire que … ».
Anthropologue – Hmmhmm.
D’accord.
Fabrice – Mais c’est,
on va dire, voilà. Dans la dynamique de l’entretien, c’est … Alors ouais,
peut-être que je fais partie de ces gens, à un moment donné, à force de voir
les … euh, voilà.
Anthropologue - à force
de voir les ?
Fabrice - Les gens. Les
usagers, euh ben peut-être qu’à un moment, la relation de confiance était là,
et puis euh, ils ouvrent la porte, et puis après, à voir, est-ce que le
travailleur social va y rentrer ou pas, quoi, est-ce que il va ouvrir ce,
est-ce que ça va lui venir à l’esprit, quoi ?
Anthropologue – Et,
parce que ça faisait plusieurs fois que vous la voyiez déjà ?
Fabrice – Oui oui,
j’avais, je travaillais. Mais bon, c’est toujours dans les relations
éducatives.
Anthropologue – Ouais.
Toujours dans les suivis.
Fabrice - Voilà, voilà.
En gros.
Anthropologue –Mais par
contre effectivement, c’est des adultes du coup ? ‘fin c’est …
Fabrice - Ouais, là
c’était une adulte. On va être obligés de s’arrêter, mais je m’aperçois que
j’ai répondu à rien du tout là hein.
Anthropologue - à rien
du tout ?
Fabrice - Si, un peu
quand même ? Vous allez en faire quelque chose ?
C’est ainsi que se termine l’entretien avec Fabrice. Et bien sûr, que j’en fais quelque chose … En revanche, aucun enfant n’a confié, dans le cadre d’un suivi, à Fabrice ou Francis, avoir été incesté/e. Dans certains contextes, ces deux professionnels me relatent en revanche avoir reçu quelques révélations de maltraitances physiques, non sexuelles, par des mineur/e/s[37].
Finalement, malgré la sensation d’en avoir « trop fait » autour de la pédophilie auprès des enfants, les communications d’abus sexuels incestueux restent, durant cette première décennie des années 2000 en France métropolitaine, rares de la part des enfants, qui ont peu de recours auxquels penser dans ces cas : leurs parents, et c’est à peu près tout. Ainsi, malgré l’opinion prégnante selon laquelle « maintenant, les enfants peuvent parler », ce sont surtout les adultes et les adolescent/e/s, à distance des faits (et de l’incesteur), qui y parviennent.
A cet égard, un parallèle est possible avec ce qui est visible sur internet : on y trouve des sites d’associations pour et par des adultes ayant été incesté/e/s … et des sites d’associations sur les enfants maltraités ou victimes de pédophilie. En particulier, la cyber-pédophilie semble concentrer beaucoup d’attentions. La zone d’ombre, de fait, dans ces affichages associatifs sur internet ? Les enfants victimes d’inceste, et leurs éventuels « parents protecteurs ».
Les communications sur les abus incestueux subis s’effectuent en fait tout au long de la vie des incesté/e/s. Le plus souvent quand le contexte abusif s’est relâché : éloignement géographique et/ou légal de l’incesteur (majorité de la victime, séparation des parents …), éloignement temporel. C'est-à-dire qu’avant, ou plutôt pendant, il était trop tôt pour pouvoir penser par exemple « je suis en train de subir des viols incestueux », et après, il est trop tard pour arrêter pour soi les abus qui sont déjà passés, parfois même trop tard pour pouvoir porter plainte. Mais c’est seulement alors, que, la terreur et la sidération s’atténuant, elles deviennent pensable et communicable, à soi-même pour commencer. Encore faut-il trouver des mots qui nomment les abus incestueux comme constituant des abus démolisseurs, et non comme une « aventure » amoureuse normale avec papa ou un/e autre apparenté/e, d’où le rôle de l’annonciateur. Annonciateur qui peut nommer les actes comme abusifs, ou évoquer des émotions qui ont été produites par ces actes comme injustement placées (honte, culpabilité …) ou encore anormalement absentes dans des relations choisies par la suite (plaisir sexuel).
L’éventualité qu’un autre enfant puisse être à son tour abusé par l’incesteur peut dans ce contexte de mise à distance des abus précipiter la nécessité de communiquer qu’on a subi un inceste.
En outre, les adultes se préoccupant de la sexualité naissante des adolescent/e/s (ainsi que de leur possible mal-être pensé comme lié, précisément, à l’adolescence …), ces dernier/e/s, et surtout ces dernières, ont alors un peu plus d’interlocuteurs/trices possibles, hors de leur famille, pour communiquer autour des abus incestueux.
Du moins lorsqu’ils ont commencé à être à distance. Ce qui fait apparaître un non dit fréquent chez les professionnel/le/s : la mise sous terreur des incesté/e/s mineur/e/s est évoquée uniquement, dans mes entretiens, par les incestées elles-mêmes. L’absence de mots pour penser et dire les abus comme des abus est également évoquée uniquement par les incestées, et cette fois suite à question de ma part autour du thème « pourquoi n’as tu pas pu en parler alors ? ». Ce qui signifie que ces deux éléments ne sont pas pensés comme fondamentaux à citer, pour les professionnel/le/s, afin d’instruire l’anthropologue sur ce thème.
C’est, enfin, à l’âge adulte que les communications parviennent parfois, par les incesté/e/s, au cours d’une cure, aux professionnel/le/s du psychisme. Lorsqu’il s’agit de mineur/e/s, plus encore d’enfants, ceci semble impensé pour les professionnel/le/s du psychisme, et d’ailleurs aucun/e parmi ceux/celles contacté/e/s n’a eu de communication par un enfant à l’occasion d’une cure.
Ce dernier constat pose, en creux, la question de « à qui » est-il possible de communiquer qu’on a subi des abus incestueux ?
Certain/e/s professionnel/le/s concentrent beaucoup plus de communications que d’autres : ce peut être du à leur activité, par exemple il peut sembler logique qu’une enseignante n’ait pas 40 communications d’abus incestueux tout au long de sa carrière. En revanche, comment expliquer que la conseillère conjugale interviewée me dise au téléphone, l’air tout naturel, qu’elle en a environ quatre ou cinq par an, cependant que d’autres trouvent déjà beaucoup d’en avoir eu une ou deux en une carrière ?
Souvent, les confidences sont faites à un/e professionnel/le pour qui l’éventualité d’abus sexuel, et plus encore, d’inceste, fait partie du pensable, des hypothèses imaginables. Fabrice, cité juste au-dessus, suscite activement la communication par sa relance : « j’ai l’impression que vous êtes en train de me dire que votre père vous a abusée ».
Il s’agit de relances, ou de questions, qui proposent à l’incesté/e l’éventualité que cela lui soit arrivé : Cécile procède fréquemment ainsi, sans même y penser, comme avec Nathalie, incestée par un quasi-frère dans le cadre d’une famille recomposée.
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial – [Nathalie] me connaissait bien, puisqu’on
avait travaillé ensemble sur ce projet, et tout ça. Et un jour elle vient me
voir, aussi, pareil, euh, elle multipliait les relations, mais, très, vraiment
sans lendemain quoi.
L’anthropologue – Les
relations ?
Cécile - Avec des petits copains, et puis voilà.
Anthropologue – D’accord.
Cécile – C’était le
petit copain d’un jour, d’après ses copines. Ouais. Elle passait facilement de
l’un à l’autre, et elle elle était dans une, dans cette forme de sexualité.
Elle a … heum … comment c’est venu ? Un jour, elle, elle me dit
« ouais, mon problème, c’est que j’ai jamais de plaisir, j’aimerais bien
comprendre pourquoi, etcaetera ». Et puis, bon, de fil en aiguille, elle
me raconte que … Alors, en géné, enfin, très clairement, moi, quand des personnes
me disent « j’ai pas de plaisir », qu’on essaie de creuser et tout,
j’évoque, la situation : je dis « des fois, c’est aussi parce que on
a pu subir des violences, enfin, et euh, et là, elle saisit la balle au bond et
euh, elle me dit euh oui ben, ce qui s’est passé, en fait. Mais c’est pas,
« c’est pas mon frère, c’est pas un inceste ».
L’absence de plaisir constitue l’équivalent d’un « signe d’alerte », d’un indice, qu’explore Cécile par sa relance sur le thème des violences. Irène a repéré un autre « signe d’alerte », concernant les adultes qu’elle suit : la boulimie, dont elle m’explique qu’elle fait souvent suite à de tels abus, et …
Irène, pédopsychiatre
libérale - Quand on interroge les … les patientes boulimiques, y en a beaucoup
qui, ben, peut être si on leur pose la question, mais peu de monde leur pose la
question
L’anthropologue –
Ouais.
Irène - qui vont aussi
retrouver ou décrire des situations comme ça où elles ont eu à, à, à voir euh,
à subir quelque chose sur le plan physique.
Anthropologue - Quand
vous dites leur poser la question, c’est ?
Irène - Leur demander
si effectivement il y a eu des attouchements ou des abus sexuels.
Ici, la question ou la
relance nomme clairement les faits, et peut donc faire office d’annonce, au
sens où l’entend Dussy.
Mais pour la
majorité des professionnel/le/s que j’ai interviewé/e/s, l’inceste est un
impensé. Dès lors, nous allons nous situer dans le registre du malentendu,
comme c’est le cas pour Francine, ou bien du « il y a quelque chose, mais
je ne sais pas quoi », relaté par Laurence.
Un malentendu :
Francine ne s’imaginait absolument pas avoir déclenché une communication
d’inceste, suivie d’une plainte et d’une condamnation de l’incesteur. Elle
avait bien repéré cet élève et « ses TOC ». Elle avait bien pensé
qu’il pouvait avoir vécu une forme de traumatisme. Mais pas ce
traumatisme-là. Et pourquoi ?
Francine, enseignante
en lycée professionnel - Moi je pouvais être que dans une vision de la famille,
euh, ou de la belle famille quoi, très positive : c'est-à-dire il a eu un
petit malheu, un malheur, ou c’est, son grand père est mort, et depuis, il est
perturbé.
L’anthropologue -
Hmmhmmhmm. Et jamais tu … ?
Francine - Non je
pouvais pas imaginer. J’avais vu la mère des mois avant, j’avais vu le père
même s’ils vivaient pas ensemble. Ben je voyais pas euh, la mère (maintenant il
y a toujours un père et un beau-père, bien sûr), mais comme quelqu’un qui peut
maltraiter un enfant, ce qui est totalement absurde puisqu’on peut avoir des
surprises parfois.
Laurence, assistante sociale
en planning familial, relate quant à elle toutes ces fois où, elle ou une
collègue, perçoivent qu’ « il y a quelque chose » :
Laurence, assistante
sociale en planning familial - la fille elle va pas arriver en disant
« clap » [claquement de doigts] « j’ai été victime
d’inceste »[38], alors là,
non.
L’anthropologue –
(rires) Hmmhmm.
Laurence – Hein, mais
nous on va … le comment, le … on, on perçoit quelque chose, y’a quelque chose
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Même moi où
j’avais, ce que je vous disais un petit peu au téléphone l’autre jour, ben moi
j’ai des situations même où je travaillais à [lieu] je me dis « y’a
quelque chose » [chuchoté : ] y’a quelque chose.
Puis, vous savez, vous
pouvez pas toujours penser euh … puis au bout du compte c’est toujours ça,
c’est toujours une histoire d’inceste au bout du compte.
Dans ces cas, quelque chose
du secret est sécrété par l’incesté/e, à son insu, et le sentiment qu’il y a
quelque chose peut partir de petits riens :
Laurence - Une histoire
aussi avec un médecin, là, mais un truc de fous. De fous, de fous. Bon
c’était le cas d’une jeune fille, donc euh, [le médecin] la, la voit, euh, très
sympa cette nana, je vois bien sa tête. Mais régulièrement, pour un suivi
gynéco, machin, patin couffin, toujours pareil
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Alors elle,
elle acceptait l’examen gynéco, mais des gros gros problèmes au niveau des
rapports sexuels, des mycoses à répétition, des machins, des [inaudible].
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Et puis bon,
on avait un bon feeling, même, avec ma copine médecin, on est vraiment potes,
voilà. Puis elle m’a dit [chuchoté : ] « y’a quelque chose, chez
cette nana, mais je sais pas quoi ». Bon.
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence - Et de toute
façon ça sert à rien de leur demander, parce que, il faut que ça sorte on est
bien d’accord hein, le temps de l’entretien, tout ça. Et une fois, elle
appelle, et elle demande à me parler à moi, et à Madame [nom], le médecin du
jeudi, du mercredi. Et là, pssshhhhhjjjjj ! Elle nous sort …
Cela ne sert à rien de leur
demander ? Ou bien l’on ne pense pas à leur demander, parce qu’on ne pense
pas à cette éventualité, voire, on n’a pas vraiment envie d’y penser ?
L’anthropologue - Quand
vous dites ça, ça vous émeut, par exemple quand vous avez cette personne euh
qui est enceinte de six mois et vous apprenez que c’est le demi-frère ?
Laurence – Ben vous avez un,
un instant de sidération, parce que, même si on vous apprend, en tant que
travailleur social, à faire des hypothèses
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Hein, quand vous
faites un entretien, vous faites des hypothèses.
Anthropologue – Ouais.
Laurence - Eh ben celle-là,
à tous les coups vous y avez pas pensé.
Anthropologue –
D’accord. Même en ay, même en ayant déjà eu ce, ce genre de
choses euh …?
Laurence - Je vais quand même pas penser à chaque fois que c’est une histoire d’inceste.
Michel de Certeau disait
quant à lui que « la torture, on ne veut rien en savoir, on ne peut y
croire non plus » (cité dans Viñar, 2007, p 53). L’inceste, cela
semble donc souvent un peu pareil, même quand on y croit. On préfère
fréquemment ne pas y penser, éviter d’y être confronté/e. Comme l’explique
aussi Francine, en toute honnêteté :
L’anthropologue - Dans
les livres, c’est un peu loin, c’est … ?
Francine, enseignante
en lycée professionnel –C’est loin, c’est un peu irréel, donc là tout d’un
coup, ça devient … quelque chose de réel. Par la suite, je me suis souvent dit,
je crois n’avoir jamais refait le texte de Bettelheim, ça c’est pas très
courageux. (…) … mais je me suis dit après, par la suite, au bout de 2 ou 3 ans
ça m’est un peu passé, mais en début d’année, quand j’avais une classe de 24 ou
de 30 face à moi, je me disais « ben statistiquement, il y en a peut-être
bien un ou une, ou peut-être deux ». Ca m’a changé complètement cette
vision.
Ce n’est pas très courageux,
en effet, de ne plus utiliser ce texte, au moment même où l’on réalise qu’il y
en a peut-être bien un ou une, statistiquement, qui pourraient y réagir, dans
la classe, à chaque fois … mais comment faire face à cette réalité ?
Comment faire
face à cette réalité, cependant que, précisément, même lors d’une simple
enquête statistique sur le viol (pas uniquement sur les viols incestueux) les
enquêteurs/trices s’avèrent durement éprouvé/e/s du fait de la fréquence élevée
des viols déclarés ?
Sharman Levinson relate que
lors de la passation des questionnaires pour cette enquête CSF, menée par l’INED
et l’INSERM en 2006, « Les enquêteurs, comme l’ensemble de l’équipe de
recherche, ont été très vite surpris de la fréquence élevée des déclarations de
violences et d’abus sexuels (…). Cette fréquence, souvent évoquée lors des
pauses, juste après un entretien ou lors des trajets (les enquêteurs prenant
ensemble les transports en commun échangeaient sur le déroulement de l’enquête)
est rapidement devenue synonyme de « bonne » ou de
« mauvaise » journée passée, et une réponse toute naturelle à la
question « comment ça va ? » pouvait être : « j’ai eu
beaucoup de viols aujourd’hui », « Je n’en ai eu qu’un seul de toute
la journée, ça va mieux ». (…) suite à une déclaration de violence ou
d’abus sexuel, beaucoup d’enquêteurs éprouvaient une certaine difficulté à
« récupérer » et à faire passer un nouveau questionnaire »
(Levinson, 2008, p 106-107).
Dès lors, on ne s’étonnera
pas que dans un certain nombre de cas, les seules communications d’inceste
relatées par des professionnel/le/s leur soient pour ainsi dire
« apportées sur un plateau ». Ici, ni question qui ferait office
d’annonce, ni repérage des sécrétions qui donnent trace d’un secret sans qu’on
se doute de sa nature réelle. Ici, ce sont simplement les incesté/e/s ou leur
« parent protecteur » qui viennent voir le ou la professionnel/le,
comme c’est le cas pour Micheline, assistante sociale scolaire, ou encore pour
Hélène et Françoise, assistantes sociales de secteur.
Et, dans le droit fil de
Laurence, qui ne veut pas penser à chaque fois que cela pourrait être un
inceste, et me répète que sur toute sa carrière, ces quelques cas sont tout de
même l’exception, Hélène et Françoise m’expliquent
Françoise, assistante sociale polyvalente de secteur - Moi j’ai
plutôt eu, et j’en n’ai pas eu beaucoup, heureusement, de situations euh,
d’abus sexuel dans la fratrie. Hein, voilà, d’un grand frère par rapport à un
petit frère. (…) ce sont des situations que l’on, enfin, que l’on n’a pas quand même si souvent, ces
relations incestueuses, ou de, d’abus sexuels dans les fratries, ça arrive,
mais … voilà.
Hélène, assistante
sociale polyvalente de secteur - non c’est plus des carences éducatives en
fait, ce qu’on va retrouver, euh
Françoise – Oui.
Hélène - dans le cadre
de la Protection de l’Enfance, dans les situations qu’on peut nous signaler.
L’anthropologue – Oui
oui.
Hélène - C’est même
rarement, aussi, des maltraitances physiques avérées.
Anthropologue –Hmmhmm.
Françoise – C’est
ça, oui, c’est plutôt d’ordre psychologique.
Anthropologue – Hmm,
hmm.
Hélène - D’ordre
psychologique. Voilà. Ou des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ou des
enfants pour lequel on n’a fixé aucune limite
Françoise – Hmmhmm,
hmmhmm.
Hélène - et qui débordent complètement du cadre, à l’école, à la maison, dans les activités, voilà … ça va plus être de cet ordre là.
Ici, il est remarquable de
lire comment, dans cet entretien collectif, nous passons des incestes, qui
« heureusement » sont rares, aux violences physiques, en fait rares
elles aussi, puis aux violences psychologiques, plus fréquentes … pour terminer
en évoquant, finalement, les, nombreux bien sûr, enfants « qui débordent
du cadre ». En un duo qui se relaie parfaitement, et probablement sans
même s’en rendre compte, ces deux collègues sont passées de l’inceste, posé comme
rare puisqu’elles ont eu peu de cas dans toute leur carrière, à l’enfant
pénible car manquant de limites, beaucoup plus fréquent.
En effet, il est rare que
les incestes parviennent jusqu’aux services sociaux et, par suite, jusqu’à la
Protection de l’Enfance : Emmanuelle Guyavarch, utilisant les résultats de
l’enquête EVS (Evénements de vie et de santé) trouve que « Au total,
0,4 % des hommes (17/4328) et 2,7 % (154/5625) des femmes enquêtés
déclarent avoir subi des violences sexuelles de manière durable avant l’âge de
20 ans. Parmi eux, une très faible part a connu une prise en charge de
Protection de l’Enfance (17 % des femmes et 18 % des hommes ayant
déclaré ces violences). [Donc] Selon les résultats de cette enquête et les
hypothèses que nous émettons, 0,3 % des hommes et 2,3 % des femmes
[parmi l’ensemble de la population] auraient vécu des violences sexuelles de
manière répétée durant l’enfance sans avoir été repérés comme « en
danger ». » (Guyavarch, ONED, 2008,
p 5). L’enquête
ne demande pas par qui les personnes ont été abusées, mais une question porte
sur le caractère répétitif ou non des abus. L’hypothèse de Guyavarch est donc
« qu’en cas de violences imposées de manière durable, celles-ci étaient
perpétrées dans le cadre familial ou tout du moins qu’il y avait bien une
défaillance de l’autorité parentale si ces derniers n’ont pu mettre fin à ces
actes de violence. » (Guyavarch, ONED, 2008,
p 4).
Le résultat à retenir est
donc, quant à lui, très simple : environ 80 % des personnes abusées
sexuellement de manière répétitive durant leur enfance n’ont aucunement été
détectées comme « en danger » par les services sociaux. L’inceste,
c’est exceptionnel pour les professionnel/le/s qui pensent que c’est
exceptionnel ?
Mais en sus de la capacité à supporter de penser la possibilité d’existence de l’inceste, donc de l’incesteur parmi les pairs et partenaires (pairs et partenaires car adultes comme soi, ayant autorité sur des enfants) auxquel/le/s on fait confiance, d’autres critères, plus difficiles à décrire, semblent importer. Il s’agit d’une part du rôle du temps, de la répétition possible des rencontres, mais aussi du fait qu’il y ait une relation « personnalisée », ou, plus précisément, que dans ses relations avec les mineur/e/s, le/la professionnel/le y ait « mis de soi ».
Bien sûr, pour faire annonce, « Pour désigner l’inceste, la parole doit avant tout être légitime, c'est-à-dire avoir été prononcée par une autorité sociale, morale et psychique » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 18). Mais pour susciter la communication, être une autorité sociale ne suffit pas. Hormis dans les situations de crise comme être tombée enceinte de son incesteur, ou encore vouloir protéger sa petite sœur, bien souvent, les communications sont faites à une personne présente là depuis longtemps, bien identifiée et connue[39].
C’est le cas de Cécile, qui anime des permanences régulières à disposition des jeunes, après non une séance ponctuelle, mais trois séances qui se suivent, d’information et de discussion sur la sexualité dans les maisons familiales rurales. Et même ainsi, elle relate
L’anthropologue – Et …
est-ce que vous vous y attendiez, en fait, à, à avoir ce genre de révélations,
au départ ?
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial – Ben dans notre formation on, c’est quelque
chose qui est abordé, hein, dans notre formation de conseillères
Anthropologue – Hmmhmm.
Cécile – euh, pas sur
cette forme là, non.
Anthropologue –
D’accord.
Cécile – Quand j’ai
fait ma formation, je pensais pas que à chaque fois ce serait sur des questions
de plaisir. Mais euh, bon voilà. Mais euh …
Anthropologue – Hmmhmm.
Vous pensiez plutôt ?
Cécile – Ben non, moi
je pensais que, puis que ce serait peut-être plus euh, qu’on nous en parlerait
peut-être plus directement, qu’on viendrait peut-être plus vite …
Oui.
(brève interruption par
quelqu’un qui passe)
Cécile – Oui parce
qu’on n’a pas trouvé d’autre salle.
… Plus vite, euh,
peut-être que ce serait abordé, les gens viendraient nous voir plus pour ça.
Enfin, voilà. Enfin, des, que ça se passerait de manière moins indirecte, euh,
voilà.
Anthropologue – Hmmhmm.
Cécile – On avait été prévenues, qu’un train pouvait en cacher un autre, mais, que ce soit si long à, à émerger, enfin, des choses comme ça.
Si long : cela peut prendre des mois, voire plus d’un an, précise-t-elle.
Micheline, assistante sociale scolaire, a pour particularité d’être présente tout le long de la semaine dans son lycée professionnel. Elle me précise qu’il y existe de surcroît un bon suivi des élèves par les enseignant/e/s, ce qui n’est, selon son expérience, pas le cas partout. Quant à elle, elle travaille beaucoup ses relations avec les élèves, que ce soit en endossant un rôle de confidente de ceux et celles qui le souhaitent, ou en construisant des « actions collectives » avec des groupes d’élèves.
Micheline, assistante
sociale scolaire - Ils viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour discuter, en
fait, pour euh, pour vider leur sac. (…) Donc beaucoup d’élèves qui ont envie
de prendre leur indépendance, et puis, ben c’est pas faisable non plus hein.
Pour certains. Des problèmes de cœur. Donc ils … viennent nous parler de tout,
donc c’est, même les problèmes de cœur, moi je trouve, je me dis mais, c’est
quand même triste en fait de, enfin
L’anthropologue – (rires)
Micheline – triste,
entre guillemets de venir voir une assistante sociale pour ça. C’est qu’on a
vraiment personne à qui en parler, quoi. Moi ça me fait toujours quelque chose
euh, quand je vois ça, parce que je me dis c’est, c’est vraiment euh, la solitude
quoi. (…)
Et puis on fait aussi
beaucoup de, d’actions collectives ici.
Anthropologue –
D’actions collectives ?
Micheline – Alors
d’actions collectives donc, on fait venir [une association de lutte contre les
violences faites aux femmes], euh, d’un autre côté moi je prépare tout ça en
fait avec les élèves, je fais toute une action sur les, les violences euh,
faites aux femmes. Ou même les violences en général. (…). On a fait une action
aussi (…) sur les conduites addictives : toxicomanie, alcool, addiction
aux jeux (…). Donc il y a eu aussi sidaction, on a fait pas mal d’actions
collectives sur, contre le sida … y’a le don du sang, y’a aussi éducation à la
sexualité, donc voilà, on fait pas mal de …on travaille bien avec les élèves,
quoi, donc c’est euh … euh … voilà.(…)
Le plus important pour
travailler, c’est la confiance en fait hein. Ca c’est, … il faut que les
élèves aient confiance en vous pour pouvoir venir. Si ça marche bien avec un
élève, et qu’un élève a confiance en vous, eh ben après ça fait une traînée de
poudre et puis les autres ont confiance et ils viennent plus facilement.
Bien sûr, ceci est loin d’être la règle dans tous les établissements scolaires actuellement, comme le relate Francine :
L’anthropologue - Quand
tu me dis les difficultés vis-à-vis de l’institution, pour savoir comment se
positionner, tout ça, dans ce type de cas, c’est … ?
Francine, enseignante
en lycée professionnel - C’est un peu difficile, enfin par rapport à
l’institution, le, tous ceux qui sont pas prof : CPE, assistante sociale
ou infirmière, en général ça va pas mal, quand on, par rapport aux difficultés
des élèves, mais ça dépend beaucoup des personnes.
Sans compter que, dans le lycée professionnel où elle enseigne, comme dans de nombreux établissements actuellement, l’assistante sociale est présente une fois par semaine, ce qui rend, physiquement, impossible tout le travail mené et décrit par Micheline. Ce sont alors des gens comme Francine qui prennent l’initiative d’afficher dans leur salle de cours les numéros verts d’écoute pour les adolescent/e/s en difficulté morale et de leur conseiller de ne pas rester seul/e/s avec ces difficultés. Voire de les orienter sur des relais (planning familial, assistantes sociales …). Bien sûr, de téléphoner à leurs parents depuis chez elle en cas de problème suspecté. Et d’ailleurs, ce n’est pas tout le monde qui procède ainsi :
Francine, enseignante
en lycée professionnel - certains profs considèrent qu’ils sont profs,
« moi je suis là pour faire des cours, point c’est tout »
L’anthropologue – Hmm.
Francine - mais ça
c’est une mentalité qui existe beaucoup plus dans les lycées généraux, où les
élèves ont pas le même contact, le même type de rapport à peu près que nous
Anthropologue – Oui.
Francine - en lycée
professionnel. « Parce que moi je veux bien faire cours, point. Je fais
cours, et je suis pas assistante sociale ». Certes, je suis pas infirmière
Anthropologue – Ouais.
Francine - mais ça me
paraît insensé quand on sent que quelqu’un est un peu en détresse, de juste à
la limite attendre le conseil de classe deux mois après pour dire « ben il
a pas l’air bien celui là, faudrait voir s’il a un problème dans sa
famille ».
Anthropologue – (rire)
Hmmhmm.
Francine- En même temps
que, on ne, on n’est pas non plus des psychologues, ni des psychanalystes ni
des assistantes sociales, on n’en a pas les capacités. (…)
Mais certains profs
sont totalement fermés à ça. C’est « moi je fais cours, je veux pas savoir
euh », mais moins chez nous quand même
Anthropologue – Ouais.
Francine – moins chez
nous, puis en fait on travaille en équipe aussi, des profs. On se connaît,
c'est-à-dire que, moi je vais à l’atelier, quand j’ai pas cours une heure, je
vais faire un tour à l’atelier ou, ou inversement. On se connaît, les élèves
savent que on se connaît bien, qu’on est proches, et puis, bon, il y a des
sections où ils sont pas très nombreux, où on les a deux ans.
La stabilité des personnels, le faible nombre d’élèves en classe, le fait d’avoir les mêmes élèves plusieurs années d’affilée : des conditions qui, effectivement, peuvent autoriser une personnalisation des relations.
Mais aussi l’existence d’une équipe réelle, qui ne se construit probablement pas par décret, ni par la volonté des brochures de l’éducation nationale prônant le « travail en équipe » des enseignant/e/s, ni même par la volonté des intéressé/e/s eux-mêmes. François Laplantine avance, à cet égard, que « Le collectif est extrêmement difficile à décrire parce que, à l’instar du désir, il ne se voit pas. En revanche, lorsqu’il se défait et commence à faire défaut, nous nous apercevons de ce qui nous manque. (…) Le collectif se situe résolument du côté du sujet, c'est-à-dire du désir, lequel ne peut être saisi, fixé, stabilisé. (…) le collectif est un désir d’être ensemble qui ne peut être imposé. » (Laplantine, 2007a, p 47). Le désir, aussi difficile à décrire que le collectif, est, précisément, le mot qu’il nous faut garder à l’esprit pour les lignes qui suivent.
Cette personnalisation des relations rendue possible n’est, en effet, pas suffisante en elle-même : avec Christine, qui travaille en CMP, on se rend compte qu’il semble important que « le courant passe ». L’unique adolescente qui, au bout d’un an de suivi avec elle, lui communique, en fin de séance, en partant, avoir subi des abus incestueux, est aussi l’unique adolescente dont Christine me parle avec … amour et tendresse, à un point qui dépasse le simple credo professionnel.
Christine,
pédopsychologue en CMP - (…) Alors moi j’ai eu aussi une petite dans ce
registre. Enfin une petite, une grande, une gamine que j’aimais beaucoup,
d’ado, je l’ai vue elle avait 17 ans, elle était très très sauvage, encore.
C’est une gamine, un peu le style d’Audrey Tautou dans Amélie Poulain, tu vois
ce style de …
Anthropologue
– Je connais pas.
Christine
– Tu connais pas ? Ce, ce style de, de, de, de jeune fille, euh, un peu la
sauvage d’Anouilh, mais très, euh, très
très riche en fait, mais une gamine qui ne dormait pas
Anthropologue
– Hmmhmm.
Christine
- depuis ses 6 ans, quoi. Bon.
J’ai longuement cherché comment conceptualiser de manière anthropologique cette « personnalisation des relations », qui semble créer un terreau plus favorable aux communications de lourds secrets.
J’ai tout d’abord regardé du côté du care, cet ensemble d’ « expériences ou [d’]activités (…) qui consistent à apporter une réponse concrète aux besoins des autres » (Molinier, Laugier et Paperman, 2009, p 11). Réponse qui, pour réussir, doit comprendre certaines caractéristiques : « Ce travail [du care], en effet, pour être réussi doit être discret. Que l’on imagine seulement, à l’issue d’une journée épuisante, la différence ressentie entre être accueilli chez soi ou chez des amis par quelqu’un qui vous fait remarquer « oh ! mon Dieu, comme tu as mauvaise mine ! » ou par quelqu’un qui se contente de vous tendre généreusement une chaise ou un couvert. L’attention aux besoins d’autrui efface ses propres traces, disparaît comme effort ou comme travail. (…) la complexité de ce travail, (…) réellement, n’apparaît que quand il n’est pas fait ou mal fait » (Molinier, Laugier et Paperman, 2009, p 18-19). Il y a de cela dans ce que fait Francine autour de ses cours. Mais, outre que le care semble partager avec le collectif cette caractéristique, floue, de ne se remarquer que quand il est absent, il me semblait qu’il n’y avait pas que cela.
Dans les bricolages pragmatiques de Christine, est posée avec acuité la question du zèle. En effet, pour combler l’écart entre le travail prescrit par les procédures ou la théorie (ici, les théories psychologiques et les règles du CMP) et le réel, il faut comprendre que « Un atelier, une usine, un service, ne fonctionnent que si, à la prescription, les travailleurs ajoutent des bricolages, des « bidouillages », des « ficelles », des « trucs » (…). Ces caractéristiques de l’intelligence efficiente au travail – caractéristiques cognitives : faire face à l’imprévu, à l’inédit, à ce qui n’est pas encore connu ni routinisé, et caractéristiques affectives : oser transgresser ou enfreindre, agir intelligemment mais clandestinement ou, au moins, discrètement -, ces caractéristiques donc de l’intelligence au travail constituent ce que nous désignons communément par le « zèle » au travail. » (Dejours, 2000, p 74-75). Le zèle pousse Francine à ne pas attendre le conseil de classe pour s’occuper du mal être d’un élève. Il pousse Christine plus loin encore :
Christine,
pédopsychologue en CMP - Donc je, je récupère la jeune fille, à qui je commence
à dire puisqu’elle avait 17 ans et que, je lui dis « écoutez, ce serait,
ce serait bien qu’on voie vos parents parce qu’en principe c’est la règle du
CMP ». Elle commence par hurler qu’il n’en est pas question. Bon. Je me
suis dit : elle a quand même pas l’air d’aller très très bien donc je vais
pas trop insister pour l’instant et puis on reparlera de ça.
Anthropologue – Hmmhmm.
Christine - Elle avait
pas 4 ans, quoi. Mais légalement les mineurs on doit voir les parents au moins
une fois. C’est …
Anthropologue – Oui.
Christine – bon. Je les
ai jamais vus hein, ceux là. Mais bon. Après j’ai laissé pisser : je me
suis dit bon, elle a 17 ans et demi, après le temps passe, tu te dis on
s’approche des 18 ans, on va faire sans, hein. Donc, j’ai rien dit à personne,
et j’ai continué à la voir, mais c’est qu’elle me disait rien.
Et c’est cette infraction aux règles du CMP qui permettra à l’adolescente de continuer à venir : un an plus tard, lorsqu’elle communique à Christine les abus incestueux qu’elle a subis de la part du « tonton », elle lui explique aussi qu’elle ne voudrait surtout pas que ses parents soient mis au courant, car elle ne veut pas leur faire de mal en brisant l’image qu’ils ont de ce « tonton ».
Quant aux adultes suivi/e/s par Irène, pédopsychiatre libérale, ou ceux/celles suivi/e/s par les personnels du service enfance dans le cadre de mesure de protection de leurs enfants, j’ai, via les entretiens, peu d’informations sur comment a été générée la communication, sauf exception.
Néanmoins, Francis introduit une idée nouvelle, qui n’est ni exactement le care, ni exactement le zèle, lorsqu’il évoque des mères qu’il a en suivi, et dont il sait qu’elles avaient elles-mêmes été incestées étant enfant :
Francis, éducateur en
service enfance - C'est-à-dire que elles étaient, elles étaient pas
instigatrices [de l’inceste] dans le sens "tu vas aller dans le lit de ton
père"
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Francis - mais … euh …
ce qu’il m’indiquait, c’était que, il y avait un peu comme une, un voile, ou
une, u, une, une partie un peu, en quelque sorte un peu invisible, où "je
ne veux pas voir".
Anthropologue - Ouais,
des espèces de peaux de saucisse, quoi
Francis - En quelque
sorte. (…) Après … ce qui … moi je pense que par rapport à tout ça, il y a
effectivement, au niveau de l'accompagnement éducatif, on a quand même … je
trouve, on a pas mal de boulot à faire, et c'est assez passionnant, puisque
quand même, hein, ces parents, finalement, quand ils deviennent parents, euh,
bien revisitent une grosse partie de leur enfance, donc toutes leurs
souffrances, tout ce qu'ils ont voulu enfouir, tout ce qui était compliqué. Eux
comme nous tous, hein, comme n’importe qui.
Anthropologue – Hmm.
Francis - sauf qu’à un
moment ou à un autre, voilà, y’a tout ce qui a été douloureux ou traumatisant
ou compliqué (…). Il y a ceux qui sont beaucoup plus en difficulté que ça, et
qui ont moins de repères, ou en tout cas qui ont eu des manières, des schémas
de fonctionnement, et puis des repères qu’ont été complètement euh bafoués donc
qui se retrouvent avec euh, sans repères ou à puiser des repères sur lesquels …
euh … ben, llll … la loi n'est pas intervenue donc, pour dire "ben c’est
pas possible, c'est interdit, c’est prohibé, c’est machin". Et puis ... je
sais plus ce que je voulais dire.
Oui. Et euh, donc de,
voilà, de travailler avec eux au niveau éducatif sur euh, sur leur dimension de
parents et les soutenir par rapport à ça, moi je trouve ça assez, plutôt … très
… très passionnant. ... je sais plus du tout où je voulais en venir, mais bon,
voilà.
Ainsi, Francis introduit la passion.
« Le courant qui passe », « la passion », « le zèle » … autant de mots qui nous mènent, de façon convergente, à ce concept bien peu objectivable qu’est le désir. Désir d’aider des mères à être parents, désir de garder en cure une adolescente, quitte à se mettre en infraction soi, désir de répondre à cet élève qui, pour une fois, intervient en cours, désir d’obtenir la confiance des élèves en les impliquant dans des « actions collectives » et en faisant bon usage de leurs confidences, désir d’aider ces jeunes qui n’éprouvent pas de plaisir …
Néanmoins, revenons dans le champ des sciences sociales plus classiques en constatant comment ce désir peut achopper au réel des rapports de domination, comme dans l’exemple suivant, relaté par un jeune travailleur social sur un forum internet d’échanges entre travailleurs/euses sociaux :
Une autre désillusion a
été un autre accompagnement lors de mon stage à responsabilité... Toujours en
chrs...
J'accompagnais une jeune femme ayant un parcours institutionnel elle aussi (on
en trouve beaucoup en CHRS bizarrement![]() ). Pour des raisons inconnues (Agression, suicide?) elle s'était défenestrée
dans un logement précédent. N'ayant aucun revenu et moins de 26 ans, nous
l'avons donc accueillie et j'ai pris sa référence.
). Pour des raisons inconnues (Agression, suicide?) elle s'était défenestrée
dans un logement précédent. N'ayant aucun revenu et moins de 26 ans, nous
l'avons donc accueillie et j'ai pris sa référence.
Rapidement elle a commencé à montrer des signes de dépression.
En creusant le problème avec elle, celle-ci a pu dire qu'elle souhaitait voir
son père en prison. Elle n'avait jamais pu le faire lorsqu'elle était mineure,
son père étant incarcéré pour inceste (sur une de ses sœurs) et viol sur
mineur. Nous avons donc donc travaillé ensemble le sens de cette demande. Une
visite a été programmée et je l'ai accompagnée. Elle est revenue complètement
éteinte de cette rencontre, nous l'avons soutenue (de plus elle avait un suivi
psy extérieur) et elle a redressé la barre rapidement, décuplant sa motivation
pour chercher un emploi et pour se stabiliser... Cela aurait du m'interpeller.
A la fin de mon stage, nous nous sommes dit au revoir, sa situation n'était pas
"résolue" mais elle semblait être repartie sur de bonnes bases.
J'ai rappellé le CHRS deux semaines après, pour avoir des nouvelles de mes
collègues et de mes suivis, dont cette jeune demoiselle. J'ai appris qu'elle
avait fait une tentative de suicide et qu'elle était passée à deux doigts de la
mort.
Je suis allée la voir à l'hôpital, nous avons discuté. Je n'avais plus ce
costume d'éducateur. La sensation était bizarre. Elle m'a parlé comme jamais
elle ne m'avait parlé. Il m'avait semblé pourtant que la relation que nous
avions construite était véritable, sans non-dit. J'avais idéalisé mon suivi en
quelque sorte.
Elle m'a exprimé qu'elle avait fait le premier rendez-vous psy sur la structure
mais qu'elle ne l'avait pas poursuivi, alors qu'elle me disait y aller toutes
les semaines. Elle m'avoué qu'elle avait l'habitude des éducateurs, de ce qu'il
fallait leur dire pour qu'ils la laissent tranquille et qu'elle obtienne ce
qu'elle veut.
Elle m'a dit que la véritable raison de la visite en prison pour voir son père
n'était pas celle que je croyais. Elle voulait entendre de sa bouche qu'elle
aussi avait été sa victime, ce qu'il n'a jamais pu lui avouer. Elle, pourtant,
dans son for intérieur, en était sûre (ou peut-être qu'elle le croyait alors
qu'il ne s'était rien passé, je ne suis plus sûr de rien).
A la fin de cette rencontre, elle a exprimé que son seul désir actuel était
d'en finir, et là j'étais certain qu'elle me disait la vérité.
Je n'ai jamais complètement fait le deuil de cette relation. Je me suis
beaucoup interrogé sur le signe que je n'avais pas vu lors de cet
accompagnement, signe qui aurait pu me donner une piste de compréhension des
véritables raisons de son mal-être, et peut-être m'aider à mieux l'accompagner.
Mais je n'ai rien vu.
J'ai culpabilisé en quelque sorte.
Aujourd'hui, avec le recul, je ne suis plus dans cette dynamique, j'ai fait le
deuil de cet idéal que j'ai cru un moment toucher du doigt et qui n'était
finalement qu'un mirage....
Non je ne suis pas le super éducateur non plus, je ne l'ai jamais cru
d'ailleurs, je veux juste bien faire mon métier. La différence est énorme.![]()
Alors que lui croit être dans une relation de confiance, sans non-dit, manifestement, pour elle, il est « l’éducateur », c'est-à-dire celui dont le costume lui donne un pouvoir sur sa vie. Cependant qu’il travaille le sens de sa demande, elle travaille à obtenir ce qu’elle veut de cet homme qui détient le pouvoir vis-à-vis d’elle.
En outre, ce qui peut frapper ici, c’est qu’alors qu’elle revient « éteinte » de sa visite à son père, elle semble ne rien en dire.
On peut poser la question d’une double ignorance de l’éducateur ainsi que des collègues l’ayant précédé : ignorance de la généalogie de l’inceste (Dussy et Le Caisne, 2007, Perrin, 2008), ignorance de la difficulté à « dire » de la part des personnes ayant été incestées.
Ignorance de la généalogie de l’inceste : alors que le père est incarcéré pour inceste sur une sœur, à aucun moment, n’est posée la question, par ce professionnel ou d’autres auparavant, d’un éventuel inceste sur les autres membres de la fratrie, pourtant probable (voir par exemple Perrin, 2008, p 77 et suivantes, ainsi que les graphes de parenté joints en annexe).
D’autre part, cependant que l’éducateur se situe clairement dans une norme de « gouvernement par la parole » (Serre, 2009, p 135), qui consiste en « une conception de l’autorité spécifique, une violence douce qui consiste à manipuler l’environnement de l’enfant [ou de la jeune majeure dépendante des mesures sociales d’insertion] et à contrôler, par le biais du langage et de la transparence, l’ensemble de ses souhaits. » (Serre, 2009, p 135), la jeune fille exprime un habitus (Dussy et Le Caisne, 2007, p 16) formé par l’ordre incestueux.
Cet habitus rend « La tension entre « se taire » ou « dire » (…) omniprésente et polymorphe. Elle s’exprime dans toutes les dimensions des relations sociales, c'est-à-dire quand il s’agit de dire à quelqu’un. (…) » (Dussy, 2009, p 124). Et « cela peut être dire l’inceste, mais également tout autre chose » (Dussy, 2009, p 124). Dussy cite par exemple Annabel, qui lors de son accouchement, se culpabilise de n’avoir pas « tenu » : « « Dès que j’avais une contraction, c’était, « faut pas que je parle, faut pas que je parle » » (…) Dans les situations de vie qui ont à voir avec la douleur intervient la question de savoir si la personne saura se taire, comme en écho à la douleur occasionnée par les viols. » (Dussy, 2009, p 125).
Cette véritable éducation au silence ressemble beaucoup à celle rencontrée dans les sociétés secrètes décrites par Simmel : « Les sociétés secrètes recherchent naturellement le moyen de susciter psychologiquement le silence qu’on ne peut imposer aux individus par la force. Le serment et la menace de sanction viennent en premier lieu, et peuvent se passer de commentaire. Plus intéressante est la technique assez fréquemment utilisée, qui consiste à apprendre au néophyte à se taire systématiquement dès le début. » (Simmel, 1991, p 69).
Ainsi, cependant que pour l’éducateur, il était évident qu’existaient la parole et la transparence, pour la jeune fille, il était impensable de parler de sa douleur morale faisant suite à la visite à son père. Il faut une situation de crise – suicide manqué – et la démarche de l’éducateur de venir la visiter à l’hôpital à titre personnel, donc dépouillé de son pouvoir, pour que se fasse la communication sur l’inceste et également les multiples feintes vis-à-vis de l’éducateur et des institutions dont il était mandataire.
La relation régulière, personnalisée, le désir de l’éducateur d’aider … ne suffisent donc pas toujours à contrer l’habitus des incesté/e/s, long apprentissage à savoir/devoir se taire, ni à transformer la « violence douce » de la relation éducateur/usagère en possible espace d’aide et de confidences confiantes.
D’autres cas de communications manquées sont descriptibles à partir des récits de Paulette et Lydia.
Paulette avait une relation affinitaire importante avec un enseignant
Paulette - Oui, et puis
de toute façon, ça pouvait pas se poser pour moi, parce que j’étais toute
seule. Comment voulais-tu que je fasse, comment voulais-tu que ça me vienne à
l’idée ? (…)Y’aurait fallu que je rencontre quelqu’un qui me dise
« ben, tu sais, ce que t’as vécu, c’est quand même pas, c’est pas normal,
tu pourrais peut être faire quelque chose », mais, hop. (…) Non je … mon
prof de sciences nat’, quand j’étais en 4e, aurait peut être pu
faire ça. Heu, parce que j’avais des, j’avais des rapports vraiment très, très
… (…) Oui, on discutait beaucoup euh, mais … (silence, puis chuchoté) je pense
pas que ça se faisait, à l’époque, tu vois. (…) Pas pour des trucs datant
d’aussi, d’aussi loin dans le passé.
Elle évoque là la possibilité d’une communication plusieurs années après les faits, l’abuseur étant de surcroît décédé. Mais elle est bloquée par sa culpabilité.
Paulette - Voilà. Parce
que pour moi, je l’avais fait, alors que ça m’avait été fait, mais pour moi je
l’avais fait. (…) Et euh, tu te, tu renfonces ça, tu te l’avales, et, et
surtout tu en parles pas, et tu essaie d’être aussi normale que possible …
Moi - Et, t’y arrivais, à
être aussi normale que possible ?
P- (silence) Ben …
ffffouuu … je … faisais beaucoup de choses. Je, je faisais partie de tous les
sports qu’on pouvait faire au collège, et après à l’école normale, et je faisais
de, des heures de dessin, d’ateliers de dessin en plus, je faisais, et après
j’ai fait du théâtre, et après … j’ai toujours fait énormément de choses.
Et Paulette, souhaitant devenir enseignante, n’est pourtant pas trop éloignée de l’univers de ses professeurs de collège puis d’école normale.
Quant à Lydia, Elle ne bénéficie même pas de cette proximité : au collège, elle fait partie des mauvaises élèves, de celles qui ne sont pas des « intellos », et qui, donc, ne vont probablement pas chercher à entrer en relations personnalisées avec leurs enseignant/e/s. Pour elle, les possibilités de communication extra-familiale se trouvent donc encore réduites à cause de la distance sociale avec l’univers scolaire. Mais il n’y a pas besoin d’aller si loin : on se souvient que Lydia, jusqu’à ses 18 ans, s’emploie elle aussi à paraître normale, non par culpabilité mais par terreur car les abus ont encore lieu.
De surcroît, les relations régulières et personnalisées avec un/e mineur/e, sont plutôt l’exception parmi les professionnel/le/s interviewé/e/s. Pour beaucoup d’entre eux/elles, l’usager/e ne fait que passer. Dans ce cas, la plupart du temps, le/la professionnel/le reçoit une communication déjà faite. Son rôle est alors d’aide (et souvent aussi d’incitation) à l’action, comme ces assistantes sociales de secteur qui accompagnent une mère à la brigade des mineurs, ou comme la bénévole associative qui aide le parent à conduire son action en Justice.
Et lorsque la communication est faite au/à la professionnel/le directement, se révèle alors la frustration générée par ces situations de rencontres ponctuelles :
Laurence, assistante
sociale en planning familial - Et alors là, par contre, ce qui m’a, j’ai plus jamais
eu de nouvelles.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Laurence – Mais ça nous
il faut qu’on apprenne, hein, à pas, à pas euh, courir après l’info. La maman,
euh, la maman m’avait dit « je vous tiendrai au courant », et puis …
La situation peut aussi être difficile, suite à une communication, quand on est dans un rôle de passeur de l’information, comme ce CPE qui m’explique :
« Il m’explique qu’ils
perdent tout de suite la main dessus : ça dure deux ou trois jours, puis
« hop », c’est au judiciaire, et là, ils n’ont surtout plus le droit
d’intervenir, de s’en mêler : secret de l’instruction, seule la police a
le droit de poser des questions. Et c’est difficile, parce que l’élève on l’a
tous les jours dans [l’établissement], pendant ce temps. De plus, on ne sait
pas ce qu’il lui a fait exactement. Puis l’élève est dans sa famille, a priori
dans une atmosphère différente puisque l’agresseur n’y a plus accès. Mais elle
est là dans [l’établissement] … et on ne sait pas comment elle va, et on n’ose
pas aller lui demander …donc ça reste comme ça. On va pas être sur elle à lui
dire « alors ? ».
Puis, en plus, on ne sait rien
de la suite de l’affaire, on n’a aucun retour du tribunal, en tant que
personnels [de l’établissement] » (notes du 01/03/2009 à propos de la rencontre
du 24/02/2009)[40].
Finalement, par-delà les éventuels desirata peut-être voyeuristes suscités par la situation (« on ne sait pas ce qu’il lui a fait exactement »), se pose la question de la place des professionnel/le/s dans le passage de la communication à la révélation. Une place très souvent difficile, éprouvante, et finalement, qui doit souvent se résumer à « passer la main » sans retours d’information sur la suite des événements ainsi déclenchés … à moins d’interpeller l’élève dans les couloirs de l’établissement scolaire, ou bien de « courir après l’info » en téléphonant à la mère, ce qui semble délicat et gênant à mes interlocuteurs/trices.
C’est pourquoi après avoir étudié
« qui communique, quand, et quels sont les contextes les plus propices
à une telle révélation ? », puis « à qui, dans l’univers des
professionnel/le/s, peut-être faite une communication ? », nous
allons étudier de façon plus détaillée quels sont les effets de ces
communications sur ces interlocuteurs/trices.
Nous avons, en effet, vu que si l’abus sexuel incestueux est une éventualité pensée par l’interlocuteur/trice, des communications sont appelées par ses questions et relances. Dans le cas où cette éventualité n’est pas pensée comme une des possibilités, seule l’annonce involontaire (Francine) ou bien le sentiment qu’il y a « quelque chose, mais quoi ? » (Laurence), peuvent mener à la découverte qu’il y a eu des abus. A moins que la communication soit directement apportée, « sur un plateau », au ou à la professionnel/le (Hélène, Françoise, Micheline …).
Se pose en outre la question du type de relation : c’est dans les contextes où des professionnel/le/s y « mettent de soi », et ont la possibilité de le faire, dans leurs relations avec les mineur/e/s, qu’ils/elles suscitent des communications. Dans ce cas de figure, souvent, il faut noter le rôle de la répétition possible des rencontres, car il peut se passer beaucoup de temps, comme peut-être un temps « d’apprivoisement », avant que l’incesté/e effectue cette communication.
Communication qui, souvent, a un impact considérable sur l’interlocuteur/trice …
V - L’impact de la communication
Françoise Sironi relate que « Une des caractéristiques les plus insolites du traumatisme, c’est qu’il se propage comme une onde. Même au-delà des deux protagonistes, ce mécanisme est toujours actif. Preuve en est le fait suivant que nous avons déjà cité précédemment : un récit de torture déclenche des affects chez celui qui l’écoute. Il est médusé, son cœur et sa respiration s’accélèrent. Il soupire plus que de coutume. Il est touché, atteint par le contenu du récit et ressent la plupart du temps un profond malaise. Si celui à qui on a raconté un récit au contenu traumatique le transmet à son tour, il déclenchera le même effet, et ainsi de suite. » (Sironi, 1999, p 133).
C’est ainsi qu’il n’y a pas que pour moi que, parfois, le monde vacille, voire tourne :
Francine, enseignante
en lycée professionnel - Puis une semaine ou deux après, à la fin des cours, je
sais plus ce que je cherchais, j’allais près d’un bureau. Je suis passée devant
le foyer des élèves et il était en train de jouer au baby-foot (je vois très
bien la scène), en train de jouer au baby-foot avec des copains. Et là il m’a
interpellée, et il m’a dit qu’il voulait me parler, donc on est allés dans une
salle à côté, et il a commencé à me dire avant même que je sois assise et lui
aussi, heu « je veux vous parler, j’ai commencé à voir un psy, et il m’a
conseillé donc, d’en parler, comme vous dites d’ailleurs, à quelqu’un, de
choisir quelqu’un
L’anthropologue –
(rires)
Francine – (…) et donc
je veux vous dire que j’ai été violé par mon beau-père donc, euh, plusieurs
fois entre 10-13 ans ou 11-13 ans », je sais plus exactement. Donc je lui
ai pas demandé le détail, hein, viol vraiment ou attouchements, j’avoue que je
suis pas entrée dans le détail.
Et à ce moment-là, je
l’ai admiré énormément, parce que je me demandais ce que ça lui demandait comme
courage pour euh … exprimer ces choses là. J’ai même eu l’impression que
j’allais m’évanouir. Enfin c’était moi qui en fait ne supportais pas la chose,
curieusement. (…)
Puis alors je me suis
ressaisie parce [que] (…) tout de suite il a enchaîné pour me dire qu’il se
sentait mal, qu’il se sentait coupable, euh, culpabilité y compris d’une …
peut-être d’une forme de plai, plaisir physique qu’il avait pu ressentir, euh,
dans ces choses là, et là il était beaucoup plus mal en parlant de ça. Et
surtout la culpabilité par rapport à sa demi-sœur, (…) et alors là il m’a dit,
donc, « son père va aller en prison à cause de moi », alors là je lui
ai dit que son père, son beau-père irait en prison à cause de lui, le
beau-père. Et ça ça a semblé lui faire du bien, puisque là j’ai, j’ai été assez
énergique
Francine se ressaisit lorsque l’élève commence à dire combien il n’est pas si fort qu’il le semblait. Et ce qui se transmet ici c’est, peut-être, une sidération ressemblant à celle éprouvée lors des abus
Anthropologue - Et donc
tu me dis « j’ai failli m’évanouir » … physiquement ou … ?
Francine -
Physiquement : c’est la tête me tournait, comme quand on voit ... Je me
suis rarement évanouie dans ma vie, mais je me suis évanouie chaque fois que
j’étais face à des choses euh … euh … qui sont insupportables. (…) C'est-à-dire
comme je sais pas quoi faire et je peux rien faire, ou des choses trop dures.
(…) La seule fois où ça m’est arrivé, je crois, de m’évanouir vraiment, dans
les années 68, je suis allée voir une amie qui avait fait une IVG à l’époque où
c’était interdit, donc l’IVG avait pas bien tourné à l’hôpital (…) et pour lui
apprendre à vivre, donc, ils l’avaient mise dans une chambre où il y avait,
euh, un petit bébé à côté, ce qui était totalement criminel et. Enfin criminel,
dangereux, d’une part, quand quelqu’un est pas bien comme ça (…) [et le
médecin l’informe « si ça vous intéresse, sachez que je vous ai enlevé un
ovaire »]. Donc moi de la voir dans cette souffrance et de la voir
pleurer, je me suis évanouie (…).
Donc c’est ce type de
situations, enfin, pour mettre un peu en parallèle : quand je vois
quelqu’un dans une détresse profonde, ou quelque chose qui, qui est pas humain.
Des choses très dures peuvent au contraire me faire réagir, partir au combat.
Mais certaines choses … sont insupportables, quoi. (…)
Ouais. Là je …je
trouvais ça trop, trop dur. Tout en l’admirant pour son courage.
J’imaginais ce que ça
avait dû lui demander comme effort pour parler. Et franchement ça a tourné
beaucoup hein.
Francine est la seule à me parler d’un/e incesté/e, en l’occurrence un incesté, en termes d’admiration et de courage. En revanche, elle n’est pas la seule à être comme pétrifiée par le récit d’abus incestueux.
Francine - Je sais que
mon collègue d’atelier, lui … en tant qu’homme, lui il m’a dit que, qu’il
restait sans voix, qu’il ne savait pas quoi lui dire (…) quand il lui en avait
parlé. (…) Qu’il lui avait un peu souri, qu’il lui avait parlé du travail (…).
Marcelo Viñar remarque que
dans la torture, « La victoire du bourreau est de créer ce lieu d’horreur
dont l’invocation ou convocation devient impossible » (Viñar, 2005,
p 1208). Il explique que raconter la « scène sadique » englue
dedans : dès lors, le défi est de créer un écart entre l’horreur et son
récit. C’est pourquoi penser et dire l’acte monstrueux induit une réelle
nouveauté dans le statut de la parole. Bien sûr. Mais alors comment sortir de
la mise au secret, quand on est une simple victime d’inceste ? Comment
parler à l’enseignant/e, à l’assistant/e social/e ? A soi-même, pour
commencer ?
Laurence, assistante
sociale en planning familial - Pour faire des métiers comme on fait nous faut
pas être insensible. (…) C’est tellement des métiers où vous êtes en tranches
de vie avec les gens que … Alors après, il faut prendre la bonne distance pour
éviter de se faire complètement bouffer (…) enfin cette situation là je l’ai
emmenée en vacances hein, c’est très rare, mais ça, si (…)
Pourquoi ? Parce
qu’elle était jeune. Elle était jeune … (…) personne n’y a vu. Et, ça se passe,
de toute façon ces histoires, ça se passe comme ça, personne ne voit rien.
Longuement, ces paroles ont résonné en moi après l’entretien : c’était horrible, cette histoire l’avait poursuivie même durant ses vacances. C'est-à-dire : le cadre professionnel avait été complètement débordé, il n’avait pas suffit à contenir cette situation.
Marcelo Viñar (2005) explique que celui/celle qui entend un récit d’actes monstrueux commis par un humain sur un autre humain est ou trop près, impliqué/e, capturé/e, ou trop loin, détaché/e, insensible. Il n’existe alors, précisément, pas de bonne distance tenable, mais seulement l’alternative entre l’évitement et la fascination, voire la sidération.
Laurence - On y laisse
des plumes nous aussi, dans des situations comme ça
L’anthropologue – Vous
y laissez des plumes ?
Laurence – Ben du
moins, ça, ça nous émeut, ça nous fait de la peine. On a le quotidien, et puis
des fois vous tombez sur des trucs comme ça hein. Même après 30 ans de métier,
vous vous y faites pas, heureusement.
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Heureusement
… (silence)
Anthropologue – Quand
vous dites ça, ça vous émeut, par exemple quand vous avez cette personne qui
est enceinte de six mois et que vous apprenez que c’est le demi-frère … ?
Laurence – Ben vous
avez un instant de sidération, parce que, même si on nous apprend, en tant que
travailleur social, à faire des hypothèses, (…) eh ben celle-là, à tous les
coups vous y avez pas pensé.
Anthropologue –
D’accord. Même en ayant déjà eu ce, ce genre de chose … ?
Laurence – Je vais
quand même pas penser à chaque fois que c’est une histoire d’inceste.
Afin d’éviter la sidération, d’y laisser des plumes, le plus simple n’est-il pas de ne pas y penser?
Mais n’est-ce pas aussi comme cela, que finalement, personne ne voit rien, dans ces histoires ?
Ceci, au point de mettre parfois Laurence dans une situation pas forcément très éloignée de celle de l’incestée qui essaie d’informer quelqu’un de ce qui lui est arrivé …
Laurence - La gamine,
en plus, placée par le juge, alors bon, vous appelez l’éducatrice qui vous
croit pas
Anthropologue –
Fhm !
Laurence – Mais
vraiment. [inaudible]. « non mais vous comprenez, faut qu’on prenne des
informations ». Je lui dis « mais c’est tout pris les
informations. »
Anthropologue - Hmmhmm
Laurence - Parce que si
vous voulez, ça dépasse l’entendement. Quand vous dites à une collègue
éducatrice, « euh, bon, voilà, j’ai Claudie là, elle vient d’annoncer au
médecin qu’elle est enceinte de son demi frère » » (…). Là si vous
voulez, ce qui est étonnant, par rapport à l’annonce, euh, y’a toujours des
réticences mentales. (…) A partir du moment où vous pensez pas que c’est
possible, ben c’est pas possible.
Stop. Ne serions-nous pas en train de tourner en rond ? Comme dans une sorte de cercle vicieux où l’éventualité d’y laisser des plumes, l’éventualité de la sidération, conduit à ne pas penser que c’est possible … ce qui conduit à être sidéré/e lorsque cela s’avère possible ?
Marcelo Viñar explique qu’il existe trois barrières, dans le cas du récit de torture, à la réception de ce récit par des interlocuteurs/trices.
- Le premier obstacle, c’est qu’un tel récit, fait publiquement, « subvertit la barrière entre notre intimité et le public » (Viñar, 2007, p 52). D’où la nécessité, et la difficulté, de créer un écart entre l’acte monstrueux et son récit.
- Le deuxième obstacle est celui de la langue : « il n’y a pas de commune mesure ni de possibilité de traduction juste » (Viñar, 2007, p 54) entre le monde du torturé, et celui des vivant/e/s. Les mots manquent, comme ils m’ont d’ailleurs souvent manqué, aussi, pour rédiger ce mémoire. Ou, du moins, ont mis du temps à se forger.
Et il faut en outre compter avec une troisième barrière, qui est non seulement d’incompréhension entre « les survivant/e/s » et « les autres », mais est également constituée par une véritable surdité active. Viñar prend comme exemple de ce phénomène un juge de la Cour Suprême, dont la conversation avec un résistant polonais venu apporter son témoignage à Washington, sur le ghetto de Varsovie, est rapportée par Semprún, dans L’écriture ou la vie :
« Monsieur le Juge,
peut-être ne me croyez-vous pas ?
-
J’ai
la certitude que vous dites la vérité – C’est moi qui ne peux ni ne dois vous
croire. » (cité dans Viñar, 2005, p 1207).
Viñar fait le choix de
relater cet écrit tel qu’il s’en souvient, sans vérifier dans l’ouvrage
l’exactitude de la citation. C’est ce souvenir, avec ses déformations, qui
constitue le point de départ de son questionnement : cet épisode lui fait
poser le problème de la crédulité et de l’incrédulité, toujours aigu face aux
violences extrêmes, mais aussi, nous force à interroger, sans avoir de réponse,
le caractère équivoque du propos du juge : « vous dites la vérité, je
(m’impose) de ne pas vous croire ».
Concernant les
maltraitances, des auteur/e/s ont relaté le même phénomène : « En ce
qui me concerne, le point de départ de la recherche fut, en un premier temps,
de communiquer une sorte d’état d’âme, de vécu, d’éléments de contre-transfert,
individuel et groupal, un peu honteux, assez scandaleux, et de demander :
« Doutez-vous, vous aussi, alors que vous avez devant les yeux des
éléments imposant la certitude ? » (Thouvenin, 1991, p 103).
L’article s’intitule précisément : « Sévices sexuels intra familiaux – du
secret à la révélation : le doute, sa répétition comme signal
d’alarme », et l’auteure y propose de prendre, précisément, l’existence en
soi de ce doute comme constituant un indice de la réalité des maltraitances.
Une solution face à
l’horreur, c’est en effet la fuite mentale. Elle peut être le fait de
l’enseignante qui n’utilisera plus le texte de Bettelheim et constate elle-même
que c’est « lâche ». Elle peut être le fait de l’assistante sociale
qui ne va pas penser à chaque fois, que cela pourrait être un inceste, car probablement
ce serait éprouvant. Elle peut être le fait de l’éducatrice qui, tout
simplement, n’y croit pas.
Parfois, la fuite mentale,
la surdité active, peut être le fait des mères, ce qui suscite des sentiments
très vifs, au point de donner envie de … fuir, d’arrêter l’entretien.
Micheline, assistante
sociale en lycée professionnel - c’est rarement quand même les maman [qui
venaient lorsqu’elle travaillait pour l’Armée]. Moi j’ai eu plus des maman qui
croyaient pas leur gamin en fait
L’anthropologue –
Hmmhmm. Oui, c’est …
Micheline - … je pense que c’est le pire
(…). Et là, quand je
vous disais un entretien, là où j’avais envie de dire à la fille « arrête,
je peux plus », c’était ça quoi : la maman l’avait pas crue du tout,
du tout, continuait de vivre avec le beau-père, la gamine était placée, et il
refusait de voir sa gamine : la maman n’avait pas vu sa gamine depuis un
an.
Bien sûr, l’assistante sociale ne peut plus : c’est insupportable, cette surdité d’une personne chargée de protéger un enfant, le sien.
Ainsi, tout le monde a fui : la mère, l’enseignante, l’assistante sociale, l’éducatrice … même le juge, dans un autre contexte, rapporté par Viñar, nous apprend s’être voilé la face devant une horreur insupportable.
Mais à cet instant, les vacances me reviennent en mémoire … les miennes : je réalise, grâce aux propos d’une assistante sociale, que quant à moi, je l’ai toujours « emporté en vacances », ce fardeau, et que cela m’a toujours semblé normal. Mais aussi partout, tout le temps. La nuit, le jour, au sommet des montagnes, pendant la fête avec des ami/e/s … il y avait toujours ce mauvais fond, gris sombre, et le reste derrière, qui attendait, lugubre.
Alors maintenant que tout le monde a fui l’horreur, je me permets de donner la parole à une personne qui n’a pas encore été entendue : il s’agit d’Aline. Elle est à l’école primaire, quand Eva Thomas nous transcrit, au début de son premier livre, ce qu’elle lui confie
« « Je pense
toujours à ça. J’ai peur, toujours. Je pense toujours à ce qu’il [mon père] m’a
fait dans le lit, la nuit. Je voudrais bien penser à autre chose, comme mes
copines, mais je ne peux pas.
Un jour, je me suis
dit : « ce serait bien si on pouvait changer de mémoire, mais ce
qu’il y a de plus terrible dans la vie, c’est qu’on ne peut pas changer de
mémoire » » (Eva Thomas, 2003, p 11).
Aline relate ici combien elle aussi, souhaiterait pouvoir fuir : en changeant de mémoire, puisqu’elle, n’a pas d’autres moyens.
Mais Aline n’est pas morte de ces souvenirs horribles, ni Eva Thomas qui l’a écoutée. Alors quoi ? Peut-être que l’insupportable, on n’en meurt pas, enfin pas toujours. Peut-être que l’évanouissement, on en revient. Peut-être qu’on n’est pas obligé/e de fuir.
Au lieu de changer de mémoire, ce qui est impossible[41], Aline, mise à l’abri de son père, va rencontrer Eva Thomas, psychopédagogue dans son école, et lui raconter ses histoires, son histoire. Partager cette mémoire.
Quant à Eva Thomas, ce partage la conduit à un saut.
« J’ai sauté dans
mon histoire, sur un cahier d’écriture. Elle m’a dicté ses secrets. Je retrouve
les miens au fil des pages, la peur du père intacte, et ma nuit noire avec
toute sa violence. » (Eva Thomas, 2003, p 13)
Et c’est ainsi qu’elle commence l’écriture de son livre de témoignage sur son histoire à elle, partageant à son tour sa mémoire qu’elle ne peut changer.
De son côté, Viñar,
continuant à nous parler de la violence dans l’espace public, explique que
« L’affirmation de l’inexistence de l’horreur – par son déni ou par sa
banalisation – n’est pas seulement une imposture, mais l’affirmation d’un non
sens. C’est un événement dont l’existence est connue et escamotée »
(Viñar, 2007, p 59). Ce n’est pas du silence mais l’inscription active
d’un vide : « l’abolition d’un réel accompli » (Viñar, 2007,
p 59). Ce qui supprime toute possibilité d’inscrire la signification de ce
réel : il ne s’agit donc pas simplement de réfuter un mensonge, mais aussi
d’effectuer cette réinscription symbolique, cette restitution des mémoires.
Restitution des mémoires qui remet en mouvement « ce que l’amnésie active, poussée par la peur (peur non reconnue la plupart du temps) avait transformé en trou noir de l’omission signifiante » (Viñar, 2007, p 60). Viñar cite l’exemple de l’Afrique du sud à la sortie de l’Apartheid, où les coupables étaient grâcié/e/s s’ils/elles avouaient publiquement le détail de leurs actes criminels. Puis exempté/e/s de prison et exilé/e/s ailleurs pour recommencer une nouvelle vie : pour Viñar, « c’était désormais la société entière qui était concernée, sans déni et sans démenti, dans un travail de transfert et d’élaboration de ses fautes et de ses réparations. » (Viñar, 2007, p 61).
Concernant les violences sexuelles intra familiales (ou par d’autres proches), le travail d’élaboration par la société reste, manifestement, embryonnaire. Le partage et la restitution des mémoires autour de ces actes horribles-là, extrêmement difficile.
Mais après le choc, la sidération, voire l’évanouissement, un rebond nous fait subitement prendre de la distance. Beaucoup de distance.
Fabrice, assistant social en service enfance, affiche beaucoup de « sang froid », de « détachement », dans ses descriptions. Se repose beaucoup sur les procédures dans son action ou du moins ce qu’il m’en décrit. Il fait le parallèle entre la recherche de « faisceaux d’indices, de signes d’alerte » qu’il doit parfois effectuer, et l’enquête policière. Il ne se souvient même plus spécialement de s’il a des enfants incestés dans ses suivis : il doit consulter son cahier recensant ces suivis, pour me répondre. Comme si c’était juste un élément « banal » au milieu d’autres maltraitances multiples ? L’ordinaire de son travail, il le précise à ma demande, juste après avoir refermé ce cahier en constatant qu’il n’avait pas d’enfants incestés dans ses suivis :
L’anthropologue - et
quand vous dites mauvais traitements, c’est ?
Fabrice, assistant
social en service enfance - C’est … ben là, là, dans le cas de cette jeune
fille qui est devenue majeure la semaine dernière, c’était par exemple être
attachée au radiateur, ne pas, euh … avoir un déficit de soins terrible, un
déficit d’attention, terrible. Donc, voilà. Une petite fille qui était et
maltraitée, on va dire de façon active, et maltraitée parce que négligée.
Il semble, par son détachement et le fait de beaucoup s’appuyer sur les procédures, être un représentant paradigmatique de l’optique administrative de la Protection de l’Enfance telle qu’elle est décrite dans les documents officiels. Etrange. Ou bien peut-être s’est-il contenté de présenter, durant l’entretien, ce masque-là ? Ne me dit-il d’ailleurs pas lui-même, en clôture de cet entretien, n’avoir répondu à rien parmi mes questions ?
On a vu, néanmoins, qu’il était tout à fait capable d’envisager de lui-même que son interlocutrice ait été abusée par son père. La seule chose dont il montre qu’elle lui est difficilement supportable, c’est quand une mère commence à lui expliquer, dès le premier entretien, qu’elle se promène « à poil » dans l’appartement, et à lui parler de ce qu’elle a fait pour les premières règles de sa fille. L’exhibition de l’intimité féminine le fait ainsi plus fortement réagir que de penser à un possible abus incestueux.
Remarquons alors que Fabrice est un homme, cependant que jusqu’à maintenant, nous avons évoqué uniquement des réactions de femmes. Tout comme pour mes entretiens avec des incestées, j’évolue d’ailleurs dans un monde très féminisé : sur dix entretiens, deux sont faits avec des hommes. J’évoque cette piste de la différence de genre, car le bénévole associatif qui m’avait accueillie pour me présenter son association m’expliquait que, simplement, il fallait se « blinder », prendre les dossiers avec détachement. Il enchaînait en m’expliquant que la prévention dans les écoles relevait, quant à elle, plus d’une sensibilité féminine.
Est-ce à dire que l’optique « procédurale », détachée de toute émotion, de la Protection de l’Enfance, se situerait plutôt du côté d’une socialisation masculine, alors même que la majorité des employés y sont des employées ?
Patricia, bénévole associative, a, précisément, du mal à supporter la souffrance induite par le respect strict de ces procédures, et elle le dit.
Patricia - Là on a un
signalement anonyme, y’aura pas de suites, puisque c’est anonyme, donc voilà.
Et puis même si les gens viennent et qu’ils portent pas plainte, (…) c’est dans
le dossier, puis on n’y pense plus, quoi. Parce que de toute façon après, on
attend que les gens changent d’avis et puis viennent nous voir, hein.
L’anthropologue - Oui.
C’est archivé jusqu’à ce qu’ils reviennent, c’est ça ?
Patricia - Voilà.
Voilà. (silence)
Mais c’est vrai que
c’est, ça fait mal au cœur parce qu’on est impuissants, donc le gamin continue
(si c’est vrai, toujours) de, de subir.
(Silence)
Mais on se dit quand
même, que si c’était, si c’est vrai, je sais pas comment les gens peuvent
garder ça pour eux sans le … parce que c’est quand même non assistance à
personne en danger, quand on est spectateur de quelque chose et qu’on le
dénonce pas. (…) Donc s’ils portent pas plainte, peut-être, on se dit, pour se,
peut-être pour nous rassurer, que c’est, que c’était pas grave. Mais on sait
pas …
(…) quand c’est sans suites comme ça, ben on se
dit y’a encore un gamin qui trinque, et ça c’est vraiment insupportable, hein
parce qu’on se dit mais bonté, à quoi on sert, là ? Qu’est-ce qu’on peut
faire, et on peut rien faire, c’est pas. C’est terrible.
Anthropologue - Et en
plus, plus de traces, plus de nouvelles …
Patricia - Non, ben
oui, voilà, ouais. Alors c’est vrai qu’on essaie de se dire, si on n’a plus de
nouvelles, c’est que c’est moins grave, mais bon, on sait pas. On se dit ça
pour, pour se donner bonne conscience, hein. C’est ça après hein.
Anthropologue – Oui.
Hmmhmm. Hmmhmm.
Patricia - Ou est-ce
que ça c’est au contraire bien resserré et puis que c’est bien en train de
faire le mal, là euh.
Puis après on se dit quand même qu’à l’école ça se voit quand même. Les gamins sont quand même perturbés, d’un seul coup travaillent plus, font plus les devoirs, ou ils ont des problèmes avec les copains, ils se bagarrent, ils font des, des choses pas habituelles.
Une fois toutes les possibilités de recours adulte évanouies, une fois admis le fait que « penser que c’était faux ou pas grave », c’est pour moins mal supporter soi, il ne reste qu’un espoir, finalement : que l’enfant lui-même donne des signes d’alerte à l’école. Or, les incestées nous ont montré le soin qu’elles prenaient au contraire, pour la plupart, à tenter de se « fondre dans la masse ». Sans compter celles qui sont premières de la classe, comme Paulette, et dont jamais personne n’ira soupçonner que ...
La croyance, répandue, que les enfants maltraités donnent des signes de cela, par des comportements « remarquables », en écart aux normes, à l’école, trouverait-elle là une partie de son explication ? Notons, de surcroît, que cet enfant en écart aux normes semble être plutôt « masculin », alors même que les incestés sont plus fréquemment des incestées : une fille, dans l’imaginaire des adultes français/es, se bagarre-t-elle ?
Dans la position de relais qu’occupe Patricia, l’absence de suites s’avère particulièrement douloureuse : contrairement aux personnes sidérées car ne s’attendant pas à tomber sur un inceste ou une autre maltraitance grave, pour elle, l’inceste, c’est l’ordinaire. Dès lors, ce qui génère la souffrance, c’est de ne rien pouvoir faire pour que ça s’arrête.
Mais même quand un dossier aboutit sur une plainte, et la plainte sur un verdict de culpabilité de l’incesteur, assorti d’une condamnation à de la prison ferme, ce qui reste rare, il n’est pas garanti que ça s’arrête, comme nous l’apprend, et se l’apprend de nouveau, Francis.
L’entretien avec lui avait commencé sur des généralités autour de son travail. Il aurait pu se terminer de la même façon. Le fonctionnement de la Protection de l’Enfance, les mesures en pratique, les procédures, les relations avec le juge, les parents … et puis au bout d’une heure vingt environ, l’entretien bascule. Il durera au total 2h20. Et il a fallu une heure vingt avant que ne revienne en mémoire à Francis ce souvenir, qu’il avait oublié, complètement occulté.
L’anthropologue - Parce
que ce, ce père en fait, donc y’avait le placement par le juge, euh, et le
père, lui il avait été reconnu coupable, c'est ça en fait ?
Francis, éducateur en
service enfance - Il a été reconnu coupable, mais en même temps il a pas été
reconnu, (…) il a pas été
Anthropologue –
Déchu ?
Francis - Déchu de son
autorité parentale ou avec une interdiction de droit de rencontre.
Anthropologue – D’accord.
Francis – Sauf, bien
évidemment, y’avait des rencontres, de ce papa avec ses enfants avec un tiers.
Voilà. Mais après, toute la question, c'était de savoir comment on va évoluer,
derrière tout ça ...
Anthropologue – Oui.
Justement, c’est …
Francis – Comment on va
évoluer sur … heuuuum … des rencontres de ce père avec ses enfants, sans tiers
(expiration sceptique).
Parce que quand il y a
un regard, finalement, ça limite le passage à l'acte, ça l'évite (…). Après, on
peut travailler sur la parentalité, qu’est ce qu'il transmet, qu’est-ce que
(sceptique : ) "certes".
Mais à un moment ou à un autre, le parent, pour être aussi parent, il est parent seul avec son enfant ...
Les auteur/e/s de l’ouvrage La violence impensable relatent que « Actuellement, la déchéance d’autorité parentale du père est très rarement requise dans les cas d’inceste, alors qu’elle constitue une mesure de protection de l’enfant à long terme, puisque, c’est une évidence, les pères incestueux ne sont pas nécessairement incarcérés jusqu’à la majorité de leurs enfants. » (Gruyer-Nisse-Sabourin, 2004, p 187).
Je reste moi-même stupéfaite, devant ce que me raconte Francis, histoire récente puisqu’elle date du début des années 2000. Il me faut du temps, et plusieurs questions, pour comprendre : l’incesteur avait été condamné à une peine de prison pour ses actes incestueux sur sa fille. La mère ne s’était aucunement séparée de lui, même emprisonné ainsi. La fille avait alors été placée. Et puis l’incesteur avait fini sa peine de prison, et était revenu au foyer, vivre avec son épouse.
Francis - Oui, oui,
l'enfant était encore mineure. Mais …en même temps, voilà : euh … il a fait sa
peine, mais est-ce que ça exclue pour autant qu’il y aura un nouveau passage à
l'acte ? Une peine, ça n'empêche pas ça hein. Oui, il a payé pour ce qu'il a
fait, il a payé pour ce qu’il a fait. Mais est-ce qu’il, est-ce que ça empêche
ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire ?
Voilà, ce, c'est là
tout notre travail de, d’essayer de, d'avoir les garanties que ça ne va pas se
reproduire. Mais … alors la meilleure des garanties, la garantie principale,
c'est de dire : ben il est pas en contact. Au moins comme ça, c'est identifié :
problème exclu. Mais ça résoud pas la chose.
Quand il est en
contact, est-ce que, est-ce que pour autant ... ? Alors voilà, on s'appuie sur
des expertises, sur un suivi psychiatrique, sur … sur une avancée de ce parent,
aussi, en tant que parent par rapport à l'acte qu'il a fait, à sa culpabilité,
toutes ces petites choses là, qui font que ...
ben peut-être que, voilà ... ou qu'il a montré qu'il était en capacité
de, si ça allait pas, si, voilà, « pof », il interpelle tout de
suite. (…) Ca, c'est des éléments con, concrets du quotidien qui nous
permettent à nous en tant que travailleurs sociaux de euh … de s’appuyer dessus
euh, pour, pour travailler avec eux, euh, voilà, sur ces notions de parent (…)
: "vous voulez récupérer votre enfant, ben pour récupérer votre enfant, on
en est là, il va falloir aller là, et donc il va falloir qu’on détermine ensemble
quelle va être la démarche à suivre, quelles vont être les différentes
démarches à suivre". Et puis, ben, aujourd'hui il en est là, (…) ou on en
est finalement là, on avait prévu ça, on n'en est que là.
Dans un premier mouvement, le « cadre » référentiel habituel (travail sur la parentalité, etc) est menacé, et les soupirs de Francis le montrent bien : le discours habituel porte à faux, ici, comment imaginer restaurer la parentalité de cet abuseur ? Parentalité qui implique d’être seul avec son enfant … alors il faudrait séparer définitivement cette enfant de son père-incesteur : « Au moins comme ça, c'est identifié : problème exclu », précise Francis, avant d’ajouter : « Mais ça résoud pas la chose. ». Chose mystérieuse, qui fait revenir au grand galop le « discours » standard sur la parentalité, discours qui peut finalement être plaqué là, moyennant le renfort de la légitimité de l’expert psychiatre, qui sans doute saura discerner si l’incesteur se sent enfin coupable au point de pouvoir redevenir un père.
Le problème pour Francis, ici, c’est l’éventualité de récidive de l’incesteur : c’est le modèle médiatisé du « pédophile », qui « viole les enfants en série » qui entre en conflit ici avec les manières habituelles de traiter les situations de maltraitance. Il n’évoque pas, ne semble pas penser, en revanche, le problème qu’il pourrait y avoir du fait qu’une personne puisse être obligée ainsi à vivre de nouveau sous le même toit que son ex-violeur, et qui plus est, en devant l’appeler « papa ». Pourtant, y compris dans des situations de maltraitance sans abus sexuels, cette question se pose : David Bisson, plus connu sous le nom d’ « enfant du placard », écrit, à propos de sa mère tortionnaire
« Quelqu’un m’a
dit un jour que ma mère avait eu de l’amour pour moi, à sa manière. J’ai du mal
à le croire. Il s’agissait bien plutôt de haine. (…) Une chose m’a longtemps
ennuyé : la volonté qu’elle mettait à nier l’évidence. Elle a été
condamnée pour m’avoir brûlé les mains. Or, elle n’a jamais reconnu l’avoir
fait. (…)Elle a toujours refusé le psychiatre. Pour elle, elle allait bien.
Elle n’a jamais voulu se soigner. Je trouve cela vraiment dommage.
En repensant à tout
cela, maintenant, je me dis que si l’on avait revécu ensemble, on serait restés
dans une observation mutuelle, avec le poids du passé, sans pouvoir aller plus
loin. (…) On sera dressés l’un en face de l’autre pour le reste de la vie. Ou
alors, il faut faire une croix sur ce qui n’a pas été possible. » (Bisson,
2008, p 119-120).
Mais faire une croix sur ce qui n’a pas été possible, c’est dire que cette mère n’en a pas été une ?
Par delà la question de la déchéance de l’autorité parentale, ou de son absence, se pose en filigrane celle de ce qu’est être un parent, aux yeux de la société française. Là est d’ailleurs bien la raison du trouble de Francis : le père et le pédophile, ne peuvent être la même personne. Au point qu’il m’explique que, lorsqu’il a rencontré ce père la première fois au tribunal, il a eu du mal à le considérer comme un père. Il avait sous les yeux un abuseur, donc pas un père. C’est pourtant alors qu’il était père que l’abuseur a violé sa fille … mais aucune procédure ne semble avoir été prévue pour aider l’enfant à supporter ce fait, et les adultes autour d’elle à l’assimiler.
Tout comme j’ai été renvoyée, lors de certaines de mes demandes d’entretien, à « plus spécialiste que nous », les incesté/e/s peuvent être renvoyé/e/s à plus compétent/e que soi. Delphine Serre relève : « A première vue, les assistantes sociales ne disposent pas d’un savoir d’expertise aussi facilement repérable que la pédagogie, la médecine, les savoirs du psychisme (psychologie, psychanalyse, psychiatrie). Ces savoirs sont, eux, des disciplines constituées ; ils ont un support institutionnel et objectivable (l’école, les institutions médicales ou para-psychiatriques) et renvoient aux professions bien identifiées socialement que sont les enseignants, les médecins, les professsionnels du psychisme. » (Serre, 2009, p 58). Francis n’est pas assistant social, mais éducateur, et nous parle des parents qu’il a en suivi.
Francis, éducateur en
service enfance - C’est le gros quid. En sachant que quand c'est des gens, qui
sont euh … quand y’a, quand ils sont soignés, on va dire que ça aide énormément,
mais quand ils souhaitent pas ouvrir, ou en tout cas quand ils ont souhaité
l’ouvrir, mais qu’ils souhaitent marquer une pause, comme je vous le disais,
sur ce traitement beaucoup plus individualisé, euh, voilà, de tout ce vécu
douloureux et de ce qu'il pourrait y avoir, en tout cas, inconsciemment, dans
ce qu'ils pourraient transmettre, là c’est compliqué, c'est beaucoup plus
complexe de suivre ces gens, puisque, puisqu’on est obligé de faire avec, là où
ils en sont.
Le/la travailleur/euse du psychisme est perçu/e comme un partenaire souhaitable dans l’aide à la parentalité, par exemple quand le parent a un passé d’incestée. Mais plus généralement, il est fréquent qu’une incestée soit orientée sur des relais. Ou du moins, qu’on essaie de le faire …
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial - Elle disait que sa maman c’était quelqu’un de
fragile, qu’elle voulait pas lui faire de mal. Donc … elle portait ça toute
seule, et c’était très lourd
Euh … et elle faisait
usage de différents produits : drogues, autres alcools, tabac, euh, voilà.
C’est peut-être ça qui m’a … m’inquiétait le plus, ces, ces usages, voilà,
parce que elle m’avait dit qu’à certaines périodes quand elle allait mal elle
pouvait passer aux drogues dures quoi. Elle avait 16 ans. Et qu’elle était
aussi pas mal dans la mouvance techno. (…)
Le premier entretien
qu’on a eu, il a été très long.
Donc on a beaucoup discuté de comment elle se sentait, de ce qui était, alors moi je lui a expliqué que c’était important qu’elle reste pas avec ça, qu’elle en parle à d’autres, mais que moi je pourrais pas faire un suivi, enfin, je pourrais pas assez …. Euh … l’accompagner par rapport à ce problème, et que il fallait à tout prix qu’elle aille voir des gens compétents. Donc (…) je l’ai orientée vers l’espace santé jeunes parce que, étant donné, enfin, c’était l’endroit le plus facile d’accès pour elle, pour qu’elle puisse après être orientée vers un suivi thérapeutique ou autre.
Delphine Serre explique que « La notion de partenariat est une nouvelle catégorie d’action publique qui prévaut dans les dispositifs mis en place dans les années 80 (…). Avec la décentralisation, les assistantes sociales se trouvent de plus en plus soumises aux différentes politiques territoriales et la partenariat devient une exigence majeure qui pèse sur elles. (…) Au niveau des pratiques, les assistantes sociales de la nouvelle génération semblent avoir une propension plus forte à déléguer et à orienter vers d’autres services » (Serre, 2009, p 214-215), alors que celles/ceux recruté/e/s et formé/e/s avant les années 80 tendaient à « tout » faire elles-mêmes.
Cécile - Ce qui s’est
passé c’est qu’avec cette fille, j’ai essayé de mettre en place des suivis et,
pour que d’autres personnes la prennent en charge et, c’est toujours revenu,
euh, voilà.
L’anthropologue –
(rire)
Cécile – Elle est
toujours euh … Et peu de temps après, à la rentrée, enfin ça ça c’était passé
au mois de juin. A la rentrée elle allait super bien, et, et ensuite elle est
revenue … heu … (…) ça allait très bien, elle voulait plus trop entendre parler
de suivi, de quoi que ce soit, et puis après elle a eu des hauts et des bas. Et
à chaque fois qu’il y avait un bas, ben, du coup, les formateurs lui disaient
« bon, à qui tu veux parler ? », et elle revenait toujours (…).
La situation est ici d’autant plus inconfortable pour Cécile, que la jeune fille refuse absolument que sa mère soit mise au courant : en fait, elle a communiqué son secret à Cécile, qui ne se sent pas compétente pour s’en occuper, en porter la charge. Mais qui sera compétent/e ?
Seul/e/s les travailleurs/euses du psychisme, du moins celles et ceux qui parviennent à entendre les récits d’abus incestueux, s’occupent en fait durablement du suivi des incesté/e/s.
Mais leurs réactions à ces situations restent dans le non-dit.
Irène, pédopsychiatre libérale, semble très détachée, sans angoisse ni sidération, du moins qui soit visible, par rapport à cela. Lorsque je lui demande un ordre de grandeur, elle me dit que chez elle, environ un/e patient/e sur 10 est concerné/e : les récits d’abus incestueux, c’est donc habituel, pour elle ? Ou bien alors, simplement, elle n’avait nullement envie de laisser transparaître ses réactions à ces situations ? Soit.
Christine n’en dit guère plus. Il faut écouter ce qu’elle relate de ses patientes pour, peut-être, entrevoir quelque chose.
Christine,
pédopsychologue en CMP - Elle allait bien quand elle est partie. (…) La famille
semblait avoir fait un gros travail psychologique aussi, le couple aussi, bon.
(…)
alors attends, son truc
c’était vraiment très très tordu : c’était que du coup, elle, elle allait
menacer son père de porter plainte, parce que c’était ça qui s’était tramé avec
cette personne de l’association. Et s’il veut pas que je le menace, faut qu’il
me donne de l’argent.
L’anthropologue – Ah
oui ?
Christine – Voilà. Donc
c’était un truc qui était complètement perverti, à mon avis, et cette dame lui
avait mis dans la tête qu’il fallait qu’il lui donne de l’argent pour lui payer
une psychanalyse.
Anthropologue –
D’accord …
Christine - Voilà. Donc elle est arrivée avec ce, ce
truc là en tête, complètement vengeresse, donc pas bien du tout, en fait, c'est-à-dire,
avec, donc, si tu veux, tout ressortir de tout ce qui s’était passé.
Et, dans cet extrait dont j’avais déjà cité une partie plus haut, elle enchaîne immédiatement sur la relation « d’amour » entre cette fille et ce père incesteur, ainsi que sur son infidélité car il a été voir ensuite la petite sœur. En fait, j’ai l’impression que transparaît dans ses récits le caractère insupportable pour elle de la haine et de la colère des incesté/e/s envers des parents. L’extrait suivant va peut-être dans ce sens :
Christine - c’est une
des rares qui arrive à être très nuancée, par rapport à cette question
d’inceste, parce que ça c’est un truc qui est très très dur, très, très
douloureux. Et elles ont décidé de porter plainte. Tu vois elles ont 35 ans, hein.
Elles ont donc porté plainte, avec sa sœur. (…) La sœur elle peut pas supporter
le père du tout, alors que la mienne elle dit : « mon père il a été
un bon père. Il a fait des choses qu’il avait pas le droit de faire, certes, et
il faut le punir pour ça, mais il a été sur tout un tas d’autres sujets, il a
été un bon père ». Tu vois. Donc ça, c’est quand même intéressant.
L’ennui, c’est que, précisément, ces questions d’inceste, c’est très dur et très douloureux : qui sera compétent/e, alors, pour pouvoir supporter d’entendre les sentiments, de haine, de colère, induits par la douleur ?
Quelque
angoisse
Hier, discussion avec deux jeunes profs de fac [un
couple, dans les couloirs d’un colloque pluridisciplinaire]. Ils me demandent
sur quoi je travaille. Je leur explique : « l’inceste », en anthropologie.
Leur réponse : « ah ouais, c’est intéressant,
ça, comme sujet ». On en discute, ils (il et elle) me posent des
questions, j’y réponds, jusqu’au moment où il me demande s’il y a un lien avec
des milieux sociaux, et est-ce qu’on a des chiffres.
Je lui réponds : en France on n’a pas de chiffres,
au Québec, il y a eu des stats de faites, et ça touche tous les milieux
sociaux.
[Puis] Je fais : « oui, on préférerait que ce
soit dans des petits villages, chez les ploucs, etc, enfin en tout cas, pas
dans notre milieu ? » sur un ton plaisantin.
Puis j’enchaîne en disant que par exemple, parmi mes
entretiens, j’ai une mère victime d’inceste, qui est issue de milieu ouvrier et
prof de fac. Eh bien son mari, prof de fac aussi, a incesté leur fille.
Là, mes interlocuteurs ont soif, il est d’un coup urgent de chercher de l’eau
et d’en trouver.
(Ouf) on en trouve. Ils boivent, m’en proposent (« non merci, moi ça
va »). De fait, ensuite, à leur initiative, on change de sujet de
conversation (notes du 01/03/2008)
La question du milieu social apparaît très peu dans mes entretiens. Hormis avec Christine, qui pense que les familles bourgeoises sont probablement moins touchées car plus stables. L’instabilité, pour elle, étant causée notamment par la « dissociation », c'est-à-dire le divorce. Delphine Serre relate quant à elle que « Face à un public armé culturellement, « capable d’argumenter » et maîtrisant la hiérarchie symbolique des institutions d’encadrement (…) la mise en valeur des obstacles rencontrés aboutit finalement à un retournement complet du rapport de forces au sein de la relation assistantielle : il s’agit de conquérir « le droit de travailler » avec ces familles. » (Serre, 2009, p 92). Francis, lui, évoque ce qu’il imagine de ces milieux sociaux qui échappent à son action.
Francis, éducateur en
service enfance - Sauf que c’est, alors peut-être … euh … que c'est moins su
dans les familles beaucoup plus insérées (…). Traité en tout cas en priorité
par, par la famille qui va assurer un moyen de protection. Ensuite après, ça veut pas dire que celui qui a été victime
va pas porter plainte à un moment donné. (…)Et puis, il y a peut-être, euh,
voilà, tout le poids de l'environnement social et familial, qui fait que, avant
qu'il y ait un passage à l'acte, il y a, il y a la, voilà, cette mesure un peu
de protection qui intervient.
L’anthropologue -
mesure de protection ?
Francis - En tout cas
de l'extérieur, qui va venir protéger l'enfant, euh, l’extérieur, surtout,
enfin essentiellement familial, mais, voilà, qui va, qui va venir protéger
l’enfant de, de ses parents, ou de son parent qui pourrait être potentiellement
... parce que, parce que … (silence) … je pense qu'il y a moins, dans des
familles beaucoup plus défavorisées, au sens large ... elles sont aussi
défavorisées sur le plan de l'environnement familial.
Anthropologue -
c'est-à-dire ?
Francis – C'est-à-dire
qu’elles sont beaucoup plus isolées, ou les contacts avec la famille [élargie]
sont beaucoup plus complexes.
L’inceste est donc imaginé aujourd’hui, majoritairement,
comme concernant tous les milieux sociaux. Même si quand c’est dans sa propre
profession, cela peut donner soif : l’inceste, c’est avant tout loin de
soi. Physiquement.
Par exemple, Francis est un urbain.
Francis, éducateur en
service enfance - Alors ... on sait très bien, hein, des situations d'inceste,
il y en a encore, hein, dans les campagnes, dans les montagnes, moins
maintenant, mais il y a 50 ans, hein, dans les campagnes, dans les montagnes,
il y en avait, hein.
L’anthropologue -
hmmhmm. Et en ville, quelques fois, ou ... ?
Francis - En ville
c’est, c’est beaucoup plus, ça se voit moins, peut-être, et puis il y a plus
d'interactions avec l'extérieur : à l'époque en campagne et en montagne, ils
étaient beaucoup plus isolés, donc ils se reproduisaient entre eux. Alors la
consanguinité, c'est bien connu, et ça se voit encore maintenant. Ca se voit
hein : vous allez en montagne et en campagne, enfin voilà, enfin des
anciennes générations, quoi, pas des nouvelles, mais les anciennes. Vous
regardez dans les cimetières, en montagne, il y a trois familles. Donc il y a
eu (…) aussi, sûrement des passages à l'acte, avec de la consanguinité, des
cousins plus ou moins éloignés, et puis voilà, c'étaient, ben, les fameux
idiots du village hein.
Anthropologue - les
idiots du village ?
Francis - La
consanguinité, souvent, ça donne pas non plus euh, ça c'est connu, ça donne pas
(…). enfin je fais beaucoup, je fais un peu de montagne, donc je me suis assez
intéressé à ça et, voilà, enfin. (…) Et puis vous avez sûrement du le voir, il
y a des auteurs qui l'ont repéré par rapport à ça.
Anthropologue - hmmhmm.
Et donc sur les situations urbaines, c'est celles que vous retrouvez chez le
juge dont vous me parliez ?
L’inceste est éloigné géographiquement, socialement (ce ne sont pas des gens comme lui), mais aussi temporellement (c’était il y a 50 ans, c’est dans le cimetière), et la violence sexuelle y est occultée par le passage de « l’inceste viol » à « l’inceste consanguinité entre cousins », sanctionné, par la biologie, de dégénérescences dans la descendance des fautifs.
Il est intéressant de préciser à quel moment de l’entretien ce propos surgit : Francis vient de se remémorer l’insupportable situation rencontrée durant son stage. Puis d’exprimer son scepticisme sur la viabilité, dans ce cas, des solutions habituelles d’aide à la parentalité. Puis de chercher recours auprès des experts psychiatres pour, quand même, pouvoir aider à la parentalité et reconstruire la famille dans ce cas. Et c’est ici, précisément, que s’insère le périple qu’il vient de nous faire effectuer en montagne et dans les campagnes.
Dans son ouvrage, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Georges Devereux relate son expérience qui a consisté à observer les réactions de groupes, d’ethnologues puis de psychanalystes, à la projection d’un film montrant des rites de circoncision et de subincision en Australie. Il a également collecté les réactions individuelles et même des rêves analysés avec certains des psychanalystes, après la projection.
Devant les ethnologues « Le film (…) n’était accompagné d’aucun commentaire, vu que toute l’assistance connaissait par ses études le rite australien de subincision, dans lequel la peau du pénis est entaillée petit à petit avec un éclat de silex, l’urètre étant progressivement ouvert du méat jusqu’au scrotum. Les réactions féminines et masculines au film différaient nettement. (…) La familiarité intellectuelle des étudiants avec les rites de subincision australiens, en même temps que le fait qu’ils se définissaient comme des ethnologues professionnellement intéressés à ces faits, atténua quelque peu l’impact traumatique du film. » (Devereux, 1980, p 87).
En revanche, le groupe de psychiatres assiste à une projection du film commentée par Devereux : « Commentateur du film, je faisais face, la plupart du temps, à l’assistance ; ce qui me permettait d’observer une quantité surprenante d’agitation nerveuse, de chuchotements et autres signes évidents de malaise. Je vis aussi que, durant la scène culminante de subincision et immédiatement après, un certain nombre de jeunes psychiatres et de candidats psychanalystes quittèrent la salle, individuellement ou par groupes de personnes du même sexe. (…) La plupart de ceux qui partaient étaient des hommes, dont plusieurs candidats analystes (…). Après le film, (…) la discussion fut étonnamment courte pour un public qui, comme je l’appris par la suite, était habituellement curieux et animé. » (Devereux, 1980, p 89-90). Ceci motive Devereux à rester un jour de plus, pour demander à plusieurs de ces personnes de lui communiquer les rêves qu’elles ont pu avoir fait durant la nuit suivant cette projection.
Il commente, à propos de l’un d’eux : « Le lieu du rêve était habilement choisi ; il accroissait la distance entre le dormeur et l’Australie et l’éloignait aussi de la ville où il avait vu le film. » (Devereux, 1980, p 93). Cette défense par éloignement géographique est présente dans la majorité des rêves qu’il commente.
Elle est bien présente parmi mes interlocutrices/teurs également. Et il ne s’agit pas de n’importe quel éloignement. Les campagnes, les montagnes, mais aussi les DOM-TOM, sont des territoires dominés, soit dans le rapport urbain moderne / rural « archaïque », soit dans le rapport issu du colonialisme. Les habitant/e/s de ces territoires constituent comme des étranger/e/s à « notre » monde, urbain et métropolitain.
Et cet éloignement permet de parler, entre femmes blanches, de l’inceste chez ces « autres » :
L’anthropologue - (Long
silence. Je cherche une question) et quand vous me disiez, vous parliez de
l’île de la Réunion, je reviens en arrière, ça se, ça se produit plus, il y a
plus de cas, tout ça etcaetera … ?
Micheline, assistante
sociale en lycée professionnel – Ben l’époque où j’y étais, c’était quand même
il y a un bon bout de temps, hein.
Anthropologue - Ouais,
c’était quelle période à peu près ?
Micheline - 80-83, donc
ouais ça va faire 30 ans … (…). Euh, ben ça se produisait beaucoup plus en
intrafamilial (…). Mais là c’était plus les assistantes sociales de secteur en
fait qui s’occupaient de ça . Moi c’était plus des discussions avec des
collègues de secteur, en fait, qui m’expliquaient ça. (…)
Anthropologue - Mais en
tout cas, enfin y avait, y avait des cas visibles, et qui, et qui arrivaient à
en parler, quoi ?
Micheline - Ben c’est
ce qu’elles me disaient, en tout cas, hein. Ouais ouais ouais ouais ouais.
Anthropologue - Hmmhmm.
Ce que vous retrouvez pas forcément en métropole … ?
Micheline - Comment ça,
c'est-à-dire ?
Anthropologue - ben les
collègues de secteur par exemple, qui en parlent, comme vous me disiez.
Micheline - Non. Non. Non non non non non, y’a pas, y’a pas, en fait, je les ai pas entendu dire « oh ben dans les familles réunionnaises … ». (…) Ou, il y en a aussi, il y a des situations aussi, quand je pense euh, les maorais, les antillais et tout, qui arrivent en métropole, et du coup qui parlent de ce qui s’est passé dans leur pays.
Remarquons que ma dernière question n’est même pas audible : alors que je demande à Micheline si en métropole aussi, ses collègues de secteur parlent souvent entre elles de situations d’abus sexuels incestueux, elle comprend que je lui demande si elles parlent souvent entre elles d’abus dans les familles réunionnaises présentes en métropole.
Ce phénomène de visibilisation plus facile de l’inceste
chez « les autres » se retrouve y compris, bien sûr, parmi les
sociologues et anthropologues : par exemple, dans l’ouvrage de Maryse Jaspard qui exploite l’enquête ENVEFF (sur les
violences faites aux femmes), la seule allusion aux abus sexuels intra
familiaux se trouve ici : « Selon un mode d’interrogation particulier
à base de dessins, utilisé dans les enquêtes de la zone pacifique, il a pu être
estimé que 15% des femmes [kanak] avaient été victimes d’inceste avant 15
ans. » (Jaspard, 2005, p 60-61). En revanche, pour la métropole,
aucun chiffre n’est donné, alors même que des questions posées dans l’enquête
l’auraient permis.
Mais « loin », cela peut aussi être à la télé … ou dans les livres.
Francine, enseignante
en lycée professionnel – Quand on le sait de façon livresque, on le lit dans
les statistiques, ou dans des bouquins de sociologie ou de psycho, quand on est
face à un humain qui explique ça (…) je me suis dit après la discussion avec
lui que c’était le, connaître les cas personnellement, c’était quand même
beaucoup plus dur que de les voir dans les journaux. Parce que même si on sait
qu’une partie de l’humanité se comporte de façon peu humaine, euh, c’est, c’est
quelque chose qui est, qui est de l’ordre du choc, le fait d’y être confronté.
Parce que quand c’est livresque et quand c’est vécu, même si c’était pas un
élève que je connaissais depuis longtemps …
L’anthropologue - Dans
les livres, c’est un peu loin en fait ?
Francine - Hein ?
Anthropologue - Dans
les livres, c’est un peu loin, c’est … ?
Francine - C’est loin,
c’est un peu irréel, donc là tout d’un coup, ça devient … quelque chose de
réel. Par la suite, je me suis souvent dit, je crois n’avoir jamais refait le
texte de Bettelheim, ça c’est pas très courageux.
Francine me permet de repenser aux renvois, récurrents, qui m’étaient faits en direction des témoignages livresques, lors de mon mémoire de master 1, lorsque je souhaitais avoir des entretiens avec des incesté/e/s « en chair et en os ». Et comment comprendre, également, à la lumière des propos de Francine, ce que constate Dorothée Dussy concernant les anthropologues et l’inceste ?
Prenant pour exemples des ouvrages classiques et majeurs de la discipline sur le sujet, elle s’intéresse par exemple à Les deux sœurs et leur mère, de Françoise Héritier, et relève alors : « Ce qu’il est utile ici de souligner, c’est qu’à l’exception de deux, tous les cas d’inceste relevés et décortiqués dans Les deux sœurs et leur mère sont fictifs, soit qu’ils relèvent de constructions théoriques, soit qu’ils soient des créations littéraires » (Dussy, 2004, p 7).
Enfin, voire un abuseur « en chair et en os » s’avère une épreuve à laquelle je n’avais pas pensé. Mais mes interlocuteurs/trices m’y conduisent.
Francis, éducateur en
service enfance - J'avais un papa, un papa qui avait fait des attouchements sur
sa fille. La première fois que je l'avais vu, c'était au tribunal, c’était dans
le cadre du renouvellement du placement.
Et, euh, ben
voilà, entre ce qu'on entend, ce qu'on
lit, ce qu'on perçoit dans les média, et voir quelqu'un qui est identifié comme
tel : "abuseur". Eh ben, faut prendre sur soi quand même hein.
A cet instant de l’entretien, pendant qu’il me parlait ainsi, j’ai réalisé que pour moi, voir un abuseur était d’une banalité quotidienne, et pour cause. Donc jamais je n’aurais pensé, si Francis ne me l’avait dit, que cela pouvait faire un tel choc. Pourtant, c’est bien sur le registre du choc que se passe la proximité avec l’agresseur, pour les incesté/e/s également. Et du choc quotidien, qui laisse des marques ensuite, mais n’est même plus pensé comme choc par les principales intéressées : Danielle est malade à la simple idée de remettre les pieds dans la ville de son agresseur, Lydia fait des cauchemars durant lesquels il salit de son regard l’enfant dont elle est enceinte. Aurélie me raconte que si toute la fratrie s’est confiée au petit frère en lui demandant de ne rien répéter, alors qu’ils/elles sont adultes, c’est parce que tou/te/s avaient peur que le grand frère abuseur sache que cela s’était dit. Enfin, le père incesteur d’Agnès et le plus marquant pour Paulette de ses abuseurs sont, tout simplement, décédés. Mais Paulette n’aime pas les villages, qu’elle nomme « ce magma », où elle a été abusée …
Enfin, l’abus sexuel incestueux, cela peut devenir encore plus proche que par la rencontre dans un tribunal : deux de mes interlocutrices me relatent avoir eu affaire à cela dans leur entourage personnel. En l’occurrence, à chaque fois, l’incesteur était un ami à elles. Il s’agit de Francine, enseignante en lycée professionnel, et de Laurence, assistante sociale en planning familial[42]. Pour cette dernière, je me suis d’ailleurs demandé si cette expérience n’entrait pas pour beaucoup dans son choix de répondre à ma demande d’entretien, tant, durant cet entretien, elle y revenait tout le temps, là où d’autres interlocutrices fuyaient plutôt vers les abus extra-familiaux et les maltraitances non sexuelles …
Laissons, pour commencer, la parole à Francine, qui relate ce qui lui est arrivé quelques temps après sa rencontre avec l’élève incesté.
Francine - Bon,
par la suite, j’ai juste eu le cas d’une amie, qui vit, bon, assez loin
maintenant, (…) que je vois peu, et mais qui me donne des nouvelles de temps en
temps de ses enfants. Elle s’est mariée plusieurs fois, et qui, euh, me donnant
des nouvelles, si on peut dire, de son ancien mari, que j’ai très bien connu,
m’a dit qu’il avait donc pris dix ans de prison (…), puisque, après sa
séparation (elle avait eu une fille avec lui, il a eu une autre fille très
rapidement avec une autre femme). Et que des années après, plus tard, cette
deuxième fille a porté plainte euh, donc, euh, pour inceste, et … que le procès
avait été très éprouvant mon amie était revenue, puisque sa fille voulait aider
sa demi-sœur dans cette épreuve.
Ici, l’ami a été quasiment perdu de vue. Il est devenu lointain : ce n’est pas un ami contemporain, toujours assidûment fréquenté. Contrairement au cas de Laurence.
Laurence - Et puis
j’y ai été confrontée moi par le biais d’une, d’une amie, donc là ça a été un
peu plus compliqué. Un ami à moi hein.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Laurence – Ca, ça a été
chaud . (…) Un ami, le papa, euh, qui a tripoté sa fille pendant euh,
pendant trois ans, quatre ans. Et on l’a su ça euh, trois ans en arrière. (…)
Là c’est chaud, là. (…) Enfin ça c’est pas professionnel, donc. Mais c’est,
c’est compliqué. Je voulais vous le signaler, surtout quand c’est des gens
qu’on connaît, et puis vraiment, on a fait des, on s’invitait … ce qui est
compliqué, c’est de, pffff, je sais pas comment vous expliquer ça.
Ce qui est compliqué à m’expliquer, c’est qu’à la différence de Francine qui, heureusement, avait presque perdu de vue l’incesteur, le fait que cet ami soit toujours un proche induit la nécessité, dramatique, de faire des choix. Laurence poursuit immédiatement :
Laurence - De toute
façon on fait des choix. C’est dramatique mais on fait des choix. Et on, qu’on
le veuille ou non, on prend fait et cause pour la victime. Hein, c’est ce que
j’ai fait, mon mari c’est ce qu’il a [inaudible]. Euh, ma copine, donc la maman
en question, elle elle s’est séparée du papa. Donc ça vous fout en l’air
toute la famille. Et, surtout, euh. Je l’ai envoyé voir un thérapeute, encore
ça ça va, (…) mais il n’a toujours pas compris.
Anthropologue – Euh,
qui il ?
Laurence - Il a pas, il
pense pas que c’est grave, ce qu’il a fait (…) et ça quelque part, euh,
je, il me dit « ouais mais je l’ai fait une ou deux fois ». Je lui
dis « j’en ai rien à foutre, (…) les mains tu, tu, tu les laisses dans tes
poches » (…). Et ça, ça, il a pas pu évaluer. C’est compliqué, ça, c’est
très très compliqué. Quand c’est, c’est un ami, c’est ...
Les choix mettent cependant quelques temps à se faire : Laurence nous dit l’avoir d’abord envoyé voir un thérapeute, et puis ajoute, le terme d’usage professionnel « le papa » désignant bien ici son ex-ami
Laurence - Et là, moi
au début, il me téléphonait, le papa, parce bon, je lui ai dit « je te
laisserai pas tomber », mais, heu, en tant qu’assistante sociale.
Cette étape préalable à la prise de parti claire en faveur de l’incestée et au détriment de l’ex-ami est-elle devenue difficile à dire au point de devoir se réfugier ainsi derrière son statut professionnel, qui n’a pourtant rien à voir dans l’affaire ? Elle montre en tout cas la difficulté à se résigner à ce que l’incesteur soit, décidément, infréquentable car n’éprouvant ni l’ombre d’un remord, ni l’ombre d’un sentiment de culpabilité, puisqu’il a juste, dit-il, « un peu » tripoté sa fille. Toutefois, encore aujourd’hui, Laurence oscille entre le souhait que l’incestée porte plainte, et l’idée que non, quand même, la police le garderait en garde à vue, mais ne l’enverrait pas en prison …
Laurence - Je pense que
même pour, pour le papa, c’aurait été bien au moins qu’il aille euh, être
confronté aux flics. Je pense pas qu’ils lui auraient fait quelque chose
[inaudible].
L’anthropologue –
Qu’ils lui auraient fait quelque chose ?
Laurence – Oh ils
l’auraient pas mis en taule, je pense pas.
Idée qui alterne chez elle avec le sentiment que lui, finalement, ou les abuseurs de façon plus générale, auraient été prêt à y aller, en « taule ». Idée qui montre l’ambivalence, persistante, du positionnement dans ce cas.
Laurence, assistante
sociale en planning familial - Et ce qui m’a le plus troublé, enfin, nous a
troublées, ma collègue, c’est que le, le père, ce monsieur, [inaudible] a
demandé à nous voir.
L’anthropologue – Ah
ouais ?
Laurence – Alors il y
avait donc, toujours la fille en question, la femme, et le mari.
[inaudible : « je lui ai fait un bon sermon » ?]. Ah mais
avec ma collègue on a cru qu’on virait. Et on s’est retrouvées, donc, face à un
agresseur.
Anthropologue – Hmmhmm.
Laurence – Mais alors,
on lui aurait donné [inaudible] le bon dieu sans confession, hein, et
simplement, vous savez pas ce qu’il nous a dit ?
Anthropologue – Non.
Laurence –
« Merci ». Merci beaucoup, peut-être de, de l’avoir arrêté quoi. De
lui avoir mis une limite dans l’acte. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pendant ce temps, Francine nous explique un peu plus qui a été son ami, pour elle, dans le passé.
Francine - Et là
ça m’a aussi ouvert les yeux sur ce problème de l’inceste, parce que, là,
c’était un copain de fac, quelqu’un avec qui j’ai passé beaucoup d’heures à
militer, plaisanté, ri, rencontré très souvent quand il vivait euh, avec elle,
donc avec sa première femme. Il était, bon, au niveau des mœurs, c’est vrai que
c’était, en plus c’était un séducteur, il avait beaucoup de conquêtes, il était
très recherché par les femmes. Et jamais, jamais, jamais, il me serait venu à
l’esprit qu’un gars comme ça si cultivé entre guillemets, qui d’autre part
avait beaucoup de conquêtes féminines, et puis beaucoup d’occasions qui se
présentaient, était à même de s’en prendre à sa propre fille.
J’aurais peut-être pu
me dire que s’il avait autant de libido, il avait un problème, mais je m’étais
jamais posé les questions dans ce sens. Et c’est là qu’après j’ai fini par me
dire que c’était vraiment vrai ce que j’ai lu je sais pas où, c’est que le
degré de, comment dire, de culture d’un individu, il a pas forcément à voir
avec son degré d’humanité, quoi (…) comme on l’a vu avec les nazis qui
pouvaient apprécier beaucoup la musique classique et, et l’art moderne.
Est-ce l’éloignement, dans l’espace et dans le temps, de cette relation, qui lui permet cette prise de position plus tranchée ? Elle n’a en tout cas pas à faire le choix actif de rompre une relation, puisque déjà auparavant, elle n’avait de ses nouvelles que par intermédiaire. Elle me précise, de plus (au cas où je l’aurais oublié de sa part) être d’habitude plutôt contre la prison et le « sécuritaire », mais que là, les dix ans de prison, ma foi, semblent adéquats à la situation.
Le malaise qui filtre néanmoins, sur le thème « je n’aurais jamais cru, un homme si cultivé », cultivé comme elle, se retrouve exprimé plus clairement encore par Laurence.
Laurence - Je sais pas,
ça me met, très très mal à l’aise, ces histoires. (…) Ca me fait pas la même
chose que, ces histoires de viols. Pourtant c’est hard, hein, les viols.
(…)
Donc là, qu’est-ce qui
se met, dans ces histoires-là ? C’est « j’ai pas pu protéger mon
enfant, j’ai honte, j’ai rien vu », et puis la déception de, que son
conjoint ait une double vie.
L’anthropologue
– Une double vie ?
Laurence – Ben, euh,
dans le cas de ma copine, (…) alors je sais pas, vous partagez la vie avec
quelqu’un, vous … Vous allez pas mettre, vous mettez pas une balise argos hein.
Vous lui faites confiance.
Anthropologue - Oui.
Laurence - Bon eh ben
au niveau de la perte de confiance, c’est inimaginable. J’appelle ça une double
vie
Francine m’explique de son côté le déroulement du procès : l’ex-femme de l’incesteur et sa fille étaient revenues exprès du pays où elles s’étaient installées, car elles ne voulaient pas y laisser la demi-sœur, l’incestée, seule. Francine me relate le caractère éprouvant, pour elles toutes, de ce procès, qui a fait dire à cette amie qu’elle avait eu raison d’y venir soutenir l’incestée moralement.
Francine - elle avait
toujours gardé des liens même si son mari était parti avec une autre femme et
avait eu cette fille [ : la demi-sœur]. Les demi-sœurs étaient toujours
restées un peu en contact. (…)
Puis c’est dur aussi
dans la mesure où j’imagine quand on a vécu avec quelqu’un, on a eu un enfant
avec … voir ce qu’il a pu être capable de faire … par contre ça ne s’était pas
produit avec sa, sa première fille, mais, enfin quand ils s’étaient séparés
elle était assez petite.
Laurence imagine cette situation d’un peu plus près encore …
Laurence – De toute
façon ces histoires, ça se passe comme ça, personne ne voit rien.
L’anthropologue –
Hmmhmm. Par rapport à la question du secret, aussi.
Laurence – Du secret,
ouais.
Anthropologue - … ce
que vous me disiez sur la double vie euh … ?
Laurence - Ah moi
personnellement, il me fait un coup comme ça mon mari il calte hein. Et c’est
même pas en rêve.
C’est ainsi que les actes,
insoupçonnés, de l’ami, créent pour elle le soupçon sur son propre mari :
qui sait s’il n’en fait pas partie, lui aussi, de manière invisible,
indiscernable ?
Philippe Liotard, dans un article sur l’étranger vu par la science fiction, évoque notre imaginaire du mal : le mal y vient d’extraterrestres, d’aliens, qui veulent nous envahir et détruire l’humanité. La monstruosité (synonyme d’hostilité) de ces extraterrestres est, dans un certain nombre de cas, visible : ils ressemblent à des cosses de haricots géantes, à des reptiles, à des bonshommes verts … bref, pas à nous. Dans ces cas-là, « Au fond, qu’ils soient vraiment différents rassure. Ils peuvent faire peur, être monstrueux, rusés, s’avancer silencieusement ou se tapir dans l’ombre, dès qu’ils sont repérés, ils sont identifiés comme étrangers. » (Liotard, 2000, p 65). En effet, « Repérables immédiatement, les petits hommes verts, petits-gris et autres aliens, peuvent aisément être désignés comme ennemis à abattre dans le cadre d’un affrontement classique. Il en va bien autrement avec des envahisseurs à forme humaine qui cachent leur altérité. On sait (ou on croit savoir ou quelques initiés savent) qu’ils sont là, mais on ne les reconnaît pas. » (Liotard, 2000, p 66). Comme c’est le cas, par exemple, pour David Vincent dans la série bien connue Les envahisseurs. Mais ici, il existe encore un indice : le petit doigt, différent chez eux. « Parfois, pourtant, il n’existe rien de tangible pour repérer l’autre, si ce n’est l’intuition. (…) Cette capacité [l’intuition] permet de répondre à la volonté de repérer l’autre à tout prix. Car combattre un ennemi que l’on ne voit pas constitue une situation hautement anxiogène. » (Liotard, 2000, p 67).
Et c’est exactement la situation dans laquelle se retrouvent Francine et Laurence
Francine, enseignante
en lycée professionnel - c’est vrai que pour beaucoup de personnes, c’est
quelque chose qui se passe loin, qu’on voit dans les journaux, entendu parler à
la télé. Mais, euh … c’est pas, c’est des gens bizarres, qui vont pas bien, ou
des familles à problèmes, et puis quand on s’aperçoit que c’est dans une
famille où il y a pas de … [inaudible] niveau d’études, niveau de revenus
financiers, ça n’a rien à voir. Et, on n’arrive pas à s’enlever quand même
cette chose là de la tête : « un monsieur si gentil ».
L’anthropologue -
Ouais. Un ami de fac …
Francine - Oui … Oui.
Ben, j’avais bien trouvé qu’il avait beaucoup de libido, qu’il était vraiment
un peu, mais bon, c’était après les années 68, donc il y avait une de ces
grandes libertés. (…)
Moi – (rire :
) il dort toujours [le chat, derrière
elle, sur le canapé, malgré les secousses]
Francine - … ouais, je
fais le rapprochement avec les nazis, mais finalement, euh, quand je me suis sentie mal auprès de lui,
j’ai vraiment eu cette sensation, qu’on pouvait tuer des gens physiquement,
comme les nazis, donc être cultivés comme certains, hein, les nazis ils étaient
très cultivés, hein (…). Mais qu’on pouvait aussi tuer ou, ou risquer de tuer
psychiquement quelqu’un. Je crois que c’est ça qui m’a … c’est dur. Parce qu’il
faut arriver à intégrer que, bien sûr, pour des histoires qui leur sont propres
de leur enfance, ou propres maltraitances sur eux, mais que finalement ça
change rien : comment est-ce qu’un être humain peut faire ça ?
Le fait que le mal soit apporté et commis par des personnes indiscernables des humains provoque, continue Liotard, la suspicion généralisée. Par exemple, dans le roman Les maîtres du monde, où des larves colonisent des corps humains qu’elles transforment en leurs marionnettes, « Chaque corps devient suspect. Dans le roman, un parasite s’est échappé. Les membres de la réunion appartiennent aux services secrets, et sont au-dessus de tout soupçon. Pourtant : « L’un d’entre nous, bien qu’il ait gardé son apparence humaine, n’est plus qu’un automate qui agit suivant le bon plaisir de notre plus redoutable ennemi » proclame le Patron. Cette annonce crée la suspicion de chacun contre tous. « Quelques secondes plus tôt nous formions une équipe ; nous n’étions plus maintenant qu’une foule où chacun se méfiait de tout le monde. » (Liotard, 2000, p 69). Ainsi, les incesteurs (et également les autres pédophiles), qui ne sont pas les marionnettes de larves extraterrestres, mais simplement d’eux-mêmes, une fois leur existence reconnue, génèrent une dislocation du lien social. Combien de fois l’ai-je entendu dans la bouche des professionnelles(els) interviewées(és) « ça vous fout en l’air une famille », « ça fait exploser la famille », « ça a été l’horreur dans la famille » ? Uniquement dans la famille, vraiment ?
Ainsi, leur crime n’est pas uniquement dirigé contre leurs victimes, mais porte également gravement atteinte à la société humaine, au tissu des liens sociaux, y compris les plus intimes comme le relatait Laurence.
Francine continue …
Francine - C’est assez
désagréable de, de, d’arriver à intégrer, de vivre dans une société où …
j’ai rencontré des femmes qui ont subi des violences, après, (…) de leur mari
ou autre, qui ont le même type de réflexes que moi parfois face à une classe,
c'est-à-dire « sur les 24 ou 30, il y en a bien un ou deux qui a du subir
cette situation » (…). Et elles elles me disent que c’est dans les espaces
clos justement, comme le métro, où elles se disent très souvent « il y en
a combien, d’hommes violents ? ». (…)
Donc on a un certain
moment où ça nous fait un basculement dans notre vie, on n’est pas forcément
pour l’angélisme, pour penser que tout le monde est beau et gentil, mais tout
d’un coup les menaces sont plus proches, quand ça touche un problème familial
comme l’inceste, que ça soit un inceste direct ou les violences conjugales.
C’est de, l’univers est beaucoup plus menaçant.
L’anthropologue - Très
proches : juste à côté
Francine - Ouais.
Ouais. C’est, c’est perturbant un peu. Mais après, bon, je pense qu’une fois
qu’après qu’on a intériorisé ça, ça donne d’abord euh, comme on croit toujours
que c’est loin, on se croit un peu préservé dans notre vie et dans nos
relations à nos proches, mais, bon, peut-être qu’après on l’intègre. Mais il y
a une phase où moi j’ai trouvé ça désagréable, de constater que il pouvait y
avoir des gens euh, ou qui détruisent physiquement, ou qui sont capables de, de,
par leur comportement de détruire en partie ou de risquer d’entraver le
développement d’un, d’un jeune.
Et non, ce n’est pas marqué
sur leur figure. C’est ainsi que je comprends, par ces descriptions de ce
nouveau monde, de suspicion, de méfiance, où Francine et Laurence sont tombées,
et qui est la description du monde dans lequel je suis moi depuis toujours, ce
qu’est le monde des personnes qui n’ont pas vécu cela. Un monde où l’on
n’imagine pas sans cesse que derrière tout homme, mais lequel, se cache
peut-être un abuseur odieux comme papa, tonton, frangin … ou même maman. Un
monde où l’on ne pense même pas à ça !
C’est ainsi que les abus
sexuels incestueux, finalement, créent, par cette suspicion généralisée
induite, pour les victimes et les proches, une rupture du tissu des liens
sociaux confiants. Et c’est sans doute là un mal aussi grand que les abus
eux-mêmes : rendre le monde humain ainsi invivable par l'omniprésence du
soupçon.
La réaction de fuite de
Francine, et non d’intégration de cette réalité, est à re-situer dans ce
cadre-là (rappelons-nous qu’elle n’a pas réutilisé le texte de Bettelheim).
En outre, la
tension peut être encore accrue quand il n’y a pas eu de reconnaissance
officielle du crime commis, comme le raconte Laurence :
L’anthropologue – Donc
euh, il avait abusé de Mathilde ?
Laurence – Quand elle
était petite. Elle, et toutes les cousines. Je vous dis pas, ma copine, elle
était, elle était morte. C’est fou hein. (…)
Elle [Mathilde], elle a
voulu le, que la famille, sa famille à elle le sache, (…) mais elle en n’a pas
reparlé avec ses cousines, voyez, et elle ne veut pas porter plainte. (…) Donc
maintenant on est sur un truc totalement suspendu, donc elle a bien, comme je
dis, elle a bien, elle a bien foutu … elle a fait exploser la chose, mais, la
maman donc a changé d’appartement. Elle, Mathilde (…), elle s’est séparée de
son mec, elle est en errance, elle est mal dans sa peau … et qu’est-ce qu’on
fait de tout ça ?
En effet, qu’est-ce qu’on fait de tout ça ?
Je constate simplement, pendant que Mathilde, comme moi, ou encore Laurence, fait comme elle peut avec « ça », que je retrouve là les mêmes dynamiques que lorsque l’inceste est rencontré dans un cadre professionnel, mais en encore plus éprouvant et angoissant. Car ici, la trahison de confiance vient d’un proche, d’un ami.
Et ceci nous mène aux premières personnes à avoir vécu le choc de cette trahison : les incesté/e/s eux/elles-mêmes.
Liotard nous a donné la piste des différences corporelles, comme marqueurs couramment utilisés, dans la société française notamment, pour identifier l’être hostile. Aurélie y ajoute d’autres pistes, lorsque sa fille, enceinte, va se faire tirer les cartes et lui annonce, donc, que selon ce tirage de cartes, Aurélie va avoir un petit garçon comme petit-enfant …
Aurélie – Ca a été une
annonce euh, terrible. Mais pas dans le bon sens du terme hein, dans le mauvais
sens.
Moi – Ouais.
A – J’ai commencé à
pleurer et à me sentir angoissée euh …
M – Ca allait être
euh ?
A – Ca allait être un
grand frère.
M – Hmm.
A – Parce que je me
fiais à ce qu’on lui avait dit, tu vois.
M – Ouais.
A – [Inaudible] c’est
pas possible, euh, bon, ‘fin, ‘fin il allait être euh, lion, ben, comme mon
ex-mari, et … il était juste pas noir.
M – (rires) « lion
comme ton ex-mari et, juste pas noir » : ton ex-mari était pas
noir ?
A – Non. Ah ben non,
parce que là …
[rires]
Ainsi, les craintes, réelles, viscérales et incontrôlables d’Aurélie, se focalisent sur ceux qui ressemblent à son incesteur (et à son ex-mari, violent et destructeur vis-à-vis d’elle). Que ce soit corporellement (« noir »), ou par le signe astrologique, ou encore par la position généalogique (« grand-frère »). C'est-à-dire pas du tout sur des étranger/e/s ou des extraterrestres.
Pour Lydia, qui au collège était surnommée « la castreuse », la focalisation s’est faite sur un groupe social plus vaste.
Moi - On allait te
violer parce que ? ‘Fin y’avait une raison ?
Lydia - Non. Peut être,
peut être parce que j’étais bonne qu’à être violée, peut-être qu’à ce qu’on
m’utilise, à ce que euh … je saurais pas dire, mais j’ai toujours eu ce
sentiment. Là maintenant, c’est vrai que, je m’en rappelle là, mais ça fait
quand même quelques mois que j’y ai pas repensé à ça.
(…) le fait que d’être
avec [un conjoint gentil et respectueux] maintenant ben c’est un peu passé
quand même
M-Hmmhmm
L-mais euh, c’est vrai
que j’ai quand même pas mal changé depuis que je suis avec lui, mais euh …
Parce que pendant des années, (…) les hommes pour moi c’était de la merde.
M-Hmm.
L-C’est, je haïssais
les hommes, les hommes c’était bon qu’à, c’étaient que, que des violeurs euh
éventuels hein euh, et donc pendant des années, j’ai crié ma haine alors que
Martin, en fait sans le savoir, c’est lui aussi que j’agressais. Alors que lui
c’est un homme merveilleux,
M-Euh, Martin, c’est
le, ton ?
L-Le gendre de ma
marraine. (…) Lui c’est un homme merveilleux, que, ben que j’adore hein (…),
mais heu, sans, sans me rendre compte que quand je criais ma haine des hommes,
(…) à chaque fois je me rendais pas compte que lui il en prenait pour son grade
aussi malheureusement, parce que lui aussi c’était un homme.
M-Hmm. Oui oui.
L-Et, bon ben, bon ben,
et maintenant, il rigole. Alors, alors quand il voit [mon conjoint],
[inaudible], qu’il me voit collée contre lui : « alors rappelle-moi,
c’est quoi les hommes ? C’est quoi ? C’est de la merde ? »
M-(rire)
Danielle a beaucoup de mal à trouver ses mots pour me décrire sa peur, qui est plus étendue encore, puisqu’elle concerne une situation d’interlocution, et non simplement des catégories de personnes « marquées » comme agresseurs potentiels.
Danielle – sur, ma
façon de, de, de, d’avoir peur de, de, d’un quelconque contact avec qui que ce
soit, euh, de, de très mal gérer le, le, la discussion euh justement avec une
seule personne
M – Hmmhmm.
D – de … de, de fffh,
de ne pas gérer du tout … les rapports de séduction, je, je les fuis euh
M – Hmmhmm
D – Et voilà, et c’est
ça, je les fuis, et à la fois je les recherche, c’est, c’est, y’a, y’a un truc
qui me, et donc ce genre de choses, que, je réfléchis, euh, justement, sur
lesquelles je me dis ben, ça doit être lié à ça parce que euh, euh, parce que,
parce que du coup le, le contact est devenu quelque chose de, de, ‘fin, le
contact et la discussion sont devenus quelque chose que, que, qui implique
forcément euh, ‘fin euh, (silence) euh, (silence) que l’autre cherche quelque
chose en fait. (…)
M – Quand tu dis
« quelque chose », ça serait … ?
D – Fffhou … Ca serait,
ben, ben, euh, (long silence). Ce serait … heu que … fffhou, ce serait qu’on
cherche à, à me séduire pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir des relations
sexuelles [inaudible] avec moi en fait. C’est, c’est systématiquement ce que,
ce que … ce dont j’ai peur et je sais très bien que c’est pas le cas, je sais
très bien que, que, la plupart des gens, ce … c’est pas du tout le cas en fait,
c’est, c’est, juste ils font ça, voilà en fait quoi, enfin je veux dire euh, on
va pouvoir mettre la main sur l’épaule à quelqu’un sans que ce soit euh, ‘fin
je sais pas.
M – Et … hommes comme
femmes ?
D – Ouais.
M – Ouais.
D – Ouais. Euh … voire même depuis quelques temps je suis plus intimidée par les femmes que par les hommes. [C’est autour de la période où elle sort avec des femmes]
A travers ces trois exemples, nous pouvons constater que les incesté/e/s vivent dans un monde où le danger n’est pas projeté au loin, sur des groupes inférieurs socialement et/ou géographiquement, mais ramené au plus près, contrairement aux catégorisations dominantes chez les professionnelles(els) interviewées(és).
Alors que chez les professionnelles(els), il est possible d’identifier assez clairement trois directions existantes où sont comme projetés, de façon défensive, les incestes (toujours « loin »), chez les incestées, ce n’est pas le cas.
Dans l’imaginaire des professionnel/le/s rencontré/e/s, l’inceste se situe : dans les campagnes et les montagnes, dans les DOM-TOM, chez des gens pas trop cultivés.
Dans l’imaginaire des incestées, la diversité semble plus grande, commandée avant tout par les caractéristiques de l’incesteur ou des incesteurs, et aussi, pour Danielle, par le fait que les menaces sexuelles peuvent provenir également des femmes peut-être du fait qu’elle a eu des relations (désirées celles-là) aussi bien avec des femmes qu’avec des hommes. Néanmoins, pour elles, le danger est toujours situé près, et les vise ou visera des proches auxquels elles tiennent.
Il y a donc bien, dans ce dernier cas, intégration du fait qu’il peut exister, dans son environnement proche, des êtres doubles. Tout comme c’était le cas pour les enfants ayant subi ou été témoins d’actes de torture, dont nous parle Sironi : « Aux yeux de l'enfant [en question], tout adulte est potentiellement un être clivé, quelqu'un qui, à tout moment, peut devenir un assassin, un massacreur, un violeur, un tortionnaire. Ces enfants ont tôt appris qu'en psychologie humaine, une chose et son contraire peuvent co-exister. Expliciter avec lui l'intention des systèmes tortionnaires, par l'intermédiaire des jeux interactifs avec l'enfant par exemple, va permettre de remettre le monde à l'endroit. Il faut aussi dire à l'enfant qu'il pourra encore rencontrer des êtres doubles. (…) Nous devons nous placer à leur niveau de maturation, en les "réparant" à l'endroit même de leur blessure : avoir eu accès trop tôt à la face sombre de l'humain. » (Sironi, « Les enfants victimes de tortures et leurs bourreaux », texte disponible sur internet). Certainement, des nuances pourraient être trouvées dans ces situations aussi : peut-être, ce sont certains adultes plus que d’autres, en fonction par exemple de ressemblances (physiques, sociales …) avec le(s) tortionnaire(s), qui seront perçu/e/s comme potentiellement dangereux.
Ainsi, une transformation de l’enfant victime a été effectuée par l’agression. Une transformation de sa vision des autres. Viñar ajoute alors que le trauma induit par la torture ou d’autres actes monstrueux intentionnels est, précisément, bien spécifique, et se distingue également de celui induit par une catastrophe naturelle, aussi effroyable soit-elle : alors que la catastrophe naturelle, tout comme l’expérience de la maladie, promeut normalement la solidarité, celle causée par un autre humain induit un cercle de haine et de rancœur sans fin. Comme c’est le cas pour Lydia vis-à-vis de l’ensemble des hommes, d’Aurélie vis-à-vis des « noirs », « lions », « grands frères » potentiels, ou de Danielle vis-à-vis de l’ensemble des humains, qu’elle a en outre envie de frapper ou de rejeter avec répulsion, à chaque fois qu’elle a eu quelques mois de relations sexuelles avec ...
Ce cercle infernal
s’explique, nous dit Viñar, par le fait que l’autre destructeur, contrairement
à la catastrophe naturelle ou à la maladie, s’attaque à un pilier de
l’humanisation : celui de l’identification de soi à l’humain, effectuée à
travers le visage accueillant du parent alors qu’il soutient la fragilité de la
dépendance originelle du bébé humain. Il développe : « C’est ce pilier
fondamental qui se craquelle ou s’effondre dans l’expérience de la torture et
du camp de concentration, où l’autre démissionne de sa condition de semblable
et se transforme en monstre souriant qui se délecte de l’anéantissement de la
victime. » (Viñar, 2005, p 1212). Le monstre souriant qui se délecte
de l’anéantissement de sa victime est également une image familière aux
incestées : comme le dit Lydia, les hommes (c'est-à-dire « les gens
comme lui ») sont tous des violeurs potentiels. Mais également, et c’est tellement
logique, elle n’est « bonne qu’à ça », qu’à être violée : Viñar
ajoute alors qu’ainsi, se crée un noyau traumatique d’une redoutable
spécificité, puisqu’il disloque l’appartenance à l’humanité, transforme sa
victime, en un « déchet », un « morceau », aux yeux du/de
la tortionnaire (ou de l’incesteur) et parfois aux yeux de la victime
elle-même.
Viñar effectue alors,
immédiatement, une critique très dure de la médicalisation et de la
victimologie, qui, pensant (et prônant) la torture comme maladie du/de la
torturé/e, « séparent et aliènent [ainsi] le torturé de sa condition de
citoyen, de sa condition de semblable et d’alter ego » (Viñar,
2007, p 51), une nouvelle fois et d’une autre manière. De même, peut-on
« guérir » de l’inceste, comme cela se dit et s’écrit parfois ?
Il explique alors qu’il
n’existe pas de description objective, puisque décrire/percevoir, c’est en fait
déjà interpréter, d’où l’importance de la manière dont on nomme les faits,
puisqu’elle « étaye la façon de voir les choses et organise la nature des
faits ainsi que les objectifs du processus thérapeutique. » (Viñar, 2007,
p 56).
Par exemple, la
« névrose traumatique », ou encore la « névrose de
guerre », désignent bien une névrose, même si « traumatique »
ajoute qu’elle vient de l’extérieur, du social violent (ou, j’ajoute, du social
violent via un familier violent), et non de nos conflits psychiques
internes.
Cette terminologie,
poursuit-il, ou celle, plus récente, de Post Traumatic Syndrom Disorder (PTSD),
se veut description objective et objectivante du réel. Mais en réalité, elle
organise ce réel d’une manière plaisante : il y a des malades, qui
souffrent, et des thérapeutes bien intentionné/e/s, indemnes de cette maladie,
qui sont là pour les aider.
Cette césure est fantoche,
pour Viñar. Il l’analyse comme constituant un processus de défense qui nous
évite l’idée, pénible, que la société entière est en réalité impliquée et
concernée. Comme nous avons pu le constater pour l’inceste, les incesteurs
n’étant pas seulement des pères, oncles, frères, mères, mais également des
ami/e/s, des médecins de la sécurité sociale ou autres personnes
« cultivées comme soi ». Voire des collègues. Or l’impact de
l’inceste n’est jamais pensé « hors de la famille » : c’est la
famille, que sa révélation fait éclater, exploser. C’est la famille, qui est
« incestueuse » comme le relate la littérature sur le sujet (voir par
exemple Nisse-Gruyer-Sabourin, 2004, p 81 et suivantes). Ou encore
« incestuelle » (Racamier, 1995). La famille se voit ainsi isolée,
dans les analyses, du reste du social, telle un kyste ou autre tumeur,
indiscernable et, surtout, bien distincte de soi. Viñar me relaie alors pour
ajouter qu’il existe même « une certaine complaisance réciproque entre la
victime et son thérapeute selon laquelle, du fait qu’il y a un indemne, le lieu
de l’indemnité devient le fétiche qui exorcise la possibilité de ce cancer du
lien social. » (Viñar, 2007, p 57).
Kyste, tumeur, cancer :
nous ne quittons pas le domaine de la métaphore médicale, qu’il peut être
intéressant, alors, de filer.
François Laplantine nous
fait remarquer que « Déjà au XVIIe siècle, Thomas Paynell écrivait :
« un cancer est une tumeur causée par une humeur mélancolique qui ronge
les parties du corps ». Et l’Oxford English Dictionnary
précise : « cancer, tout ce qui ronge , corrode, corrompt et consume
lentement et secrètement ». » (Laplantine, 1997, p 92). Oui,
mais voilà : le cancer, précisément, ce sont bien ces cellules déviantes, issues
de soi et qui ont proliféré de façon trop importante, essaimant dans tout
le corps ?
Alors retenons l’idée de
cancer du lien social.
En outre, Laplantine
s’intéresse aux modèles étiologiques de la maladie. Il raisonne,
systématiquement, par couples d’oppositions, ce qui est une des manières
possibles de diviser le réel pour en obtenir une compréhension[43].
Je propose de partir de cette classification-ci.
Il distingue le modèle
ontologique, qu’il oppose au modèle relationnel, de la maladie.
Dans le modèle ontologique,
il existe un « être », une essence de la maladie, « Les
maladies sont [alors] isolables. L’anatomie, au moyen d’observations
instrumentales puis de la dissection, détermine l’endroit exact du mal tout
entier concentré sur un organe, et la chirurgie – pratique localisatrice s’il
en est – est alors en mesure d’opérer. De plus, la cause de la lésion est
souvent appréhendée comme un agent matériel lui-même parfaitement cernable.
Ainsi, la médecine devient-elle objective au sens où elle procède à une objectivation,
et le praticien, qui peut désigner l’adversaire par son nom, est mieux à même
de lui tirer dessus ou de le faire déguerpir. Les représentations
localisatrices rassurent. Il est rassurant en effet de savoir que ce qui ne va
pas, c’est un organe qui est en moi, mais qui n’est pas réellement moi-même. »
(Laplantine, 1997, p 59). Un peu comme une « famille
incestueuse » pourrait être un organe qui est dans notre société, mais ne
fait pas réellement partie de notre société …
S’intéresser au
« fonctionnement inconscient des familles incestueuses », titre d’une
conférence du CRIAVS[44]
Rhône-Alpes en 2010, n’est-ce pas aussi se désintéresser des relations
existantes entre ces familles et le reste de la société ?
Dans son témoignage,
Isabelle Aubry (2008), fondatrice de l’association AIVI[45],
nous apprend dès les premières pages que son père incesteur l’emmenait
régulièrement dehors, dans des « partouzes » où il la
« prêtait » à des dizaines d’hommes, alors qu’elle était adolescente.
Dorothée Dussy fait remarquer que « Dans la mesure où les enfants
impliqués dans la pédopornographie le sont la plupart du temps par un parent,
il est intéressant de jeter un œil au
chiffre d’affaire de l’industrie internationale de pédopornographie. Il atteint
aux Etats-Unis entre deux et trois milliards de dollars américains par an. Plus
d’un million d’images pornographiques impliquant des enfants circulent sur
internet. » (Dussy, 2009, p 135-136).
Et, on pouvait entendre, il
n’y a pas si longtemps que cela, « Au cours des années 1970, le discours
sur ce que l’on commence à appeler la pédophilie [qui] pren[ait] ici et là une
dimension politique (…). Pour beaucoup de nouveaux pédophiles, comme ils
se nomment eux-mêmes, la pédophilie est une culture au sens où elle relève d’un
ars erotica qui, via l’initiation des plus jeunes, romprait avec la
scientia sexualis triomphante depuis le XIXe siècle. » (Ambroise-Rendu,
2008, p 74-75). Ceci, en France métropolitaine, et, on le voit au
vocabulaire, dans des milieux loin de l’inculture …
Toutefois, c’est à la même
époque, durant les années 1970, donc, que Christiane Rochefort, s’inscrivant
dans le mouvement féministe alors renaissant, par son texte « Définition
de l’opprimé » en introduction du SCUM manifesto, retournait à ces
« initiateurs » potentiels que « Il est hors de question que
l’oppresseur aille comprendre de lui-même qu’il opprime, puisque ça ne le fait
pas souffrir : mettez-vous à sa place. Ce n’est pas son chemin. Le lui
expliquer est sans utilité. L’oppresseur n’entend pas ce que dit son opprimé
comme un langage mais comme un bruit. C’est dans la définition de l’oppression.
(…) Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement
différentes. C’est ainsi que de nombreux mots ont pour l’oppresseur une
connotation-jouissance et pour l’opprimé une connotation-souffrance.
[souligné par moi] Ou : divertissement-corvée. Ou : loisir-travail.
Etc. Allez donc causer sur ces bases. » (Rochefort, 1967).
Mais, peut-être pour nous
rassurer, des spécialistes écrivent, plus récemment : « Plutôt que de
faire une typologie des agresseurs, qui risque d’appauvrir leur description
clinique par un classement trop systématique, nous nous bornerons à distinguer
deux types principaux d’abuseurs : les pédophiles, d’une part ; les
pères incestueux « fidèles » à leur famille, d’autre part. Cette
distinction est importante pour l’évaluation des risques de récidive. Dans le
cadre du traitement général des abus sexuels, il est indispensable de savoir
combien d’enfants doivent être protégés, ceux de la famille nucléaire seuls, ou
tous les enfants de l’entourage. » (Gruyer-Nisse-Sabourin, 2004,
p 120). Or, peut-être pour les inquiéter, je me dois de mentionner dans
mon corpus de récits, tant des professionnel/le/s que des incestées
elles-mêmes, l’existence d’abuseurs qui ne dédaignent pas attoucher les
copains-copines de leurs victimes, ou encore, après avoir été démasqué comme
« tonton abuseur » dans leur famille, se faire « adopter »
comme tonton adoptif dans une autre famille, par leur serviabilité … pour quoi
faire ?
Viñar, dans ce (con)texte qui semble un peu décousu, continue son exposé, pour nous dire que parler de la torture, ou des génocides, ce n’est donc pas parler de victimes et de leurs séquelles, mais dénoncer, via leurs témoignages, un ordre de vie en commun qui fonde son existence sur la destruction du semblable. Les actes monstrueux (torture, disparitions, génocides, liste-t-il) ne sont donc pas une maladie de la victime, mais un mal civilisationnel. Et l’utilisation sexuelle d’un/e mineur/e par un/e apparenté/e ?
Une tentative de réponse à
cette dernière question pourrait se trouver dans un dictionnaire de psychologie
réédité tel quel en 2003. A « inceste », nous pouvons lire, après une
évocation du fantasme incestueux des enfants théorisé par Freud, que néanmoins
« l’inceste semble répandu dans tous les milieux. Par ailleurs, certains
auteurs estiment que les conséquences sociales et judiciaires de la divulgation
de l’inceste (…) sont aussi traumatiques que la séduction incestueuse
elle-même. Ces résultats semblent corroborés par une étude comparative
récente : on trouve dans les deux groupes de femmes victimes d’inceste
trois fois plus de troubles de la sexualité (frigidité) que dans le groupe
témoin ; mais les victimes d’inceste ayant dénoncé leur séducteur semblent
plus perturbées psychologiquement, tandis que celles qui ne l’ont pas dénoncé
ne présentent aux tests de personnalité pas plus de traits névrotiques
que les sujets du groupe témoin. » (Doron et Parot, 2003, p 372).
Que doit en conclure le ou
la psychologue en formation ?
Viñar, psychanalyste, et
ex-victime de tortures, conclut pour nous, en rappelant opportunément
« l’affirmation de Ferenczi selon laquelle le plus traumatique n’est pas
le trauma lui-même, mais le démenti du fait traumatique. » (Viñar, 2005, p 1212),
et en questionnant le fait de « superpos[er] la notion de
« guérison » et celle de silence symptomatique » (Viñar, 2005,
p 1214).
Voyons donc maintenant ce qui se passe, lorsque l’on sort du silence des symptômes pour entrer, ou du moins tenter d’entrer, dans le tumulte de la crise.
VI - Le sort de la communication
L’anthropologue - Et
dans, dans la description que, que vous faites, c’est comme si ça tombait du
ciel dans une famille d’un coup … euh ?
Micheline, assistante
sociale scolaire – (Presque chuchoté : ) j’ai souvent eu l’impression,
ouais. (…)
Anthropologue - un truc
complètement surprenant, qui … ?
Micheline – Ben euh,
je, je pense que, que, peut-être de façon sous-jacente, alors y a peut-être des
gens dans la famille qui le savent, des gens dans la famille qui s’en doutent
et tout, mais là c’est le pavé dans la mare, quoi.
Anthropologue - Oui,
c’est, voilà, ça fait cette impression.
Micheline - C’est
exactement … (…) ben oui, c’est ça. Ben oui parce que ça se … ça se sait, de façon
sous-jacente, et puis le fait que, ben y ait quelque chose d’intenté, ou de,
qui commence en fait, ben c’est le pavé dans la mare.
Anthropologue – Euh
quand vous dites ça se sait de façon sous jacente, concrètement, c’est ?
Micheline – Ben
quelques fois on se dit euh, peut-être que les, la maman elle s’en doute, ou il
y a une tante qui le sait, ou y’a une copine de classe qui le sait, ou, voilà,
mais … on sait …
Anthropologue - Mais
comment vous en arrivez à vous dire ça, de votre côté ?
Micheline – Ben souvent
la gamine, je lui dis, mais ta maman elle sait pas ? Ben elle sait pas si
sa maman sait pas, ou elle en a parlé à la maman et la maman l’a pas trop crue.
(…) Personne n’a cru ou personne n’a rien fait, quoi.
Anthropologue - Et euh,
le pavé dans la mare, c’est quand heu, l’extérieur arrive …
Micheline - Quand le
proc’, voilà, ouais.
Anthropologue - … et
les croit, et les croit au moins sur ce qu’ils disent, et déclenchent quelque
chose ?
Micheline - Ben voilà,
ouais.
Toutefois, le chemin jusqu’au « proc’ » s’avère difficile. C’est pourquoi, sur ce parcours, il existe fréquemment des interlocuteurs autres que « le proc’ » ou la police, qui seront tout d’abord contactés par l’incesté/e ou un parent à lui/elle.
Françoise,
assistante sociale polyvalente de secteur - Ben effectivement là on a, on
a été tenus ben, de voir avec la brigade des mineurs (…).
Hélène,
assistante sociale polyvalente de secteur - Alors moi j’ai une situation
similaire, à la toussaint, une mère, enfin une famille qu’on ne connaissait
pas, qui s’est présentée spontanément à la maison du Rhône, que j’ai reçue, et
là donc qui m’annonce que elle venait de découvrir avec son mari que son fils
de 15 ans abusait de leur deuxième fils de 6 ans. Voilà. Donc euh, c’était la
première fois que j’étais confrontée à ce type de situations [elle a 11 ans
d’ancienneté]. Donc, euh, on a, l’après midi donc on a demandé à rencontrer les
deux enfants et le père, mais pour les accompagner à la brigade des mineurs.
Ici, l’interlocutrice sollicitée choisit de se positionner en intermédiaire et accompagnatrice vers le relais qui lui semble le plus approprié dans ce cas : la brigade des mineurs.
Serre
nommait deux générations d’assistantes sociales, se distinguant « Au
niveau des pratiques, [car] les assistantes sociales de la nouvelle génération
semblent avoir une propension plus forte à déléguer et orienter vers d’autres
services. Par exemple, elles vont conseiller aux personnes étrangères sans
titre de séjour de s’adresser à un service spécialisé (…), tandis que les plus
anciennes accompagnent parfois elles-mêmes en préfecture les familles qu’elles
suivent par ailleurs. » (Serre, 2009, p 215-216). Malgré le
rattachement de notre assistante sociale à la nouvelle génération, nous voyons
ici des pratiques typiques de « l’ancienne » génération : rôle
actif en convoquant le reste de la famille et, on peut le supposer en
filigrane, en l’incitant à y aller, à la brigade des mineurs.
Hélène, assistante
sociale polyvalente de secteur - C’étaient les parents, qui faisaient la
démarche, (…) c’est les parents qui avaient découvert la relation incestueuse
entre leurs deux fils.
L’anthropologue -
Hmmhmm. Et leur réflexe a été de venir euh, ici ? D’accord.
Françoise - on a
eu cette chance là, que ce, que les parents aient eu ce bon réflexe : ça
aurait pu être complètement caché aussi, hein.
Hélène - après,
ils auraient pu aussi se présenter directement à la brigade des mineurs.
( …)
Parce que nous, nous n’avons fait que, entre guillemets, les accompagner, à la brigade des mineurs.
(…) On les a revus plusieurs fois par la suite, et le fait que les parents
viennent, donc, déposer ce, donc, ce qu’ils avaient découvert, auprès d’un
service social, et que ils aient ensuite, euh, ils ont été entendus à la
brigade des mineurs, ça a été très mal vécu par le reste de la famille.
Anthropologue - Ah oui,
d’accord. La famille élargie en fait ?
Hélène - les
grands parents. (…) Qui d’après ce couple, considéraient que, ben finalement ça
aurait pu être traité dans la cellule familiale, et qu’y avait pas besoin de
porter à la connaissance de la police. (…) Et du coup ils sont très isolés.
Pourtant, il s’avère que le couple n’a finalement pas porté
plainte contre son enfant agresseur, mais a juste été « entendu » à la
brigade des mineurs. Y auraient-ils été d’eux-mêmes ?
Laurence exprime autrement ce type de scénario et sa conception de son rôle :
Laurence, assistante
sociale en planning familial - Victime donc d’inceste de la part du papa. Et
elle venait me demander, euh, à ce qu’on prévienne les flics parce que
sa petite sœur était victime d’inceste. (…) Là j’avais appelé la brigade des
mineurs : ça avait été vite fait ils avaient été la chercher. (…) Mais là
on était passés par, enfin, la grande sœur était venue déposer ici pourquoi,
parce qu’elle avait confiance en nous. (…) Après, je l’ai plus vue.
Anthropologue – Elle
est pas revenue ?
Laurence – Non. Mais au
moins, on a servi à ça.
Anthropologue – Ouais.
Ouais.
Laurence – Des fois on
peut servir uniquement de béquille pour mettre à jour une situation.
Mais ceux qui sont
sacrément au point, c’est la brigade des mineurs hein. Vous les avez pas
interviewés ? (…) Faut y aller hein.
Ici,
Laurence semble se décrire en assistante de la police, puisque la grande sœur vient
« déposer » chez elle. Quant à la « demande » de l’usagère
que la police soit prévenue, il me faut la questionner à la lumière de ce que
j’avais relevé lors de mes premiers contacts préalables à ma recherche. Les
assistantes sociales qui m’ont reçue concernant mon entrevue alors que,
mineure, je demandais à pouvoir partir de chez mes parents, réinterprétaient ma
demande en un « vous demandiez à être placée ». C'est-à-dire que dans
les propos de l’assistante sociale, la demande, qui peut être floue, a déjà
rencontré la grille des possibilités qu’elle connaît : selon les cas, le
placement, la police … Alors, la grande sœur demandait-elle l’intervention de
la police, venait-elle « déposer », ou est-elle venue simplement
« pour que ça s’arrête », sans bien savoir plus précisément ce
qu’elle venait demander ? Elle rencontre Laurence et sa conception du
métier : « servir de béquille » pour l’accompagner en direction
de la brigade des mineurs.
Cette conception du rôle d’intermédiaire n’est pas
unanimement partagée. Ainsi, Patricia, bénévole associative, ne pense pas
pouvoir prendre téléphone ou voiture pour accompagner un parent vers la police.
Comme elle nous le relate dans le cas d’une famille de trois frères.
Le père des trois frères avait abusé d’au moins l’un d’eux, jadis, et il se trouve que ce frère découvre qu’il abuse maintenant de sa nièce. Il ne prend pas contact avec une maison du Rhône, mais avec une association de lutte contre la maltraitance envers les enfants.
Patricia, bénévole
associative - Au départ c’est vrai qu’on s’est un petit peu, on était très à
l’écoute de ce monsieur qui était quand même perturbé, déjà, par moments il
était pas bien.
Et puis on, on se
rendait bien compte que, il venait régler son propre (…), de ce qu’il avait
vécu. Il voulait régler ça maintenant avec son père, par le biais de sa nièce.
Mais on avait toujours en tête, et ça, c’est dommage qu’après il ait pas voulu
porter plainte, (…) ce qui nous tourmentait quand même, c’est que cette petite,
enfin c’était une jeune fille, (…) aurait continué à subir des choses du
grand-père, quand elle allait chez le grand père. (…) Alors ça ça nous,
évidemment que ça nous contrariait. Et, (…) parce que lui il était tellement
contrarié de ça, on lui a dit, ben de toute façon, si, si vous êtes tellement
mal à cause de ça, de votre nièce, il faut porter plainte (…). Et puis refaire
une procédure. Et ça, il a pas voulu. Donc il a continué de nous appeler, et
nous on lui a toujours re-servi la même chose, et du coup maintenant on n’a
plus de nouvelles.
(…) de toute façon on peut pas faire à sa
place, hein. (…) Parce que tant qu’y a, nous, c’est le dépôt de plainte, donc
qu’il soit fait par n’importe qui, mais qu’y en ait un. (…) C’est pour ça que
on, on s’était tournés, moi je m’étais tournée vers l’autre frère (…)
Anthropologue – Hmmhmm.
Et il a jamais avancé de raisons pour lesquelles il voulait pas le faire ?
Patricia – Ben, celui
qui venait, non. Ben, il, il voulait faire quelque chose, mais il aurait bien
aimé que quelqu’un fasse à sa place. (…)
Mais à la fois, s’il
était sincère, c’était peut-être douloureux aussi pour lui de, de re, refaire
marche arrière, pour ce qu’il avait subi de son père. C’était remettre encore
tout ça à plat, il avait quand même bien 50 ans, hein. (…)
je pense qu’ils
savaient pas, mais c’est vrai, qu’il fallait porter plainte, donc ils pensaient
qu’on allait prendre en charge, et puis que, on allait aller faire justice
là-bas chez le, chez le grand père (…)
Anthropologue - Hmmhmm.
Donc ça s’est terminé comme ça.
Patricia - Voilà. Donc
on sait pas si y’a une gamine qui continue de subir des choses. Là je pense pas
qu’elle peut maintenant subir des choses de son grand père, mais pour pas que
ça s’ébruite, le père la, la, lui avait enlevé son portable, enfin il l’avait
pas séquestrée, mais vraiment coupée de, du reste de la famille pour pas que ça
fasse de vagues. (…)
Porter plainte, ça fait
peur aux gens, parce que c’est vrai que c’est dénoncer. C’est dénoncer, et,
bon, après ça, ça peut être mis au grand jour, et puis il suffit que les gens
soient un peu, aient un peu une notoriété pour que, alors là c’est verrouillé
pour que pas que ça, ça se sache.
Anthropologue - C’est
vraiment lié aux histoires de notoriété, ou … ?
Patricia - Ben dans ce
cas là, quand même, un peu.
En effet, porter plainte, cela fait peur aux gens. Aussi, il serait mieux que quelqu’un d’autre s’en charge …
L’ex-incesté
apparaît ici potentiellement coupable de vouloir, par sa plainte, « régler
ses comptes à lui », puis finalement coupable, par son inaction, d’avoir
laissé les choses continuer. Bref, coupable quoiqu’il fasse. Vision sombre et
suspicieuse qui alterne avec une vision empathique, dans l’hypothèse cette fois
où « il était sincère » : dans ce cas, cela doit être dur pour lui
de devoir « replonger » là-dedans.
Nous
entrevoyons ici, effectivement, la situation de l’ancien incesté, qui se
retrouve confronté à la récidive de son incesteur sur quelqu’un d’autre, des
années plus tard.
Situation
difficile, vue côté incesté/e/s : c’est aussi quand Aurélie avait appris
que son incesteur abusait sa nièce, qu’elle a tenté de porter plainte
« pour l’arrêter », malgré la peur que l’incesteur lui inspirait
encore, des décennies après. Mais l’accueil au commissariat, blessant, la fait
renoncer (Perrin, 2008, p 73).
Il
me faut ajouter là les questions récurrentes, sur des forums internet
d’entraide entre victimes d’inceste, de la part de certaines parmi celles qui
ne souhaitent pas porter plainte pour elles-mêmes : ne serait-il pas
possible qu’existe une procédure « de signalement » (sic) ?
C'est-à-dire une procédure pour signaler qu’elles ont été abusées par cette
personne, un peu sur le modèle de la « main courante » : sans
avoir à endurer les affres d’années de procédures, de confrontations judiciaires,
etc, comme ce serait le cas si elles portaient plainte. Manière de laisser une
trace « au cas où » il tente de s’attaquer à d’autres … Manière
bien éloignée des suspicions de Patricia, autour du thème « cet incesté ne
réglait-il pas ses affaires à lui par cet intermédiaire ? », puisque
là, les incestées concernées voudraient pouvoir signaler pour protéger d’autres
victimes potentielles.
Manière
qui montre également le manque, patent, d’intermédiaires accompagnateurs, de
« béquilles pour aller aux flics », pour les adultes confronté/e/s à
un proche incesteur sur un/e mineur/e de la famille.
Mais quand aucun/e adulte de l’entourage familier du ou de la mineur/e ne vient chercher conseil auprès d’une maison du Rhône ou d’une association, il faut que le/la professionnel/le se positionne en effectuant, ou non, un signalement. Le signalement, c’est d’abord, notamment pour les travailleurs/euses du Conseil Général, une obligation : « l’obligation d’ « avise[r] sans délai l’autorité judiciaire lorsqu’ « un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être ». » (Serre, 2009, p 36). Dans les documents du Conseil Général, cela semble d’ailleurs très simple : il y a une procédure, suivons-là, et, dans certains cas nommés comme plus graves, une procédure plus particulière.
L’anthropologue
- et donc vous me parliez de, des procédures par rapport aux, aux cas
d’inceste, donc, vous disiez que c’était complètement différent. On peut
peut-être commencer là-dessus ?
Hélène, assistante sociale
polyvalente de secteur - Alors, moi, personnellement, dans ma, dans mon
espace professionnel, je n’ai jamais eu d’enfants qui sont venus me faire des
révélations d’inceste, mais si ça se produit, on n’est pas tenus, nous en tant
que travailleur social du département, de rencontrer les parents : on doit
saisir directement le Procureur. (…) On n’est même pas tenus … Il faut
qu’on, c’est vrai que c’est, c’est assez précis …
Françoise - Oui, il faut qu’on soit très discrets par rapport aux familles, pour pas que les familles se mobilisent, voilà, à mettre un frein par rapport à l’action qu’on va avoir. (…) C’est une procédure où on doit rester très très prudent.
Ainsi, pour les cas « d’inceste », et uniquement les cas d’inceste, il ne faut pas mettre au courant la famille. Consigne qui se trouve en retrait par rapport aux documentations, qui prévoient, elles, que les familles ne doivent pas être informées, dès lors que les faits relèvent du pénal. C'est-à-dire abus sexuels, bien sûr, mais aussi maltraitances physiques graves, comme par exemple celles qu’avait subies David Bisson … quoique … lisons plutôt :
« Evaluation d’une information
préoccupante liée à un fait à caractère sexuel :
Si le fait constitue un crime ou un délit (notamment les agressions sexuelles,
les violences sur mineurs), vous avez l’obligation d’en aviser le Parquet en
appelant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. » (Rhône,
2008, p 37).
Nous pouvons voir
que l’ambiguïté est présente dès la documentation : David Bisson aurait-il
été oublié au passage ? Nous savons pourtant, parce qu’il nous l’a raconté
plus haut dans ce mémoire, comment sa mère réagissait, lorsqu’elle était
informée des révélations de son fils. La mise sous terreur, les mesures de
rétorsions pour avoir parlé, n’existent pas uniquement en cas d’inceste, mais
ceci a été occulté dans la réflexion des instances qui pensent et organisent la
Protection de l’Enfance.
Et, outre ces
restrictions aux mesures de précaution vis-à-vis des parents, s’ajoutent
d’autres problèmes pratiques, qui rendent extrêmement difficile à vivre,
souvent, la démarche du signalement.
A la contradiction
entre l’obligation de signalement et le maintien du secret professionnel,
analysée par Serre pour les assistantes sociales de secteur (Serre, 2009,
p 36-37), s’ajoutent par exemple d’autres problèmes bien concrets, que
nous relate Micheline, qui exerce en lycée professionnel.
Micheline, assistante
sociale scolaire - Oui, je pense qu’il y a un phénomène de réputation aussi.
(…) il suffit que ça se passe mal avec un aussi, pour que du coup, ben euh,
toute la classe en fait, faut récupérer le truc après. (…)
Et
puis il y a (…) le titre d’assistante sociale : c’est, c’est toujours un
truc qui a arrêté les gens, hein, c’est, aller voir une assistante sociale,
c’est vraiment la dernière des choses que les gens auront envie de faire.
L’anthropologue - Ah
oui ?
Micheline – Oui. Oui.
C’est toujours comme ça. L’image de l’assistante sociale, c’est encore, ben,
l’image qui est véhiculée, hein. L’assistante sociale, qui place les enfants.
C’est très très dur. (…) Les assistantes sociales ont une réputation d’enfer,
quoi. Donc, on est, on peut intervenir dans la classe pour parler de n’importe
quel autre sujet, la dernière fois c’était des relations entre les garçons et
les filles, euh, et ça a été « ouais, mais pourquoi vous êtes là, mais
après vous allez tout répéter, mais après … », voilà.
(…)
Mais il y a toujours, toujours, toujours, je trouve hein, quand même, de la, la
méfiance de certaines personnes vis-à-vis des assistantes sociales.
Anthropologue
– Hmmhmm. Mais vraiment par rapport aux placements, quoi, en fait ?
Micheline – Ouais, ben
la réputation hein. C’est, c’était … donc euh, on leur explique hein que le,
les placements, c’est le juge qui décide, c’est pas ... Et puis souvent ben
dans les cas de maltraitance en fait, quand ils viennent parler à l’assistante
sociale, (…) on leur explique qu’on peut pas garder ça pour nous, que c’est
trop grave, que on est obligées de, alors, ou transmettre au Conseil Général,
ou transmettre au juge ou au Procureur, donc c’est vrai qu’on est le facteur
déclenchant même si nous, on fait pas après quoi. (…) Ben faut l’assumer
hein, c’est, voilà, c’est ... Mais surtout ne, ne rien rien faire derrière le
dos des élèves quoi, donc. Et puis bien expliquer aux gens. Quand ils viennent
nous voir, ben par exemple pour un problème de maltraitance, tout ce qu’on va
faire, à qui on transmet.
Ici,
le fait de ne « rien faire derrière le dos », de l’élève maltraité/e
mais aussi de ses parents, est décrit comme un moyen de pallier à cette
mauvaise réputation des assistantes sociales. L’élève et ses parents sont des
partenaires, et ce, même en cas de signalement judiciaire.
Micheline, assistante
sociale scolaire – [Là] on a convoqué quand même les parents, on a vu le gamin
et tout. Là ça a été signalement quand même … judiciaire, hein, quand même.
Parce que c’était, on, on sentait, alors déjà le gamin nous a dit que c’était
pas la première fois, hein, que c’était, que c’était quand même euh, grave, et
puis, bon.
L’anthropologue – Que
la chaîne de vélo, en fait, c’était habituel, quoi ?
Micheline - Ouais. Ouais, ouais ouais ouais ouais. (…) donc on a expliqué aux parents, on leur a dit, mais vraiment, puis, je pense que on peut expliquer aux parents, tout ce qu’on va faire, qu’ils sont allés trop loin, qu’on comprend que là ils aient pêté les plombs, mais que là, ça dépasse quand même l’entendement, quoi. Que nous notre rôle c’est, c’est la Protection de l’Enfance, (…) euh, et puis que c’était quand même trop trop grave. Donc on leur explique tout ce qui va, on leur lit, on leur lit hein, tout ce qu’on a écrit, euh, s’ils nous disent « bon ben là non, là vous êtes allés un peu fort », donc on en rediscute avec eux, on peut changer les termes aussi. (…) A partir du moment où on fait avec les gens, je crois que c’est déjà plus accepté. Voilà. Même quand c’est pour des problèmes de maltraitance.
Serre relève l’importance croissante qu’a pris le respect du droit des
usager/e/s. Via d’une part l’application de la loi du 17 juillet 1978, qui
« établit pour les usagers « un droit à la communication par les
administrations des documents de caractère nominatif les concernant ».
Certes, dans les faits, rares sont les usagers qui mobilisent ce droit, mais
celui-ci n’en a pas moins modifié le rapport des travailleurs sociaux aux
écrits qu’ils produisent. L’éventualité d’une consultation par les personnes
concernées semble guider pour partie l’écriture des signalements » (Serre,
2009, p 40). D’autre part, la loi du 6 juillet 1984 « précise les
droits des familles dans leurs rapports avec les services de Protection de
l’Enfance : la mise en place d’une action éducative, dans un cadre
administratif et contractuel, est désormais soumise à l’accord écrit et signé
des usagers. (…) [Les travailleurs sociaux] perçoivent souvent la nécessité
d’obtenir l’accord de la famille par écrit comme une contrainte
supplémentaire » (Serre, 2009, p 41).
Mais ici, le signalement est judiciaire, et sort donc du cadre de cette loi. Micheline, dans ses pratiques vis-à-vis des parents maltraitants, va donc bien au delà de ses obligations légales en associant ( !) les parents maltraitants à la rédaction du signalement. Quelles peuvent être les raisons de ce zèle (au sens de Dejours, 2000) ?
Micheline, assistante sociale scolaire – [toujours évoquant l’enfant victime de chaîne de vélo] Mais c’est dur tout ça, à, à vivre, en fait, et puis à reprendre les relations. Puis, même pour ce gamin, après, bon moi j’ai eu des frères et sœurs dans le même établissement [lui c’était l’aîné], donc, ben les parents, après avaient un sacré a priori, en fait, vis-à-vis de moi. (…) Et puis du coup le papa (…) n’osait plus tenir son rôle de père. Donc on leur disait, parce que les autres faisaient n’importe quoi, hein, les deux petits, ils faisaient n’importe quoi, on leur disait : « mais allez-y, affirmez-vous », il me dit « ben non, j’ai plus le droit ».
Finalement, d’après la description faite, nous pourrions nous demander à quoi a servi ce signalement ? Serre remarque que « Le recours à la Justice suppose que l’intervention judiciaire apparaisse comme un relais lorsque la relation assistantielle échoue dans son objectif de transformation (…). Or certaines familles ne sont pas signalées à la Justice alors même que la relation assistantielle a du mal à s’établir et qu’un changement est souhaité » (Serre, 2009, p 89). Il s’agit de familles pour lesquelles le signalement serait, en termes d’effets concrets, inefficace selon l’expérience acquise des assistantes sociales. Micheline signale pourtant.
Micheline, assistante
sociale scolaire - Donc, (…) oui, j’en ai fait [des signalements]. Pas toujours
euh … C’est pas facile. C’est pas facile à faire, c’est pas facile à vivre,
c’est pas euh … je vais pas dire qu’on est rodées, alors on est peut-être
rodées dans l’écriture. On est rodées dans l’écriture, on est euh, on a plus le
réflexe hein. On sait plus « bon ben y’a ça, hop on fait ça ça ça ».
Ca c’est vrai que c’est plus simple dans ce sens-là.
L’anthropologue -
« Y’a ça on fait ça » ? (…)
Micheline - Ouais, mais
après y’a tout le côté humain, qui est (…) toujours très très très difficile en
fait.
Et
ce n’est ni le bilan mitigé, ni la dureté du côté humain, qui l’arrêtent, même
si elle « gère » cette dernière difficulté en associant les parents
au signalement et à sa rédaction. Ce qui pourrait l’arrêter un peu ?
Micheline, assistante
sociale scolaire - Alors ben les signalements pour maltraitance, alors on
essaie. On essaie quand même beaucoup beaucoup de travailler avec la famille,
hein : on va pas euh … on va pas tout de suite saisir un juge, hein, ou le
Procureur, ça non, absolument pas, de toute façon sinon y’aurait beaucoup trop
de signalements, il pourrait pas …
A
cet instant, Rozencveig opine du chef, et commente : « Le nombre de
cas signalés, et donc suivis par les tribunaux pour enfants, a singulièrement
augmenté en quinze ans. Les services sociaux ou l’éducation nationale signalent
massivement à la Justice. Cette judiciarisation est très inquiétante et, pour
le moins, mériterait qu’on en analyse les termes. » (Rozencveig, 1998, p 444). Ce commentaire se situe,
précisément, dans le chapitre intitulé « une Justice en situation de plus en
plus difficile » … Finalement, le/la travailleur/euse social/e est donc
appelé/e à jouer un rôle de premier filtre, afin d’éviter une surcharge trop
importante des tribunaux. Et où se situe, alors, en pratique, la limite qui
fait signaler ou non ?
Micheline,
assistante sociale scolaire - Un jeune en fait qui arrive et qui, ben qui s’est
fait frapper une fois, pour nous à la limite (enfin ça dépend de la façon dont
ça s’est passé), c’est pas de la maltraitance, donc on téléphone aux
parents, on dit bon ben voilà on a constaté ça, il faut venir en … Non, on dit
pas ça par téléphone, on leur demande à les voir, déjà : jamais jamais par
téléphone. On ne voit jamais … Au maximum, on essaie de voir les parents
(toujours, on prévient toujours le gamin), par exemple un jour où on est dans
l’établissement le lendemain, au cas où l’élève soit absent, pour pouvoir
suivre tout de suite hein, au cas où il y ait des représailles le soir. C’est
toujours pour la sécurité de l’élève (…) On fait ça par exemple un, un lundi en
étant sûres d’être là le lendemain matin, comme ça on peut suivre, ou alors on
les voit le matin et puis comme ça ils ont toute l’après midi pour se calmer
avant que l’élève rentre le soir .
Dans
son manuel de théorie des sondages, Desabie relevait, parmi les différents
problèmes susceptibles de fausser les résultats d’une enquête, « le désir
d’impressionner favorablement l’enquêteur. [Ce] désir de faire bonne impression
conduira par exemple à une sous estimation des consommations d’alcool ;
(…) à une surestimation de l’écoute d’émissions culturelles à la radio. »
(Desabie, 1965, p 426). Certes, je ne suis pas en train de commenter les
résultats d’une enquête par sondage. Néanmoins, comment entendre ce moment où
mon interlocutrice se rectifie ? « Non, on dit pas ça par
téléphone » : cherche-t-elle à plaire à l’anthropologue ? Ou,
plus probablement peut-être, à réciter la bonne procédure, difficile pour elle
à appliquer en pratique ? Micheline nous fait ici entrevoir les zones
d’ombre des entretiens, leurs limites.
Entrevoir
seulement.
En
revanche, elle affiche là, de manière ostensible, son souci de la sécurité de
l’élève (« c’est toujours pour la sécurité de l’élève »), lors de ces
prises de contact avec des parents occasionnellement violents. Et jusque-là,
précisément, nous n’avons évoqué avec elle que des cas de violences physiques,
motivant ou non un signalement de sa part. Pourtant, tout ce qui vient d’être
dit reste bien valable en cas d’abus sexuels. La sécurité de l’élève ?
L’anthropologue - Et
ils vous sont arrivés comment, ces, ces cas en fait ?
Micheline, assistante
sociale scolaire - Les élèves qui viennent m’en parler ? Le dernier en
date c’est une élève qui est venue m’en parler, c’était son papa, donc euh,
problème d’attouchements, donc, donc, ben, j’ai appelé le, j’ai appelé le
proc’, j’ai fait le signalement direct au proc. (…) Y’avait en fait la maman au
domicile, donc … alors y en a qui sont
pour, y en a qui sont contre, moi j’ai appelé la maman, j’ai reçu la maman, je
lui ai expliqué. Y a des procs’ qui disent oui, y’a des procs’ qui disent non,
voilà, mais euh, bon, on savait que les flics allaient débarquer à la
maison donc, bon, puis la maman, c’était elle aussi qui devait protéger
ses enfants hein, puis aller porter plainte. A priori, c’est, comme les enfants
étaient mineurs, c’est au parent de protéger ses enfants et d’aller porter
plainte.
Le
signalement est bien fait directement de façon judiciaire, comme le demandent
les procédures. En revanche, la mère est avertie, contrairement à ce que
recommandait la procédure. Micheline fait ainsi son possible pour la restaurer
dans son rôle de parent, qui consiste, nous dit-elle, en un devoir de
protection de ses enfants mineur/e/s. Mais comment faire quand en réalité, la
mère est, par exemple, elle-même soumise à l’incesteur et ses désiratas, sous
terreur[46] ?
« Moi-Ta mère
avait pas le droit d’avoir des pilules, donc c’était lui qui décidait de tout
là aussi ?
Lydia-Oui. (…) en fait,
ma marraine habitait sur le même palier. Donc ses enfants, donc Marion avait 17
ans à l’époque, elle était la meilleure amie de ma mère (…) et donc elle l’a
vue, donc maintenant elle s’en rappelle, que il l’appelait, « tiens toi
prête à telle heure », donc à telle heure fallait qu’elle soit dans la
chambre les jambes écartées. Enfin bon c’est un peu exagéré mais c’était ça.
(…)
M-Mouais. Et, du coup,
ça fait une question derrière : les enfants c’est qui qui a décidé de les
faire ?
L-Ah mais c’est lui
hein. Même maman je lui ai dit, mais est-ce que au moins t’as voulu tes enfants
est-ce que tu les as aimés ? » [années 1980-1990]
Dans un numéro de Population et Sociétés paru en 2008, Michel Bozon et Nathalie Bajos observaient que « De certains types d’agressions, les femmes parlent beaucoup moins : les rapports forcés et tentatives commis par les conjoints et partenaires, ainsi que par les amis et copains » (Bozon et Bajos, 2008, p 2). Non seulement les femmes elles-mêmes, mais l’ensemble de la société, en parlent moins, puisque seule la violence conjugale, et non le viol par le conjoint, est évoquée publiquement dans quelques campagnes. En outre, jamais cette violence conjugale n’est pensée comme pouvant se dérouler dans le même foyer que des abus sexuels incestueux. Or, le géniteur-incesteur de Lydia n’est nullement une exception, quand il fait subir à Lydia exactement ce qu’il fait à sa mère : « tiens-toi prête à telle heure ».
Mais s’il est en prison, c’est, en revanche, uniquement pour les viols commis sur Lydia.
On imagine bien ce qui aurait pu se passer, si Lydia avait été voir Micheline alors qu’elle était encore mineure : la mère aurait été avertie, et aurait, comme c’était son habitude, tout répété au géniteur-incesteur … qui avait, me rappelle Lydia, « des armes ».
Après avoir ainsi vu le signalement comme une procédure à suivre, puis, avec Micheline, comme une difficile procédure à suivre, nous allons le voir, avec Fabrice, comme une procédure en réalité complexe. Fabrice travaille alors dans le cadre d’une association.
Fabrice,
assistant social en service enfance - Ce qui m’a fait alerté, enfin ce qui m’a
fait faire un rapport de signalement, c’est que la jeune fille, qu’avait 13
ans, disait que son frère voulait la voir en train de prendre son bain, donc 13
ans, hein, et le frère qui en avait 16, euh, pouvait être, montrer des
conduites d’emprise sur elle. Donc à un moment donné y a eu suspicion de coups
qu’il lui aurait donné, et, moi ce que j’avais à voir c’était que le frère
pouvait, donc dans le cadre de la maison hein, imposer toujours son, son avis,
et était sans cesse à dire « Océane, ça doit être comme ça, tu mets pas la
télé, c’est moi qui mets la télé », d’une façon très autoritaire, et, il
n’hésitait pas à aller, ben, à des intimidations physiques : le coup, personne
ne l’a reconnu, ni lui ni elle.
L’anthropologue –
Fhm !
Fabrice – Donc, Océane
disant ça, le, les autres intervenants observant que elle était arrivée une
fois avec un … un cocard, et voyant ce que le frère faisait subir à sa sœur à
l’intérieur, à l’intérieur de la maison, j’ai fait un signalement en demandant
une IOE. Donc j’ai …
Anthropologue - une
IOE, c’est ?
Fabrice
- Investigation Orientation Educative : donc c’est pas placement, mais
c’est intervention judiciaire pour mandater un travailleur social qui va venir
voir ce qui se passe dans la famille.
Anthropologue – Hmmhmm.
Et donc là vous en étiez au coup …
Fabrice
– J’en étais au coup, mais j’avais une suspicion de relation incestueuse.
En réalité, Fabrice n’est pas seul, et au départ, il n’a aucunement cette suspicion.
Fabrice, assistant
social en service enfance - Je dirais, moi j’étais pas forcément pour signaler,
mais, on va dire que entre professionnels il y a aussi des rapports de … de
force, ou des rapports de co-influences, et on va dire que j’étais le seul à
dire que pour moi il y avait pas forcément, que j’avais pas assez d’éléments
pour dire QUE.
Anthropologue - Hmm.
C'est-à-dire que vos collègues avaient des suspicions plus prononcées sur des
histoires sexuelles ?
Fabrice – Ouais, ben.
Voilà c’est ça. Et que moi, je, je, m’in, qu’effectivement, je pensais qu’y
avait de l’emprise. Jusqu’où ? J’en savais rien mais que ça me paraissait
pas sexualisé. En même temps, j’ai fait quelques recoupements, je,
effectivement, après, en relisant mes notes, je m’étais bien, effectivement,
c’est là où je me suis …
Anthropologue – (…) Quelques
recoupements de …?
Fabrice – Ben, que à un
moment donné, l’emprise pouvait croiser le sexuel. J’étais bien sur de
l’emprise, sur de la prise de pouvoir sur l’autre, mais pas, euh … il peut y
avoir de l’emprise non sexuelle quoi. Et donc, j’étais plutôt là-dessus. (…)
Moi mon travail, c’était que les parents prennent leur place, et puissent
édicter une loi qui soit reconnue, et que si leur loi n’est pas reconnue, ça
n’est pas à leur enfant de, de faire régner la loi.
Anthropologue - A leur
enfant, en l’occurrence ?
Fabrice – Ben, les
garçons [il y avait plusieurs garçons]. (…) Donc j’étais plutôt là : que
les parents gardent, ben, le, le monopole de la violence légitime, voilà, si on
peut dire comme ça. C’est …
Anthropologue – (rires)
Hmmhmm. Parce que dans cette famille c’était heu, y’avait … ?
Fabrice – Ben y’avait
quand même, je trouve, alors, c’était un, comment je dirais, c’était aussi, les
parents n’avaient pas le, le pouvoir, en même temps, y’avait peut-être des
délégations de pouvoir : c'est-à-dire que les parents donnaient le pouvoir
aux enfants pour exercer le contrôle en leur nom. Parce que pour ces
parents-là, quand même, les filles devaient pas être éduquées comme les
garçons, elles devaient avoir nettement moins de liberté que, que les garçons. [2 garçons, 3 filles]
Ainsi,
tout comme le signalement déclaré « intempestif » par Liliane
Daligand, il ne s’agit pas de l’œuvre d’un seul professionnel, mais d’un
collectif. « Ce sont dans ces espaces informels, latéralement aux réunions
d’équipes officielles, que se discute la pratique du métier, celle qui ne peut
se discuter qu’entre gens du métier sur la base d’une expérience commune »
(Molinier, 2008, p 117), m’est-il alors suggéré par une de mes lectures.
Autrement dit, il convient de noter l’importance des concertations « de
couloir » entre professionnel/le/s suivant ici une même famille. Elles
conduisent Fabrice à faire des recoupements qu’il n’aurait pas fait tout seul,
et aussi à l’élaboration d’une stratégie collective pour faire aboutir le signalement.
Fabrice, assistant social en service enfance
- La responsable enfance qu’a centralisé, qui centralise tous les signalements
a eu un autre, autre document qui venait du, soit du CMP, soit du vé, soit
de l’institution où se trouvait (…)
l’adolescente, et euh, là y’a eu une, on va dire que, j’ai eu une collègue
travailleuse familiale qu’a fait aussi un rapport, donc y’a eu trois rapports
en même temps. (…) Bon c’était concerté, hein, tout ça.
En effet, « Le
signalement met particulièrement à découvert : soumis à l’appréciation des
professionnels de la Justice, cet écrit est toujours susceptible d’être classé
sans suite. De façon plus immédiate, il expose au jugement de la responsable,
notamment quand celle-ci corrige les signalements rédigés par ses subordonnées,
qu’elle est censée signer aussi. » (Serre, 2009, p 233). Ici,
l’action concertée débouche sur l’IOE désirée.
Fabrice, assistant social en service enfance
- Ce qui fait que tout ça ça a été
envoyé au juge, et euh … ben y’a eu une IOE qu’a été mise en place, et l’IOE a
conclu au fait que y avait pas besoin d’aller plus loin. (…) Donc ils ont
rencontré le, le, le fils, ils ont rencontré la fille, et ils ont [inaudible]
qu’il y avait pas lieu. Pas lieu d’aller plus loin si, ben il continuait à y
avoir un travail éducatif qu’était mis en place. Voilà.
Pourtant, « le consensus, en réunion par exemple, ne signifie pas que la responsabilité devient collective. (…) Ces décalages entre certaines pratiques des professionnels de terrain et les exigences des magistrats font apparaître une tension sous-jacente entre la logique judiciaire d’individualisation de la responsabilité en matière de signalement et la logique bureaucratique de collectivisation apparente de la décision de signalement avec la mise en place des commissions enfance [par exemple] » (Serre, 2009, p 46-47). Delphine Serre fait ici allusion au fait que, pour le juge, le signalement doit avoir un auteur individuel. Dès lors, qu’il y ait eu élaboration collective via un passage en commission enfance, ou concertation dans un couloir entre pairs, il faut un nom en bas de la feuille. Finalement, alors que le collectif joue un rôle déterminant, il faut trouver quelqu’un qui voudra bien « porter le chapeau » pour ce collectif, et pas uniquement pour les relations avec le juge …
Fabrice, assistant
social en service enfance - Par contre bon c’est moi qui ait annoncé le … qui
ai lu le rapport, puisque nous quand on fait des rapports on les lit. Donc, qui
ai lu le rapport à la famille, qui ai annoncé que ja, lui euh, qui ont annoncé
à cette famille que, ben, j’allais demander, j’allais saisir le juge (…). En
théorie, c’est pas comme ça, [inaudible] la responsable enfance qui transmet,
mais bon, bon les parents ils sont pas dupes hein, si, ça part bien de nous.
(…)
Donc la mère a, vous
imaginez bien, la mère était vachement plus atteinte que le papa, me disant que
elle allait peut-être demander à arrêter la, la mesure, que c’était, que je
portais, que j’avais des doutes très graves. Ce que j’ai confirmé
effectivement : des doutes très graves, effectivement.
Anthropologue – (rire).
Oui. Hmmhmm. C’était une mesure administrative au départ, oui, c’est, ils
étaient pas sur du judiciaire ?
Fabrice – Voilà. Pas du
tout. (…) Pour moi qu’il y avait beaucoup de motifs d’inquiétude et que je,
j’avais aucune certitude en la matière, pas du tout j’avais beaucoup
d’inquiétudes, pas de certitudes, mais que mes inquiétudes, qui n’étaient pas
fondées sur rien. J’ai pas dit non plus que c’était étayé par d’autres professionnels.
Mais euh, voilà, que j’étais euh, que je portais un peu le, enfin, plus qu’un
peu, cette, cette demande-là.
Le
collectif est même caché avec soin à la famille par Fabrice, qui assume donc
seul les ennuis relationnels à venir : menaces de la mère d’interrompre la
mesure, c'est-à-dire la relation avec lui, etc. Ici comme au lycée
professionnel, le signalement met en péril les relations avec la famille
concernée.
Pourtant, quelque chose pourrait nous surprendre : Fabrice a fait un signalement au juge des enfants, donc un signalement « judiciaire », mais pour obtenir une des mesures qui relèvent des compétences judiciaires civiles de ce juge (IOE, placement, etc). Il ne s’adresse donc pas à un juge pénal, qui pourrait enquêter afin d’instruire un procès pouvant conclure à la culpabilité ou à l’innocence du frère soupçonné d’abus. Juge pénal qui, dans le cas de ce frère, puisqu’il est encore mineur, serait d’ailleurs également le juge pour enfants[47].
L’anthropologue –
Hmmhmm. Et entre « faire penser à », et « penser
fermement », c’est quoi la nuance ? Qu’est-ce qui se … ?
Fabrice, assistant
social en service enfance – (Silence, réflexion)
Ben, si je pense
fermement, je demande pas une IOE.
Anthropologue – Oui.
Fabrice
– Si, pour moi, y’a abus sex, enfin y’a inceste, je demande un placement.
Anthropologue – Oui.
Fabrice – Ou, ou c’est
même pas un placement, puisque dans le cas d’inceste, il y a une procédure
encore particulière : il faut pas informer les familles, faut veiller à ce
que, voilà, protéger au maximum ; donc c’est encore une autre procédure.
Mais, si j’ai une certitude, à ce moment-là, je, voilà. Et, je lis pas, si j’ai
une certitude, je lis pas le rapport (je dis bien en matière d’abus sexuel,
hein. Pour tout le reste c’est pas la même chose). Mais si j’ai une certitude,
je vais pas lire le rapport.
Si Fabrice a une certitude, il s’adresse toujours au juge civil. Il est déjà peu ordinaire de devoir placer un enfant[48]. Extra-ordinaire de devoir ne pas lire le rapport à la famille. Extra-ordinaire aussi d’avoir une certitude d’abus sexuels intra familiaux : Fabrice doit donc s’y reprendre à deux fois, avant de retrouver toute la procédure qu’on lui a apprise pour ce cas de figure. Implicitement, il fait bien, lui aussi, par ses pratiques, fonction de filtre pour limiter la masse de situations qu’aura à traiter le système judiciaire : un cocard, lorsqu’il est du fait du frère sur une sœur mineure, n’est dans les faits pas qualifié de « coups et blessures » au pénal. Une volonté de voir une jeune fille de 13 ans prendre son bain, n’est pas dans les faits retenu comme une immixtion intolérable dans l’intimité d’autrui, lorsque le bain est pris à la maison.
Christine Delphy remarque alors, dans un article intitulé de façon provocante « L’état d’exception : la dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée », qu’il existe un parallèle frappant entre l’opposition public / privé et droit commun / droits spécifiques. Chez Engels, commente-t-elle, mais aussi chez la majorité des auteurs, y compris sociologues, qui considèrent ces dichotomies comme (implicitement) « naturelles ». Et les utilisent alors telles que, comme si elles constituaient un concept scientifique. Elle précise que « par « privé », [elle] entend( …) la « sphère du privé » ou la « vie privée » : utilisées par le sens commun comme par les spécialistes de sciences humaines, ces notions n’ont pas de définition précise » (Delphy, 1995, p 74).
Or, en sociologie, explique Delphy, aucune catégorie n’est « dans la nature des choses », car toutes sont construites socialement. Du moins, précise-t-elle, pour la sociologie constructiviste, dont elle se réclame clairement.
D’où sa thèse centrale : le « privé » n’est pas une catégorie naturelle, dont les « droits spécifiques » (s’appliquant principalement aux épouses et aux enfants) seraient le reflet. Au contraire, la sphère privée est instituée par ces droits spécifiques.
Il faut remarquer ici que Delphy parle de « droits » au sens large, c'est-à-dire que pour elle ce terme inclut les textes, mais aussi la jurisprudence et l’application coutumière (par la police notamment, mais aussi, ici, par les acteurs/trices de la Protection de l’Enfance) du droit.
Elle prend l’exemple de la violence conjugale, et nous offre alors une affirmation choc : « Ce qui explique les violences conjugales, c’est la conjugalité : c’est que la société a créé une catégorie sociale – le ’’privé’’ » (Delphy, 1995, p 82), et non la force physique supérieure des hommes.
« Explique » ces
violences : c'est-à-dire les permet, les autorise. Pourquoi ? Parce que
dans l’espace privé, les règles du droit commun, général, qui rendent
illégitime l’usage de la force entre personnes, sont « suspendues ou plus
exactement remplacées par d’autres qui déclarent légitime l’usage de la
force » (Delphy, 1995, p 82-83). Et comment cela ? Ces
dérogations ne sont pas déclarées, ou écrites comme telles dans le droit, mais
sont constituées par des constructions et des pratiques particulières,
notamment juridiques.
Delphy
observe, dans le cas des violences conjugales, que l’absence d’intervention
policière, ou judiciaire (plaintes transformées en main courante, plaintes
classées sans suite, policiers qui se contentent d’un « calmez vous
Monsieur » et repartent …), peut être vue comme une non régulation. Cette
non régulation peut, à son tour, être analysée comme constituant une
autorisation tacite à continuer ces pratiques de violence, voire à les
accentuer si besoin.
La procédure que Fabrice pense appropriée en cas de cocard par un grand frère, ne lui est pas dictée par sa seule volonté, mais est bornée par les pratiques jugées légitimes par des personnes ou des instances en position de lui renvoyer « ceci est un signalement intempestif », ou « ceci est un signalement justifié vous avez bien fait ». Fabrice, par sa pratique quotidienne, participe également, qu’il le veuille ou non, à la formation de cette norme « moyenne » de ce qui est tolérable, ou non, dans l’espace privé.
Une
question qui pourrait alors être posée, c’est : quelle serait la situation
morale du/de la travailleur/euse social/e qui, au quotidien, travaillerait en
ayant conscience de cette non régulation, mais en n’ayant qu’une marge limitée
pour la réduire ?
Ce qui me conduit vers une autre question, sous forme de parenthèse : quelle peut être la situation morale de la personne qui rédige (ou lit) ce mémoire, mais en n’ayant quasiment aucun pouvoir de changer ce qu’elle décrit, tout en en prenant davantage conscience à chaque ligne ajoutée à sa recherche ?
Fermons la parenthèse. Avec Francis, voyons un peu plus précisément ce qu’il convient de faire pour obtenir l’action du juge.
Francis, éducateur en
service enfance - S'il y a signalement, [que] le signalement soit fait sur des
choses très pertinentes, parce que de toute façon le Procureur de la
République, il va transférer au juge des enfants, s'il y a des mesures de
protection à mettre en place, mais vraiment sur des motifs bien particuliers.
Donc c’est vraiment sur l’article 375, si ça colle à ça. Si ça ne colle pas,
y'a rien, y’a vraiment rien.
L’article 375 (du Code Civil) évoque en des termes très vagues l’atteinte à la moralité, à la santé ou à la sécurité de la personne mineure d’âge. Francis ne nous a donc pas dit grand chose. C’est pourquoi lors de l’entretien suivant, qui a lieu avec Fabrice, je suis vigilante et commence par renvoyer à mon interlocuteur « oui, mais l’article 375, il est très vague, non ? ». Dès lors, Fabrice me précise un peu plus les pratiques concrètes.
Fabrice,
assistant social en service enfance - C’est aussi basique que ça, hein, moi
j’essaie vraiment de, d’être très concret avec les gens, et d’observer des
choses très concrètes, parce que dans les rapports, quand on est suivis, c’est
sur des choses concrètes. On est rarement suivis, alors sauf si y a rapport
d’expertise, ça c’est autre chose, mais on est rarement suivis sur de
l’interprétation quoi. (…) On veut plutôt, le juge il aime bien se raccrocher à
quelque chose de …
L’anthropologue –
Ouais, ouais.
Fabrice
- … et puis pour les familles, c’est, moi je trouve c’est plus simple
d’expliquer une relation d’emprise en disant « ben voilà, voyez, votre
fille, elle voulait faire ça, elle a pas pu le faire, à cause de
qui ? ».
Ainsi faut-il faire preuve de pédagogie avec le juge, comme avec les familles … et Fabrice de nous montrer le rôle éminent de l’expert psychiatre, dont la légitimité est « autre chose » que la sienne à lui : seul/e l’expert/e psychiatre est habilité à « interpréter » des faits, à « déduire ».
Fabrice
précise encore davantage.
Fabrice, assistant
social en service enfance - Le juge il veut du concret.
L’anthropologue - Du
concret, c’est ?
Fabrice - « j’ai
vu ça », « on m’a dit ça », mais il aime pas quand « j’en
déduis que ». Lui il aime bien, c’est « y’a eu ça, y’a eu ça, j’ai vu
ça, j’ai vu ça, on m’a dit que, QUE, QUE », « et du coup j’en déduis
QUE », mais à partir d’un énorme faisceau de, de signes, de présomptions.
Enfin ouais. Donc ça peut pas, parce que après on peut dire tout et n’importe
quoi, hein, quoi, on peut tout interpréter, tout extrapoler, tout ...
Anthropologue – Hmm.
Par exemple des dessins et une histoire de bain, c’est ?
Fabrice
– Ben, des dessins, faits dans un cadre thérapeutique, une histoire de bain,
euh, là, c’est, oui, c’est, c’est quand même pas rien, hein, là c’est la mère
qui me dit que son fils aîné a voulu voir sa sœur plus, et, oui, a voulu
s’imposer pour la voir prendre son bain. C’est pas rien. C’est pas, c’est pas
moi qui l’ai inventé, c’est pas, la violence au domicile, la prise de pouvoir notamment
sur la télé, (…) la petite fille qui peut pas sortir … voilà. Tout ça, ça fait,
ça fait un tableau un peu convergent.
« C’est
pas moi qui l’ai inventé » : le travailleur social serait alors, lui
aussi, au nombre des fabulateurs/trices potentiels ? Ceci est d’autant
plus crucial que
Fabrice
- Mais c’est rare de, enfin bon, c’est rare d’être témoin de l’abus
sexuel hein …
Anthropologue – Oui,
c’est, oui, par définition !
Fabrice - Ouais, par
définition, c’est souvent caché, souvent, donc, vous le déduisez. Enfin, c’est
même pas qu’on le déduit, c’est que on, on rassemble des faisceaux
d’indices, un peu à la manière de policiers quand même. Et à un moment donné,
ben, voilà, on arrive à. Mais nous on nous demande pas d’amener la preuve hein.
(…) Nous on nous demande ben, oui, si on pense qu’il y a risque de danger, de
le dire.
« On nous demande pas d’amener la preuve », mais en pratique, lorsqu’il y a suspicion d’abus, il faut faire trois rapports « concertés » pour obtenir une investigation par un autre travailleur social (IOE), qui aboutira sur … rien. Et s’il y avait certitude, nous avons vu peu de temps en arrière que l’enquête au pénal n’était pas forcément le premier réflexe procédural envisagé. De facto, l’application « coutumière » du droit relève bien, ici, et collectivement, de la « non régulation » évoquée par Delphy.
Par ailleurs, Fabrice explicite la position dans laquelle il se sent : « un peu à la manière de policiers ». Dans son service, il faut souligner que ses fonctions le conduisent en effet, tout comme Francis, à être en interactions très régulières avec les juges des enfants. C’est sur leurs rapports que ces juges s’appuient pour prolonger ou modifier une mesure dans une famille. Ils apparaissent donc comme constituant les yeux et les oreilles du juge sur le terrain, effectivement comme peuvent l’être des policier/e/s pour le/la juge d’instruction au pénal. Il s’agit d’une position d’exécutant/e des consignes du/de la juge, donc à priori d’une position subordonnée. Néanmoins, de cette position subordonnée, les décisions du/de la juge peuvent être influencées par ce que lui communiquent ces yeux et oreilles …
Micheline, quant à elle, se décrit comme un simple relais, et non comme « un peu une policière ».
Micheline, assistante sociale scolaire - Nous on est là pour prendre note et puis
pour transmettre. On n’est pas du tout du tout du tout, et c’est ce qu’on leur
explique, hein ; moi ça m’est arrivé une fois, c’était une histoire abracadabrante.
Abracadabrante. (…) Là j’avais un, je me disais « mais quand même, c’est
un peu gros, quoi, comme histoire et tout », mais on fait notre rapport.
On, on fait notre rapport, après, nous, on est, on est assistantes
sociales, on est là pour recevoir la parole de l’élève et pour la transmettre [au
juge]. On n’est pas là pour savoir si c’est vrai, si c’est faux, si c’est,
voilà, hein. Donc quelquefois, les, les (c’était en fait quand on faisait les
signalements directs au juge), donc il m’avait dit « mais qu’est-ce que
vous en pensez ? », et je dis « moi je suis pas là pour euh,
pour savoir ce que j’en pense ».
C’est
également le cas de Laurence, assistante sociale en planning familial, qui,
elle non plus, ne s’estime pas là pour en penser quoi que ce soit :
distinguer le vrai du faux, c’est le rôle de la police, pas le sien. Il faut
dire que l’une comme l’autre n’ont que très peu de « suivis »,
contrairement à Fabrice et Francis, et également, très peu de relations
habituelles avec les instances judiciaires. Peut-être cela explique-t-il ces
différences de positionnements.
Mais pendant ce temps, Jean-Pierre Rozencveig voudrait conclure ainsi, un peu en contrepoint des propos de Christine Delphy, qui lui ont semblé comme une plaidoirie à charge : « La Justice se plaint d’être saisie tardivement et d’une rétention d’information de la part de l’ASE. L’ASE s’inquiète pour sa part des refus d’intervention du judiciaire ou parfois de son impérialisme. » (Rozencveig, 1998, p 345). L’ASE uniquement ? Christine nous raconte une histoire effrayante, qui, elle, s’est déroulée dans un CMP.
Elle nous montre ce qui peut se passer quand une travailleuse se met, ici sans le savoir, trop « en écart » avec les normes de son collectif de travail, normes dépendant dans ce cas précis largement de l’influence, statutaire, du médecin chef. Elle nous montre également la tension maximale entre logique judiciaire et logique de travail social ou psychologique, basé au contraire sur la confidentialité à ne pas violer. Enfin, même le rôle de la parole prête à écart : est-elle outil de preuve judiciaire ou parole à écouter pour soigner ?
Christine,
pédopsychologue en CMP - Légalement, la seule chose qu’on est obligés de faire,
et qui, où on est obligés de violer la confidentialité, c’est les cas où
effectivement, on pense réellement que l’enfant est en danger, soit de coups ou
soit de viols globalement. [remarque : mais pas d’attouchements ?]
C'est-à-dire que si nous on a une suspicion effectivement, de quelque chose
comme ça que personne d’autre ne saurait, on doit le dire. Bon. Mais, moi je
trouve que la plupart du temps, on [inaudible]. Et je sais pas si je t’en avais
parlé, mais il y a eu, il y avait eu une histoire à ce propos, par rapport au
lien justement avec la police et la Justice, qui montre que c’est très
compliqué quand même les rapports entre le soin, le soin, la, la police et la
Justice. (…) C’est pas moi qui m’en suis occupée directement, mais on en a
beaucoup parlé parce que ça a fait une histoire pas possible. (…)
On faisait beaucoup de
visites à domicile, dans les banlieues. C’est, pas nous, pas nous psys, en
général, mais les infirmières psy. Et nous on était référentes des familles.
Et il se trouve que
j’avais donc une collègue infirmière, avec qui je travaillais par ailleurs, qui
est donc allée dans une famille, (…) chez la maman je crois. C’était une petite
fille qui était en (…) famille d’accueil, parce que il y avait des histoires au
niveau des parents, c’était quand même le quart monde, hein, ce milieu. Et donc
elle devait aller un week-end chez le père, un week-end chez la mère, une
histoire comme ça, et le reste du temps elle était en famille d’accueil.
L’anthropologue –
Ouais.
Christine – Donc
l’infirmière en question allait la voir une fois par semaine, je me rappelle
plus si c’est dans la famille d’accueil ou chez la maman, mais à la limite peu
importe puisqu’elle était seule avec l’enfant dans la séance.
Et il y a eu un jour où
cette petite fille, dans la séance, elle avait donc un gros ours en peluche et
elle a mimé une scène de coït, avec l’ours. Bon. Donc euh, tu en déduis … t’as
rien à en déduire, tu l’observes, puis tu vois si ça se répète, tu vois si
l’enfant en dit quelque chose. Bon, on n’est pas policiers, hein. (…)
La collègue a quand
même été assez surprise de ce comportement, évidemment, qui pouvait
effectivement laisser penser à un certain nombre de choses, mais qu’elle avait
pu, qu’elle aurait pu seulement observer, hein, à la limite, bon.
Elle a donc fait le
rapport, en l’occurrence elle était avec une, avec une collègue psychiatre (…).
Et puis il y avait justement (…) une histoire avec la police et la Justice, à
ce moment-la. Ca devait être en cours de jugement ou je sais pas quoi. Et en
fait, euh, on a conv, donc, la police a donc eu vent de cette histoire là, et a
commencé à réclamer le dossier. Donc, l’infirmière, donc ça a commencé à en
parler en réunion, après on a convoqué le médecin chef qui a demandé à je ne
sais qui, donc grand messe institutionnelle, parce que c’était quand même une
question importante, parce qu’il fallait qu’on sache si ce genre de trucs se,
risquait de se reproduire, et qu’est-ce qu’on faisait dans ces cas là, ou si on
était tenus de fournir le dossier ou pas. Bref, ça discute, machin, ça se
termine au médecin chef en disant « vous donnez rien », nous on
refusait de donner, on est dans la confidentialité, y’a rien à dire, on laisse
la police et la Justice faire leur boulot, bon. Ce qui se défendait en même
temps. Très bien. Ca devait être, genre, je sais pas, quoi, mai-juin, c’est ça.
Le temps passe (…).
A la rentrée de
septembre, voilà-t-il pas que l’infirmière se fait convoquer méchamment par les
flics [commissariat spécialisé en « affaires de mœurs », de cette
ville], qui lui disent « alors ce dossier vous nous le donnez »,
enfin en gros sinon je vous colle en taule quoi.
Bon. L’infirmière donc
toute seule convoquée, en plus de ça tu vois, donc, elle était sous injonction
médicale, pour le coup. Bien courageux, les médecins, ils l’ont laissée aller
toute seule. Sa responsable médicale, celle qui avait envoyé était prête à y
aller avec elle, le médecin chef a dit « ah mais non non non, c’est elle,
c’est sa responsabilité à elle toute seule ». Sympa les médecins. Bon, en
gros, c’est nous qui vous disons de pas le faire, mais après quand vous êtes
convoquée vous y allez toute seule, quoi, voilà.
Anthropologue – (rires)
Oui, oui oui.
Christine - Charmant.
Bon. Bref, la pauvre elle était pas bien, hein, je vais te dire. (…) Au bout du
compte cette affaire là a été, a été discutée, et il y a eu une commission
rogatoire, c'est-à-dire que donc après y’a un truc juridique qui fait que …
Anthropologue – Oui,
c’est la commission rogatoire …[effectivement indispensable, juridiquement, à
toute communication d’un dossier sous secret professionnel aux instances
judiciaires]
Christine – Voilà.
Commission rogatoire. Après il y a quelqu’un de la Justice qui vient, (…) toute
une espèce de procédure. Tu me diras entre temps tu as le temps de mettre ce
que tu veux et d’enlever ce que tu veux du dossier, parce qu’il peuvent
apparemment pas venir par surprise. Normalement ils doivent prévenir, bon, donc
en plus de ça c’est absurde parce que s’il y a quelque chose que tu veux pas
dire tu l’enlèves, point. (…) Et ils voulaient récupérer ce compte rendu
de cette fameuse séance. Alors ça, je vais te dire que c’est un truc, alors,
qui est pas, euh, qui, qui reste en suspens, ces histoires-là. Savoir ce qu’on
a le droit de faire, de pas faire, jusqu’à quel point ça peut être utilisé, pas
utilisé. Je sais d’ailleurs pas ce qu’ils en font, parce que sur le plan
juridique, je vois pas bien quelle valeur ça a une séance de thérapie, hein, je
sais pas, je vois pas bien. Parce qu’on n’est quand même que dans de la
thérapie, si je puis dire, dans le sens où on peut tout à fait être, quand
même, dans du fantasmatique.
Alors ça ça peut être des choses que, moi ça m’est pas arrivé, hein, d’avoir quelqu’un qui fasse ça mais c’est tout à fait possible, ça, chez un enfant qui a eu un problème d’inceste. (…) Souvent, quand il y a des, nous on intervient quand même plutôt dans l’après coup dans l’ensemble : ouf, ça évite d’être pris dans ces histoires je dis - je dis pas.
Ouf : ça évite de se retrouver dans des situations difficiles pour avoir effectué un signalement.
Delphine
Serre relevait, pour les assistantes sociales, elles aussi soumises à
l’obligation légale de respect du secret professionnel, que « Signaler ou
garder secrètes les données recueillies est le dilemme récurrent auquel elles
sont confrontées.
Au début des années 1990, plusieurs procès ont posé de façon aiguë la question de la responsabilité pénale des travailleurs sociaux en cas de non signalement à l’autorité judiciaire et ont rendu l’exigence de respect du secret professionnel de plus en plus problématique. La première et la plus retentissante de ces affaires, qui a eu lieu en 1989-1990, concernait l’inculpation, puis la condamnation, de quatre travailleurs médico-sociaux (dont une assistante sociale de secteur et sa responsable) pour non dénonciation de crime : dix jours s’étaient écoulés avant que le viol d’une mineure par son père soit signalé à la Justice. » (Serre, 2009, p 36-37). Inversement, « Pour les juristes et les magistrats, le travail social ne peut pas être un « espace de non droit ». Ils critiquent la « règle du silence » et stigmatisent les comportements « les plus corporatistes et frileux » qui règnent dans les services sous couvert du secret professionnel. (…) [Ceci alors que] Pour les organisations syndicales et professionnelles de travailleurs sociaux qui s’expriment notamment au moment des procès, l’incompatibilité est radicale entre la logique judiciaire et celle du travail social. Elles opposent la « délation », la « dénonciation immédiate » à « l’aide » et à « l’éthique professionnelle ». » (Serre, 2009, p 38). Manifestement, les enjeux et contradictions sont les mêmes dans le CMP pour les professionnel/le/s du psychisme. Nous pouvons y ajouter la contradiction entre parole en séance de psychothérapie et parole utilisable judiciairement : à l’inverse de Liliane Daligand, qui fait profession de l’utilisation judiciaire des paroles et attitudes enfantines à partir d’outils et savoirs psychologiques (tests, …), Christine réfute toute pertinence, toute valeur de preuve à une telle parole ou de tels jeux : cela peut aussi bien être du fantasmatique, nous dit-elle.
Et lorsque le signalement est, en pratique, une décision collective, un délai peut être conçu comme nécessaire pour y réfléchir et en discuter, même dans les cas relevant du pénal.
Laurence,
assistante sociale en planning familial - Et là, pssshhhhhjjjjj ! Elle
nous sort … : donc sa maman, à cette fille, était donc nourrice
agréée, euh, pas, comment ça s’appelle ? Pas auxiliaire, assistante
maternelle, mais de la DDASS, avec donc un mari, donc on est bien d’accord (…) et
le mari pratiquait des attouchements sur les enfants qui étaient placés.
L’anthropologue
– Hmmhmm. Et sur la jeune fille aussi ?
Laurence
– Alors, je suis pas, je me rappelle plus bien mais y’a du y avoir un petit
truc comme ça. Je suis pas sûre. Mais, ça c’est un peu flou dans ma tête. Alors
nous voilà avec un truc, (…) nous au niveau de notre responsabilité de service
social, et de médecins, on peut pas laisser un monsieur tripoter tous les
gamins qui sont confiés. (…) Nous ici on n’est pas dans le signalement à tout
prix, faut qu’on, ça sert à rien de faire notre vengeance, à part dans des
trucs bien gore bien gore, mais enfin là, on s’est dit on va quand même
réfléchir. Et puis, [inaudible : « on réfléchit » ?]
jusqu’au vendredi, c’était déjà pas mal. Et puis on a dit à cette jeune fille,
de toute façon, en plus comme c’est des enfants placés, on est bien obligées
de, de le signaler au Conseil Général. (…) Ca a foutu un bazar. Ah ben là elles
avaient quelque chose de croustillant, ben elles nous ont foutu une tête …
Est-ce à dire que, s’ils avaient été des enfants biologiques, il aurait pu ne pas y avoir de signalement ? Signalement qui est, ici, peu ou prou, assimilé à une forme de « vengeance », à l’opposé de la perception qu’en développent par exemple les auteur/e/s de La violence impensable, lorsqu’ils/elles affirment : « « Le signalement des mauvais traitements a pour but premier de protéger les enfants, non de sanctionner les auteurs ». En d’autres termes, il s’agit avant tout de dénoncer des sévices dont l’enfant est victime, plutôt que l’auteur de ces faits. » (Gruyer-Nisse-Sabourin, 2004, p 69). Bien sûr. Mais qui ignore, décemment, que si sévices il y a eu, l’auteur/e devrait, en toute légitimité, payer pour ses actes par une peine infligée lors d’un procès ?
Le signalement, qui semblait un acte simple et bien cadré par des procédures, apparaît donc en réalité comme souvent éprouvant à mettre en œuvre : il peut mettre en péril les relations ultérieures avec les usager/e/s, les familles. Ceci peut motiver une pratique réelle en écart parfois important avec les prescriptions des procédures : par exemple, associer les parents au signalement, y compris s’ils sont maltraitants, afin de garder de bonnes relations avec les familles, mais aussi peut-être de leur faire comprendre que « cela dépasse l’entendement ». Outre cette motivation relationnelle, peut intervenir, dans les cas d’incestes, une motivation idéologique plus explicite : c’est le rôle de la mère, de protéger son enfant, donc il faut l’informer, et ce, avant le passage de la police. En méconnaissance des relations réelles entre cette mère et l’incesteur.
En outre, alors que les procédures décrivent le signalement comme un acte individuel, il s’avère souvent être le fait d’un collectif de collègues, après débat entre eux/elles. Cela pose alors, de façon plus large, la question des normes collectives, variables selon les lieux, et qui peuvent dans certains cas violemment se rappeler à l’employé/e qui s’imaginait pouvoir faire un signalement hors normes locales, un signalement, finalement, à son initiative individuelle comme le laissent accroire les procédures. Ces normes vont, de plus, toujours dans le sens d’une application en retrait des textes, montrant en filigrane les choix inconscients de la société française : plutôt la non régulation, ou la moindre régulation, que risquer de surcharger la Justice et d’augmenter les coûts. Dit autrement : plutôt mettre les travailleurs/euses sociaux en position d’agents filtreurs, qu’en position d’agents pouvant être réellement protecteurs vis-à-vis de toutes les violences intra familiales, y compris sexuelles : le « signalement parapluie » existe peut-être en matière de « danger », mais pas en matière de maltraitance, et pas dans mon corpus d’entretiens. Il s’agit alors de réserver au juge les faits les plus graves, mais aussi les mieux prouvables, même si bien sûr, il n’est pas demandé au travailleur ou à la travailleuse social/e d’apporter la preuve, mais juste d’informer la Justice de ses soupçons … les contradictions dans les demandes faites aux professionnel/le/s sont, à cet égard, la règle : entre le signalement « intempestif » et le signalement « tardif », la marge semble très étroite, le terrain périlleux. Entre le respect de la confidentialité et des usager/e/s adultes, et la protection effective des mineur/e/s, également. Aux travailleurs/euses sociaux de s’en débrouiller.
Si Laurence, que nous venons de quitter, n’est pas dans le signalement « à tout prix », d’autres sont, pourrait-on dire, dans le signalement « à aucun prix ». Les mères d’incesté/e/s, lorsqu’elles découvrent qu’il y a un problème, s’adressent à une maison du Rhône, à une association de lutte contre la maltraitance des enfants, ou … au CMP, tout simplement. Et ces choix variés d’intermédiaires induisent des réponses variées à des situations similaires : les abus sexuels incestueux.
Christine,
pédopsychologue en CMP – Donc elle elle avait rien dit quand elle était petite,
et quand elle a eu, et alors ça c’est un phénomène assez fréquent, enfin en
tout cas moi dans celles que j’ai vues. Quand elle a eu une quinzaine d’années,
c’est comme ça qu’elle est venue, tu demandais comment les gens arrivaient. Là
elle avait laissé, elle avait laissé traîner des petits mots un peu partout
dans la maison, donc à usage de sa mère vraisemblablement
L’anthropologue – Des
petits mots ?
Christine – Des petits
mots. Des petits mots, alors je me rappelle plus exactement, mais c’étaient des
petits mots un peu ambigus, du style « y a parfois des choses qui se
passent que les parents voient pas », ou, ou bien, euh, « parfois les
enfants sont en danger ». Ou bien, enfin des, des espèces de, c’était dans
ce registre-là.
Anthropologue – Noui.
Christine - C’est,
c’est ancien hein, c’est quelqu’un que j’ai vu il y a [plus de 10 ans] donc euh
...
Anthropologue - Des
petits mots un peu flous où on pouvait accrocher ou ne pas accrocher,
ouais ?
Christine – Des petits
mots ambigus, qui, qui, qui, voilà, où on voyait qu’il y avait quelque chose
qui allait pas (…). Donc la maman (…) a bien compris, (…) enfin elle a pas
compris de quoi il s’agissait exactement, mais elle a compris qu’il y avait
quelque chose qui allait pas, donc finalement elle a été assez courageuse,
hein, puisqu’elle a attrapé sa gamine et elle est venue nous voir.
Voyons comment cette mère, courageuse, sera alors aiguillée …
Christine,
pédopsychologue en CMP – Donc en fait on a, donc ça c’était, ça a été pas mal,
c’est la seule fois où j’ai vraiment pu travailler avec ma collègue psycho
d’ailleurs, enfin faire un truc à deux, puisque moi j’avais déjà commencé avec
Elise, qui était donc ado, euh, en fait (…) ma collègue a pris la maman, en
entretien individuel.
Anthropologue –
D’accord.
Christine - Donc on a
fait un travail parallèle, si je peux dire. Bon, entre temps le couple, donc,
a, a travaillé sur lui, un petit peu, si j’ai bien compris, le couple s’est
plus ou moins rabiboché. [rappel : l’incesteur d’Elise était le mari]
Anthropologue – Hmmhmm.
Christine – Mon Elise,
euh, bon, on a fait quand même un gros travail de thérapie pendant quand même,
jusqu’à, jusqu’au bac en gros, donc tu vois sur, largement trois ans (…) [Elle
réussit un concours et part donc dans une autre ville]. Et le problème, c’est
que moi il me semble que ces affaires là ça c’était pas mal régulé, bon ben du
coup c’était resté à l’intérieur de la famille, mais ça semblait se réparer, et
nous on n’avait rien à en, enfin, moi j’estimais que j’avais pas à aller
secouer le cocotier pour quelque chose qui avait l’air de se réparer, bon,
hein. Je me voyais pas aller foutre la merde, dans la mesure où c’était pas
l’intention d’Elise de le faire, moi je l’ai, je l’ai laissée faire. C’était un
truc terminé si tu veux.
Contrairement aux
assistantes sociales rencontrées en maison du Rhône ou aux bénévoles au sein de
l’association de lutte contre la maltraitance des enfants, qui incitent à
porter plainte, voire accompagnent le(s) parent(s) jusqu’à la brigade des
mineurs, ici, Christine choisit d’inciter, voire d’accompagner, une
« reconstruction familiale ». Elle estime son travail fait lorsque la
famille est reconstruite, et non lorsque l’incesteur est sanctionné. Elle
perçoit d’ailleurs très bien les risques de tumulte qu’il y aurait eu à tenter
d’autres options : « secouer le cocotier », « aller foutre
la merde » … A cet instant, Marcelo Viñar nous rappelle que, comme en
réponse à un dictionnaire de psychologie, il questionne quant à lui le fait de
« superpos[er] la notion de « guérison » et celle de silence
symptomatique » (Viñar, 2005, p 1214).
Or précisément, Christine
semble prendre le silence symptomatique comme critère déterminant que l’affaire
est réglée :
Christine,
pédopsychologue en CMP – Donc elle allait bien quand elle est partie. Et c’est
le fait je pense, alors, d’avoir replongé avec des gens qui revivaient en
permanence ce qu’elles avaient vécu enfant, si tu veux du coup elle elle est
repartie encore là dedans, et du coup si tu veux elle a complètement remis en
question les choix qu’elle avait faits en tant qu’ado. Parce que moi j’y étais
pour rien dans son choix de pas accuser son père, c’était son désir à elle,
hein. Ca c’était pas du tout moi qui étais intervenue là dedans, d’ailleurs je
vois pas bien comment je l’aurais fait. J’aurais pu dénoncer les choses, c’est
tout ce que j’aurais pu faire, ce que je n’ai pas fait puisque c’était pas son
souhait. J’aurais été obligée de le faire si ça c’était continué, si tu veux.
Là j’aurais pas eu le choix.
C’est
juste après avoir prononcé ces mots que Christine enchaîne en m’expliquant
qu’Elise, lorsqu’elle est revenue ainsi, lui a appris un nouvel élément :
sa sœur cadette, elle aussi, aurait été incestée par leur père. Elle interprète
ensuite la haine d’Elise comme issue d’une jalousie envers sa sœur. Mais
Christine, comme beaucoup de professionnel/le/s semble-t-il, ne sait pas que la
conduite la plus fréquente d’un incesteur est d’abuser toutes les personnes qui
sont à sa portée. Elle a en tête un schéma où l’inceste est une
« confusion de places générationnelles », l’incestée prenant la
place de « femme du père ». Dès lors, imaginer plusieurs incestées
reviendrait à envisager une polygamie qui ne cadre pas avec ses représentations
de la famille. Voire, s’il y avait eu des incestés, à envisager une sorte de
« mariage homosexuel » via les abus ?
Les parents d’un des garçons incestés par l’abuseur de Danielle avaient été mis au courant par cet enfant, des abus qu’il subissait. Danielle ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas cherché à savoir s’il y avait d’autres victimes.
Danielle – Oui, voilà.
Mais alors ça, je, c’est justement ça que je comprends pas. C’est, comment, ou
alors ce que leur a dit [leur fils] à l’époque, c’était vraiment, c’était pas,
ça leur semblait pas grave, ou euh, je sais pas ce qui s’est passé. Ou alors,
ils ont, ou alors ils ont douté
Moi – Ouais, ouais.
Danielle – de ce qu’il
a dit, et que du coup, vu que quelqu’un d’autre en parlait, ils, ils se sont
rendus compte que c’était vrai, je sais pas.
Moi – Quand, quand ta
grand-mère leur en a parlé, ils, ça, parce que avant vous saviez pas que [ce
fils] leur en avait parlé, du coup ?
Danielle – Non. Voilà.
Moi – C’est là que vous
avez appris …
Danielle – C’est là que
ma grand-mère a appris que [ce fils] leur en avait parlé quelques années
auparavant.
Moi – D’accord.
Danielle – Mais, euh, le truc, ce que … Oui, c’est ça que je comprends pas.
C’est que eux ils ont pas averti les autres. Alors soit, soit qu’ils y
croyaient pas, soit que …
Moi – Hmmhmm, ni porté
de, de plainte ?
Danielle – Du tout.
Moi – D’accord. Juste
euh, éviter de, de laisser leurs enfants, avec le …
Danielle – Voilà. C’est
ce qu’ils ont dit, c’est qu’ils évitaient. Et d’ailleurs je pense que c’est
qu’ils y croyaient pas, parce que du moment où ils ont su ça, ils sont allés
déménager à 900 bornes de, de, de leurs parents.
Moi – Fhm ! Quand
même.
C’est ainsi que, pendant que ce fils était plus ou moins protégé de l’incesteur, ce dernier a pu continuer à abuser de neuf autres personnes durant encore plusieurs années, sans que quiconque s’en aperçoive. L’absence de « symptômes » ne signifiait pas l’absence de mal en train de continuer à se faire. Pendant que Christine reconstruisait la famille, que faisait l’incesteur ?
Mais la parole est maintenant à Irène, qui reçoit elle aussi des mineur/e/s d’âges apporté/e/s par leurs parents, suite à des abus sexuels incestueux.
Irène, pédopsychiatre
libérale - C'est une petite fille qui a pu dire un jour où elle était un petit
peu loin du milieu familial, que, qu'un frère aîné avait eu des attouchements à
son égard, etc, et que, que c'était de façon répétée. Et c’est vrai que, les,
les enfants, quand ils arrivent à raconter ça, il y a quelques fois un moment
d'incrédulité de la part des adultes, mais les adultes prêtent assez facilement
attention à ça, mais bien entendu lorsque c'est dans la famille, ça leur pose
d'autres problèmes.
L’anthropologue –
Hmmhmm. C’est, d'autres problèmes … ?
Irène - Ben de soutenir
les deux enfants, quoi, le, enfin de, enfin ça reste quand même des enfants,
quand ils ont, quand c'est un garçon de 14 ans et une petite fille, je sais
pas, de 7 - 8 ans, c'est pas, c’est pas
facile.
Alors qu’un père incesteur voit son statut de père mis en cause, par exemple par Francis, éducateur, qui me relatait qu’il avait eu du mal à considérer l’abuseur rencontré au tribunal comme un père, ici, nous entrevoyons que l’incesteur mineur d’âge garde son statut d’enfant.
Curieusement, les incestées sont fréquemment logées à moins bonne enseigne : rappelons-nous Lydia, violée par son père de ses 11 ans à ses 18 ans, lisant son dossier judiciaire
Lydia - Ce qui m’a un
petit peu choquée c’est heu … parce que bon, j’ai lu tout le dossier – j’ai lu
tout le dossier, et, ce qui est bizarre c’est qu’ils posent la question si, à
l’époque du collège, j’étais du genre aguicheuse
Rappelons-nous également comment Christine, pédopsychologue, évoque l’histoire d’Elise
Christine,
pédopsychologue en CMP - Moi j’ai eu, j’ai eu une ado, elle avait 15 ans à
l’époque, elle avait été la femme du père de … 3 ans à 8 – 9 ans, quelque chose
comme ça. Avec beaucoup d’amour, hein, en même temps, enfin je veux dire, elle
avait pris la place quoi, enfin ils faisaient leurs petites affaires tous les
deux.
Mais aussi cette autre situation, où l’enfant en question est âgée de 3 ans :
Christine - Et il
semblerait qu’elle avait dû tripoter la quéquette du papa, alors est-ce que ça
venait d’elle, ou de lui, ça, on sait pas hein, ce genre d’histoires.
Dans ces discours, les incestées sont clairement déchues de leur place d’enfant, et ceci pour occuper, dans l’imaginaire des professionnel/le/s qui les évoquent ainsi, une place qui a peu à voir avec celle de victime : une place de femme aguicheuse, qui « prend la place » de maman pour « faire ses petites affaires » avec papa »[49]. Voire est, dès trois ans, à l’initiative des abus ! A croire que l’incesteur adulte n’est, finalement, ni responsable ni coupable …
Ces discours ne sont néanmoins pas l’apanage des professionnel/le/s : des mères d’incestées peuvent avoir des propos similaires, telles celle de Paulette.
Moi-Donc tu pensais que t’avais
participé en fait ?
Paulette-Ah
ben oui, j’étais sûre que j’avais participé [aux abus], puisque j’avais pas
réussi à l’empêcher. (…) J’étais persuadée que j’étais souillée, vraiment.
( …) Et alors quand on me disait, quand ma mère me disait : « t’es
une affreuse, tu penses qu’à ça »
M-Ah,
oui …
P-Ah
ben, je me disais ben oui, je suis bien une affreuse mais c’est pas ce que tu
penses mais, moi je pense pas qu’à ça, au contraire j’essaie d’oublier ça.
Mais, non c’était vraiment très compliqué hein. Le sentiment de, tu prends
la culpabilité sur toi, tu prends le, euh, et puis tu, de toute façon, tu
prends l’opprobre. (silence)
Pendant ce temps, l’incesteur adolescent, non seulement reste un enfant à soutenir, mais il se doit de garder son statut et ses prérogatives de frère également.
Anthropologue - Ouais.
Ouais. Et dans les, dans les personnes qui viennent vous voir comme ça, ça se
passe comment, justement ?
Irène – Ben …
Anthropologue - Pour ce
que vous en savez.
Irène – Dans, pour
les … ?
Anthropologue - Dans un
cas, par exemple, de ... ?
Irène - Ben en général
nous on ne voit que, qu'un des deux, de la, de parti, c'est-à-dire qu’on voit,
donc on sait un petit peu ce qu'ils décrivent de, de, de ce qu'ils mettent en
place autour de, de l'enfant qui, qui est blessé par rapport à, par rapport à
l'autre enfant, souvent, euh, c’est, il y a un effort de compréhension autant
que cela soit possible de la part de parents. C'est vrai que dans ces cas-là,
quand même, la famille, spontanément, essaie de protéger les deux.
Anthropologue -
D'accord. Et essaie de protéger les deux, euh, de quelle manière, en fait ?
Irène – Ben, ils
essaient, ils essaient de protéger les deux, en, euh, en écoutant d'abord la
parole de l'enfant qui a été abusé par l'autre. En essayant d’écouter, de … de
l'emmener consulter, d’essayer de faire en sorte qu'il, qu’il ne souffre pas,
qu'il soit soulagé du poids que cela a pesé. Et de l'autre côté, c'est en ne,
en n’excluant pas l'autre enfant de la famille.
Anthropologue - Hmmhmm,
d'accord.
Irène - C'est-à-dire en
le gardant, quand même, souvent, sous le toit. Quelques fois si, si les choses
ont été révélées en dehors de la famille, il est possible qu'il y ait une
plainte portée, qu'il y ait un signalement qui ait été fait donc là la Justice
arrive dans la famille.
Si ce n'est pas le cas,
souvent, la Justice n'arrive pas dans la famille, les parents essaient de se
débrouiller euh
Anthropologue – de se
débrouiller, quand même, pour …
Irène - comme ils
peuvent, en faisant … suivre l'un et l'autre.
Anthropologue –
D’accord, suivre l'un et l'autre ? Par … euh … psychologiquement, en
fait ?
Irène -
Psychologiquement, oui.
Anthropologue –
D’accord. Hmmhmm. OK.
Irène n’intervient pas dans le choix des familles. Elle reçoit les mineur/e/s qui lui sont ainsi apporté/e/s, et les suit. Elle m’avait informée, par ailleurs, n’avoir jamais eu à faire de signalement, mais il avait fallu pour cela que je lui pose la question. En fait, il semble qu’elle n’ait jamais pensé qu’elle pourrait avoir à faire un signalement : ne faut-il pas alors questionner ses collectifs de rattachement, puisque, comme nous l’avons vu, en pratique, le signalement est souvent produit par un collectif[50] ? Irène travaille en cabinet libéral. Dans sa salle d’attente, sont affichés des honoraires : entre 55 et 60 euros la séance environ. Le tarif remboursable par la sécurité sociale est alors de 41 euros la séance, ce qui donne une indication sur les parents qui font le choix d’apporter leurs enfants en thérapie ici, même si Irène me précise que tous les milieux sociaux se retrouvent dans son cabinet. Irène, contrairement à Micheline, n’aborde évidemment pas la question du danger de rupture de la relation avec les familles concernées en cas de signalement, puisqu’elle n’a pas envisagé cette possibilité. De fait, voici son premier collectif de rattachement : les parents qui lui amènent leurs enfants. Son deuxième collectif de rattachement semble très lointain : il s’agit du Conseil de l’Ordre des médecins. Quant à ses collègues de profession, nous avons vu leur silence sur le sujet vis-à-vis d’une personne « extérieure » comme je le suis en tant qu’anthropologue : Irène est la seule à avoir répondu à ma demande d’entretien. Quelle peut donc être la norme collective concernant le signalement, autour d’Irène ?
Notre entretien continue …
Irène – (…) Ils vont
pas nécessairement en pension, ni quoi que ce soit.
Et c'est vrai que c’est
souvent, c’est quand même souvent en début d'adolescence que, que les, que les
jeunes, que les jeunes garçons, parce que c’est souvent quand même les garçons,
dans, dans ce qui nous est rapporté à nous, en tout cas, c'est souvent à ce
moment-là que, que les abus ont lieu, à l’égard des plus jeunes, c'est-à-dire
au début de la, de la flambée pubertaire.
Anthropologue – Vous
voulez dire de la part des, jeunes garçons ? D’accord.
Irène – Des jeunes
garçons, oui. C'est-à-dire que c'est souvent des garçons de 12 – 13, euh, 14
ans.
Dans le discours psychologique, les abus sexuels semblent ainsi naturalisés. Christine également, évoquait les « pulsions de l’adolescence », mais cette fois-ci côté incesté/e/s, comme un facteur clef expliquant qu’ils/elles fassent souvent les révélations d’abus subis enfant, à cet âge-là.
Notons par ailleurs que ne pas exclure le mineur d’âge incesteur de la famille consiste, souvent, à le garder sous le même toit. Finalement, chacun/e va en thérapie de son côté, et se retrouve pour dîner le soir … Comme cela a été le cas pour Aurélie, dont les parents n’ont cependant pas consulté de thérapeute, préférant, pour le père, sanctionner l’incesteur de coups de ceinture, pour la mère, rester sans réactions. On se souvient que l’incesteur, resté sous le toit familial, a continué à terroriser Aurélie en tentant de l’attoucher chaque nuit, jusqu’à son départ du domicile.
Aurélie avait 8 ans quand elle a révélé à ses parents les abus que son frère lui faisait subir. Son incesteur en avait 9 lorsqu’il a commencé sa « carrière »[51] d’incesteur : il n’était donc pas encore atteint par la flambée pubertaire. En outre, comme les parents n’en ont pas plus parlé, c’est des décennies plus tard qu’il s’avère qu’en réalité, toute la fratrie avait été abusée par cet aîné.
Mais
revenons à la maison du Rhône d’où nous étions parti/e/s, pour connaître la fin
de l’histoire.
L’anthropologue
- C’est ma dernière question. (…) Et, je vous voyais prête à parler, justement,
sur cette question, et je pense que … ?
Hélène, assistante
sociale polyvalente de secteur - Non non, ben, enfin moi, je, je repensais,
donc, à la situation que j’évoquais : c’est vrai que ça a été très très
difficile pour ces parents de faire cette démarche auprès de la brigade des
mineurs, et de dénoncer les actes de leur fils aîné même si c’était pour
protéger leur fils cadet, mais en même temps la démarche était très difficile,
donc ils ont fait le choix de ne pas porter plainte, contre leur fils, donc
leur fils aîné, mais actuellement ils n’ont plus de lien avec lui.
Porter plainte contre son enfant ? Comment est-ce possible ?
Implicitement, est posée ici la question du reniement, du rejet … et de ses effets supposés.
L’anthropologue - ah
oui ? Ils ont plus de lien avec lui, il est ?
Hélène - (…) Oui oui,
il est placé. (…) Il a été placé tout de suite : en fait, on l’a, donc, on
l’a amené à la brigade des mineurs, et il n’est pas rentré chez lui, le soir
même il a été en garde à vue
Françoise – C’est la
procédure.
Hélène – Et le
lendemain, il a été en centre de placement immédiat. (…) Le père avait quelques liens avec son fils,
par exemple il était rentré pour les vacances de Noël, mais comme, euh, au
niveau du jugement, il peut pas, donc, être euh, physiquement en lien avec son
frère, donc la mère était partie avec le fils cadet dans la famille, voilà. (…)
Mais sinon la mère n’avait plus de liens avec son fils [aîné, auteur des abus].
Françoise - donc il est
rejeté, enfin, un peu exclu, maintenant, hein.
Hélène - Oui, bon, de
toute façon, il y a eu, donc, enfin, ça s’est manifesté par de l’abus sexuel,
mais, et ça c’est l’enquête qui va le déterminer, et, la mesure éducative s’il
y en a une qui est mise en place, mais au niveau familial, il y a quand même
quelque chose
Françoise – Eh oui, y’a
une rupture.
Hélène - Et puis
au-delà de ça, y a quand même, enfin y’a quand même une souffrance au niveau
familial : pourquoi, pourquoi cette maman elle est dans le rejet ?
C’est, on se pose plein de questions par rapport à ce qui s’est passé dans
cette famille.
Anthropologue - Hmmhmm.
Par rapport au contexte, en fait ?
Hélène - Oui. Pourquoi,
pourquoi il en est arrivé là ? Parce qu’il est aussi, enfin, il est
victime, lui, de quelque chose. Il est victime ou il l’a été.
Anthropologue -
D’accord. Hmm. C’est, enfin quand vous dites de rejet, de choses comme ça,
c’est ?
Hélène - Par rapport à
la maman.
Anthropologue - sa mère
qui le rejetait déjà auparavant, ou … ?
Hélène - Ah ben de
toute façon, nous on a observé, avec la puéricultrice, déjà sur le temps du
trajet ou même à la brigade des mineurs, euh, elle était vraiment dans le rejet
par rapport à son, à cet adolescent. (…) Et puis le fait de dire que, qu’elle
voulait plus le voir, que, c’est, c’est quand même lourd pour lui.
Anthropologue – Oui.
Hélène - Donc euh,
voilà, y’a pas de fumée sans feu, voilà, c’est ce que je veux dire par là.
J’insinue pas que la maman a été maltraitante, mais y’a, y’a quelque chose,
mais ça ...
Françoise - … mais ce
passage à l’acte, voilà, effectivement, on peut effectivement imaginer que
c’est, voilà, les enfants qui ont, qui ont subi, qui sont auteurs, ont sûrement
subi
Hélène – Oui.
Françoise - à un moment
ou à un autre, c’est la question qu’on se pose, hein, voilà. Mais, quelque
chose …
Anthropologue – Hmmhmm.
Ouais.
Hélène - … mais, pas
forcément peut-être sous une forme d’ordre sexuel,
Françoise - … d’ordre
sexuel, mais d’un rejet.
Mais après la mise au secret permise ou promue par des professionnel/le/s, ainsi que par la famille, il nous reste à voir que « garder la famille » peut, à l’inverse, être le fait des incesté/e/s eux/elles-mêmes, cependant qu’une professionnelle, elle, souhaiterait que ces non-dits cessent.
Cécile, prise malgré elle dans le secret que lui confie Julie, effectue finalement un signalement, après discussions avec les formateurs de la Maison Familiale Rurale (MFR) où était scolarisée Julie. En effet, m’explique-t-elle, c’était une veille de vacances d’été, les parents étaient peu présents, Julie allait quitter définitivement la MFR. Cécile a eu peur qu’elle « replonge dans les drogues » durant l’été, ainsi que de l’absence de garantie de poursuite du « suivi », du fait de sa fin de scolarité à la MFR. Les abus, eux, avaient cessé avant le moment où Cécile a connu Julie. Nous retrouvons, bien sûr, tous les problèmes déjà évoqués concernant le signalement : sa violence, son impact possible sur les relations entre l’incesté/e et le/la professionnel/le auteur/e du signalement.
Cécile,
conseillère conjugale en planning familial – Moi ce que je voulais, c’est que
le signalement se fasse de manière pas trop violente, et tout ça, euh, voilà,
pas trop brutale. Et heu, donc c’est pour ça qu’on, j’aurais préféré que ce
soit bien accompagné, mais, mais là, il fallait signaler, quoi : elle
était en danger, euh ….
L’anthropologue - Bien
accompagnée ?
Cécile - Bien
accompagnée dans le, la procédure du signalement, quoi. Qu’elle soit, heu,
qu’elle ait une prise en charge, que ça se fasse en douceur, que, elle y soit
un petit peu associée, enfin, que, voilà, quoi, que, y’ait, y’ait des choses
qui … enfin, associée … : qu’il y ait des choses qui soient dites pour
que, pour elle ce soit pas trop violent.
Et en fait ça a pas pu
se faire comme ça. Et euh, dans un premier temps, j’ai trouvé que, enfin, ça a
été bénéfique pour elle, parce que par ces procédures-là, sa mère a été
informée de ce qui se passait, (…) donc elle a pu la soutenir. Et puis après
dans un deuxième temps, eh ben … euh … euh … elle … elle culpabilise, parce
qu’elle dit comme elle, elle le dit texto « j’ai mis le feu à la
maison », quoi.
Donc,
c’est assez, ça a été un petit peu, c’est un peu violent, et ça a pas pu être à
mon avis, assez accompagné, et je sais pas si elle, sa mère, vont faire ce
qu’il faut pour être, pour être, épaulées, suivies, tout ça, face à, à cette
difficulté, enfin, face à … cette violence, qu’on leur renvoie, parce qu’il y a
le, le frère violent, qui a dit à sa mère que il était, que il se considérait
plus comme son fils, donc c’est violent pour une mère. (…)
Alors, bon, là pour le
moment, elle m’en veut beaucoup (…). Moi je me dis que … si ça lui permet de,
elle, moins culpabiliser, et de me
rejeter la faute
Anthropologue – (rire)
Cécile – Voilà.
Pourquoi pas. Le problème, c’est que … (…)
Anthropologue - Là du
coup, si je comprends bien, donc, la famille du côté du père a fait scission
avec Julie qui par contre est un peu soutenue par sa mère, c’est ça ?
Cécile
– Oui. (…) Heu, je sais, alors je pense que un jour ou l’autre la, la famille
du côté du père, la famille paternelle, la branche paternelle va être au
courant, quand même, de ce qui se passe, mais ce qui est un peu problématique,
là, c’est les non dits, quoi.
[La grand mère et le
père ne semblent pas au courant]. (…)
Anthropologue – Hmmhmm.
Et le signalement, lui, il a abouti à … ?
Cécile – Eh ben je sais
pas, concrètement. Je sais que le, le fils a été inquiété, officiellement. (…)
On a décidé, en équipe, de, de faire un courrier à Julie pour … un peu,
rappeler certaines choses, par rapport à comment s’étaient déroulés les, et
puis à sa maman, aussi, pour … permettre d’arriver à, à replacer sa
problématique aussi dans … : dire qu’elle était pas la seule, que, enfin
voilà, et puis que les non dits c’était pas, que ça permettait pas de
construire, que c’était très destructeur. Enfin, plein, plein de choses de cet
ordre-là, quoi. Mais, euh … alors, on l’a préparé ensemble parce qu’on a une
psychiatre, qui nous fait la supervision, on a travaillé un petit peu ensemble,
on a convenu de ce, de ce courrier. J’espère que … Enfin ouais, quant, c’était
la seule chose que je pouvais faire. (…)
Moi c’était mon premier
signalement
Ici, le frère incesteur est nommé comme « frère violent », et Cécile compatit avec la mère, le reniement qu’il lui inflige étant décrit comme « violent » : Cécile est sur une grille de lecture du réel qui semble l’inverse de celle que nous venons de quitter, et qui se construisait entre les deux assistantes sociales rencontrées en maison du Rhône. Les « scissions » dans la famille suite au signalement ne sont d’ailleurs pas décrites par Cécile comme quelque chose de négatif, mais simplement comme des faits qui se sont produits : pour elle, ce qui était négatif, c’étaient les non-dits. C’était, également, d’être devenue dépositaire à son tour de ce secret, alors que Julie refusait obstinément d’en informer sa mère, au motif que cela ferait du mal à cette dernière, jugée par Julie « trop fragile » pour résister à cette révélation ... Le signalement apparaît alors comme le moyen utilisé par Cécile pour, finalement, trancher leur désaccord dans ce qu’elle estime, elle, être le bon sens : faire cesser les non-dits. Elle n’a pas pu, peut-être pas su, rallier Julie à son point de vue, et use, en désespoir de cause, de son pouvoir de le lui imposer, lorsqu’elle craint de perdre le contact avec l’adolescente sans que personne n’ait pris le relais. Vouloir « garder la famille » n’est donc pas l’apanage des professionnel/le/s, et, inversement, vouloir faire cesser les non-dits n’est pas l’apanage des incesté/e/s. Dans son article « Des mots pour le taire », Dussy relatait déjà les motifs avancés par de nombreux/euses incesté/e/s pour ne pas crever l’abcès, et commentait : « Se représenter son père, son frère ou son grand-père comme un violeur produit un conflit intérieur difficilement négociable. » (Dussy et Le Caisne, 2007, p 22). Il me faut ajouter ici : se représenter un père, un frère ou un grand-père comme un violeur produit également un conflit intérieur manifestement difficilement négociable. Un conflit qui peut prendre du temps à devenir affrontable. Pas seulement pour les incesté/e/s, mais également pour les professionnel/le/s, nous le voyons : alors que Christine veut « garder la famille », Elise évolue et souhaite faire cesser le secret.
Finalement, la rencontre entre incesté/e et professionnel/le n’a rien d’évident : la brutalité peut être celle du désaveu vis-à-vis de la gravité des faits, mais aussi celle du désaveu vis-à-vis du besoin de ne faire cesser le secret que très lentement, comme dans le cas relaté par Cécile. Sachant que ce secret reste problématique du fait qu’il garantit à l’incesteur le champ libre pour, éventuellement, continuer à abuser d’autres personnes, de la famille notamment.
Notons,
en outre, la similitude de vocabulaire entre les propos de Julie, tels que
rapportés par Cécile, et ceux de Christine : « j’ai mis le feu à la
maison », « secouer le cocotier », « aller foutre la
merde » … Dussy commentait quant à elle : « Dénoncer l’inceste,
c'est-à-dire briser le silence qui le rend possible, représente dans les
familles incestueuses un acte résolument antisocial » (Dussy, 2009,
p 132). Seulement dans la famille ?
Il me faut ajouter ici la remarque de Cécile, entourant les propos de Julie : « elle culpabilise, parce qu’elle dit comme elle, elle le dit texto « j’ai mis le feu à la maison », quoi. ». Cécile introduit la question de la culpabilité, que je me permets de renvoyer à Dussy, sous forme de questionnement : dire, comme elle le fait, que dénoncer l’inceste représente un acte résolument anti-social dans les familles incestueuses, n’est-ce pas encore porter, ou accepter de faire porter, implicitement, la culpabilité des abus à l’incesté/e qui les dénonce ?
Nous avons vu plus haut, dans le chapitre autour des abus incestueux commis dans l’entourage personnel de certaines professionnelles, qu’en réalité, l’auteur de l’attaque anti-sociale est l’incesteur. Rendons-lui donc la charge qui lui incombe, et constatons que dans la famille où les incestes se sont produits, mais aussi en dehors, souvent, c’est la victime qui est jugée coupable par le collectif alentours, voire se juge elle-même coupable de l’attaque des liens sociaux produite par les abus. Cette assignation de culpabilité n’est donc pas un sentiment programmé de manière innée pour les victimes : il est une résultante d’une assignation sociale de culpabilité. C’est bien la société qui, collectivement, en renvoyant à l’incestée qu’elle était peut-être « aguicheuse » ou « femme du père », construit sa place de coupable. Plus exactement, pour reprendre le concept de Pierre Bourdieu : l’institue comme coupable, reproduisant et reconduisant ainsi l’institution assignée par l’incesteur et son entourage familial.
Heureusement, parfois, on en sort, de cette institution qui ressemble bien plutôt à une destitution. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être réunies, où la confidentialité, le secret, ont cette fois un rôle positif à jouer.
Francine, enseignante
en lycée professionnel – Comme il avait eu ses absences et quelques
difficultés, dans un premier temps, j’ai un peu aplani par rapport aux
collègues, en disant « oui, il a eu des petites difficultés, mais ça va
pas durer », sans donner la raison exacte.
Parce que là j’ai pas
su comment faire du tout par rapport à l’institution : aller en parler au
proviseur, aller en parler au CPE, qui le dirait peut-être à tous les
surveillants ? Qui après … il y a toujours plein d’élèves qui tournent
aussi autour du bureau.
J’avais peur que le,
les choses, donc, restent pas secrètes, si elles devaient le rester au moins
pour un certain temps. J’étais assez gênée par rapport à ça. Donc j’en ai pas
parlé, ni à l’élève non plus.
(…)
Par rapport à lui,
donc, on est restés dans notre petit secret si on peut dire, mais j’avais du
intervenir auprès du prof d’atelier (…) qui disait « ben franchement il
n’est pas sérieux, avec ce que ses parents dépensent pour l’internat, les
voyages et tout ». Je lui avais dit « non écoute, je te dirai plus
tard, ne l’embête pas, mais y’a, y’a vraiment souci ». (…)
Et l’élève m’a dit,
quelques temps après, ou deux semaines après, qu’il l’avait dit aussi au,
au professeur d’atelier à un moment où ils étaient seuls, pour essayer aussi de
lui expliquer pourquoi il avait pas très bien travaillé ou manqué depuis
quelques temps. Et par la suite, donc, il l’a dit à la plupart de ses camarades
de classe.
Sa démarche, d’après
lui, c’était, euh … euh … Qui lui avaient dit que finalement c’était pas si
étonnant, parce que ça arrivait, enfin ou qu’un lui a dit « ça m’est déjà
arrivé », mais qu’ils avaient déjà entendu parler d’histoires comme ça. Et
lui il disait que, il en avait parlé,
parce qu’il commençait
à bien les connaître, c’étaient des garçons sympas et il savait qu’ils en
parleraient pas à tout le lycée, parce qu’il se disait « s’il y en a
d’autres dans le même cas que moi, il faut pas qu’ils attendent
Anthropologue – Oui.
Francine - d’être plus
âgés, il faut pas qu’ils attendent d’être trop mal : moi je suis déjà
mieux ».
Francine
a de la chance : contrairement à Cécile, elle n’a pas été la première
dépositaire du secret de cet élève, qui a préféré se confier d’abord à son
responsable légal, habilité à déposer plainte pour lui, et qui l’a fait. La
Justice suivant son cours, il n’y a pas de signalement à envisager, Francine
n’est de ce fait pas enfermée dans un secret délétère comme l’a été Cécile. Les
faits sont connus par l’instance chargée d’inquiéter l’incesteur, Francine se
comporte, au milieu de sa gêne et de ses hésitations, en personne qui garantit
« le secret » autour de l’élève tant qu’il le souhaite. Il peut
ensuite, selon ses souhaits à lui, choisir d’en parler et à qui il souhaite en
parler, encouragé dans ce sens par le « psy » qui le suit depuis ses
révélations. Il y a disjonction (mais aussi communication) entre
l’interlocuteur qui va porter plainte, qui représente de plus, manifestement,
une autorité légitime aux yeux de l’élève, et le lycée qui va lui servir de
lieu pour se confier à son rythme. Assurément, Cécile aurait préféré cette
situation qu’on peut maintenant qualifier, même si Francine bondit en le
lisant, d’idéale.
Mais à ce stade, il me faut observer que l’incesté
est un garçon, qu’il vivait avec sa mère et son beau-père, et qu’il est alors
parti vivre chez son père (l’auteur de la plainte), sans que cela semble poser
question judiciairement. Du moins, Francine n’a pas eu vent de suspicions
envers le père, selon lesquelles s’il portait plainte ainsi, c’était pour
exclure la mère du droit de garde, monopoliser l’enfant … Là aussi, la
situation est hors du commun. Le commun, ce sont toutes ces situations qui nous
ont été contées au fil de ce mémoire. Le plus affligeant étant peut-être, pour
faire contrepoint aux propos de Micheline, assistante sociale scolaire citée en
introduction de ce chapitre sur le signalement, cette situation où l’incesteur,
ayant purgé sa peine de prison, retrouve toutes ses prérogatives de père sur sa
victime.
Le
pavé dans la mare a fait long feu. « Le proc’ » lui-même rend
finalement, ici, l’enfant à son violeur. La faute à la mère, qui aurait du se
séparer de l’incesteur ?
Parlons-en,
des mères.
Dans son ouvrage Vers une écologie de l’esprit, Bateson construit le concept de double contrainte, en partant de la théorie de la communication. Ce concept lui servira à expliquer comment des interactions entre un parent et son enfant, lorsqu’elles sont imprégnées de double contrainte, peuvent conduire ce dernier à devenir schizophrène.
Pour qu’il y ait situation de double contrainte, il faut, nous dit-il :
- Au moins deux personnes, dont une qui sera la « victime » de la double contrainte.
- Une expérience répétée, et non une expérience traumatique unique
- Une injonction négative primaire, par exemple du type « Fais ceci, sinon je te punirai ». Cette injonction est manifeste, dite verbalement
- Une injonction secondaire, qui contredit la première, à un niveau plus abstrait, et également sous menace de punition : dans notre exemple, « Si tu fais ceci, je te punirais ». Cette injonction est non-verbale, le ton de la voix, une mimique, ou encore des implications cachées dans les commentaires verbaux, la constituent. Elle peut être communiquée par la même personne que la première, ou bien par une autre personne qui vient ainsi en contradiction
- Une injonction négative tertiaire, interdisant à la victime d’échapper à la situation.
Bateson cite comme exemple de double contrainte les propos suivants d’un maître zen : « si vous dites que ce bâton existe, je vous frappe avec. Si vous dites qu’il n’existe pas, je vous frappe avec. Si vous ne dites rien, je vous frappe avec ». Il remarque ensuite que le maître zen reconnaîtra sans doute comme appropriée la réaction de l’élève qui consisterait à se lever et lui arracher le bâton des mains : la situation est ici éducative. A l’inverse, un enfant à qui son parent dirait « je t’aime », tout en ayant un mouvement de recul, et ce de manière répétée, exerce aussi une double contrainte, qui lui permet de dénier ses sentiments de rejet pour cet enfant. L’enfant est ici, en revanche, totalement prisonnier de la double contrainte : à l’inverse du maître zen, le parent a probablement un intérêt « vital » à exercer cette double contrainte. Il n’acceptera donc pas que l’enfant s’en échappe, ce qui le mettrait lui face aux sentiments insupportables qu’il dénie.
Ce concept de double contrainte a été utilisé pour caractériser également les interactions se déroulant à l’intérieur d’une « famille incestueuse », par des spécialistes du psychisme parmi les plus intéressant/e/s, à mon sens, sur le sujet[52] : « En tant que mode de communication, la double contrainte a pour premier effet de faire douter l’autre de la réalité de ses propres perceptions. Quand ce type de communication est une des règles familiales, tout le processus éducatif de l’enfant s’en trouve empreint. » (Nisse-Gruyer-Sabourin, 2004, p 94). Les auteur/e/s poursuivent : « Par exemple, la mère d’une jeune femme incestée lui dit : « quand tu seras guérie, je pourrai divorcer, et je vivrai enfin ma vie … je ferai le tour du monde. » Décodage : « Tu dois pouvoir guérir des conséquences de l’inceste contre lequel je ne t’ai jamais protégée, sans que je quitte ton père » et « c’est toi qui m’empêche de divorcer et de vivre ma vie en ne guérissant pas. » Le thérapeute ne saisit pas toujours immédiatement ce type de communication, qui contient un illogisme érigé en loi : pourquoi attendre que la patiente soit guérie avant de divorcer, alors que précisément ce divorce l’aiderait à surmonter sa dépression ? En revanche, le patient désigné a, lui, immédiatement intégré cette nouvelle information, ce qui a pour effet de le neutraliser pendant une partie de la séance. » (Gruyer-Nisse-Sabourin, 2004, p 141).
Nous nous souvenons de cette mère évoquée par Micheline :
Micheline, assistante
sociale en lycée professionnel - c’est rarement quand même les mamans [qui
venaient lorsqu’elle travaillait pour l’Armée]. Moi j’ai eu plus des mamans qui
croyaient pas leur gamin en fait
L’anthropologue –
Hmmhmm. Oui, c’est …
Micheline - … je pense que c’est le pire
(…). Et là, quand je
vous disais un entretien, là où j’avais envie de dire à la fille « arrête,
je peux plus », c’était ça quoi : la maman l’avait pas crue du tout,
du tout, continuait de vivre avec le beau-père, la gamine était placée, et il
refusait de voir sa gamine : la maman n’avait pas vu sa gamine depuis un
an.
Francis nous parle plus longuement des mères complices, lorsqu’il s’agit d’évoquer cette épouse qui ne s’est pas séparée de son mari, alors même qu’il était reconnu coupable et incarcéré pour avoir incesté leur fille.
L’anthropologue - Mais
elle a été poursuivie, elle au départ ?
Francis, éducateur en
service enfance - Je pense qu’elle a été, il me semble qu’elle avait eu,
y’avait eu une poursuite, et puis voilà : classement sans suite ou non
lieu. Heu … le père avait été condamné … heu … mais, en même temps ça n’exclue
pas, ça n’exclue pas quand même que finalement, quelqu’un … enfin … c'est pas
lié qu'à un acte exceptionnel, ou un acte isolé, mais c'est aussi dans ces
fonctionnements là, lié à … comment la famille fonctionne … et qu'est-ce qui
permet, à un moment donné, que dans cette famille, il va y avoir un passage à
l'acte, qui sera organisé comme tel, et il va y avoir à un moment ou à un
autre, cette déviance qui va presque paraître, en quelque sorte, une déviance
naturelle.
Anthropologue – Hmmhmm.
Francis - Et qu'est-ce
que ne va pas faire l'autre ? Souvent, souvent, des, des mères, je le dis,
je l'ai en souvenir, je l'avais vu dans un bouquin. J'ai oublié l'auteur.
Qu’était lié à une étude où, des mères, victimes d'abus dans leur enfance, non
soignées, il y avait une part importante d'entre elles qui se retrouvaient avec
des maris qui eux-mêmes commettaient des actes d'abus, pour lesquelles elles,
ces mères, ne faisaient pas de passages à l'acte, elles-mêmes
Anthropologue – Hmmhmm.
Francis - mais en même
temps elles mettaient en place tout ce qui était possible, enfin un terrain
tout à fait favorable à un passage à l'acte par le mari.
Et, alors certaines
d'entre elles ne, ne le dénonçaient pas, quoi, ne le dénonçaient pas. Elles
avaient connaissance du passage à l’acte, ou en tout cas : non, pas
connaissance. Enfin … euh … y’avait passage à l’acte, et elles ne … n'allaient
le révéler que quand il y avait l'extérieur qui lui aussi allait le révéler.
Anthropologue –
D’accord.
Francis - C'est-à-dire
que, elles étaient, elles é, elles étaient pas instigatrices dans le sens
"tu vas aller dans le lit de ton père"
Anthropologue – Hmmhmm.
Francis - mais … heu …
ce qu’ils indiquaient, c’était que, il y avait un peu comme une, un voile, une
partie un peu, en quelque sorte, un peu invisible, où "je ne veux pas
voir".
Anthropologue - ouais,
des espèces de peaux de saucisse, quoi
Francis - En quelque sorte. Voilà : "je ne veux pas voir", mais, quasiment de, si je m'absente sur ce temps-là, y a du risque, mais je m'absente quand même.
Dans ce cas précis, il me semble opportun, avant toute chose, de rappeler que le père incesteur sorti de prison, l’optique du juge des enfants était d’organiser des visites avec tiers, afin d’aller peu à peu vers un droit de visite sans présence tierce, puis un retour de l’enfant dans sa famille. Famille qui, donc, comportait de nouveau l’abuseur au foyer. La première absence, c’est peut-être bien alors celle du tiers, qui est appelé à s’absenter, à terme, malgré le risque.
Pourtant, dans les propos de Francis, c’est la mère, ce sont les mères qui sont coupables de s’absenter, coupables d’avoir « laissé le terrain libre » pour que s’installe un fonctionnement qui va permettre les abus : elles ont fait « tout ce qui était possible » pour cela.
Oui, mais comment ?
Paulette-à l’époque, je
me disais ben, oui, de toute façon un jour, ben, si je veux des enfants faudra
bien que je me marie, donc il faudra bien que … Et c’est pour ça que j’ai
choisi le mec que j’ai choisi. Parce que
Moi-Comment ça ?
P-moi j’étais persuadée
que, de toute façon si j’avais accepté Francis, il était tellement bien et moi
j’étais tellement affreuse et tellement ne valant rien, que il serait parti, il
m’aurait abandonnée (…) Et tous les garçons, ils m’abandonneraient. Donc il
fallait que j’en choisisse un qui ne m’abandonnerait pas. Et celui-là, ça
j’étais sûre qu’il m’abandonnerait pas, parce qu’il était tellement maladroit
dans le monde, (…) et il voulait rien faire, mais moi je m’en foutais de, tout
faire, de faire le ménage, de faire les courses, de faire la cuisine, de m’occuper
de tout
Ceci n’est pas sans rappeler Lydia qui m’expliquait qu’elle n’était « bonne qu’à ça : qu’à être violée ». En somme, les mères anciennes victimes d’inceste sont, finalement, coupables de se sentir trop affreuses, trop « ne valant rien » (ou « que ça »), ce qui les conduit à choisir un conjoint tel qu’elles pensent le mériter. Entre cela et l’explication transmise à Francis, il y a juste une occultation : celle de la violence subie et incorporée par l’ancienne victime.
Danielle-Enfin en plus
le pire c’est ça, c’est que j’ai suffisamment ce truc de, vu que je peux pas
être heureuse, enfin, surtout à l’époque, maintenant un peu moins, maintenant
pas, même pas du tout (rire), euh, non, vraiment plus du tout, mais j’avais
vraiment ce truc, de vu que je peux pas être heureuse, autant rendre les autres
heureux. Et du coup, en fait, je tenais le coup (…) Je tenais le coup. Jusqu’à
ce que, vraiment, heu, mon intégrité morale, physique, puisse plus. Jusqu’à ce
que ça casse.
Moi-D’accord. Donc tu
rendais ton mec heureux jusqu’à ce que tu ne puisses vraiment plus ?
D-Jusqu’à ce que vraiment je sois vraiment trop, euh, dans un monde ailleurs tout le temps.
Violence qui, pour Paulette, va continuer, puisque son conjoint sera violent envers elle durant toute la durée de leur mariage, ainsi qu’envers leurs enfants. C’est d’ailleurs peu après la naissance de sa fille, au moment où il manque frapper ce nourrisson en voulant cogner son épouse, que Paulette décide de se séparer de lui : le fait qu’il s’en prenne à ce nourrisson, c’est un déclic.
Mais Francis n’évoque pas uniquement ces mères qui se retrouvent conjointes d’un incesteur : il ajoute celles qui ne le dénoncent pas. Cela pourrait par exemple être la mère de Lydia, déjà citée :
Lydia-J’en n’ai
jamais parlé. Sauf une fois, où j’ai essayé de faire comprendre à ma mère ce
qui se passait, je devais avoir 17 ans. (…) Et elle m’a dit « qu’est-ce
qu’il y a Lydia, ton père te viole ? », en rigolant.
Nous savons que cette mère devait elle-même se tenir prête « les jambes écartées » lorsque l’incesteur de Lydia le lui demandait : cependant que Francis évoque le « fonctionnement familial », terme décidément bien pudique, une deuxième violence est occultée. Il s’agit ici de la violence conjugale, incluant les rapports sexuels obligatoires selon les desiratas du mari. Comment cette mère s’est-elle retrouvée dans cette situation où elle n’est bonne qu’à ça, qu’à être violée ? L’histoire, telle qu’a pu me la raconter Lydia, ne le dit pas.
« Fonctionnement familial » pourrait finalement être un terme, bien pudique, permettant de désigner cette réalité violente et cette transmission de statut entre mère et fille : « bonne qu’à ça, qu’à être violée ».
Et, si c’est normal, pourquoi le dénoncer ?
Lydia-je
vais revenir quelques années avant, heu, quand rien ne se savait, je devais
avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. J’allais dans sa famille à lui,
notamment chez une de ses sœurs à lui, donc une de mes tantes, et un jour je
lui ai dit : « voilà ce que ton frère m’a fait », elle m’a dit
textuellement « je te crois, il m’a fait la même chose quand j’étais
jeune ». (…)
M-Donc elle elle a été
abusée par son frère aîné ?
L-Voilà, quand ils
étaient jeunes. Sauf que elle me dit écoute, je croyais que c’était normal.
Lorsque Lydia porte plainte, cette tante la rejette, nie qu’il lui soit arrivé quoi que ce soit devant les policiers, et ira même jusqu’à aider leur incesteur commun en finançant son avocat.
Et certaines mères, en plus de ne pas dénoncer, participent activement : « Fanny avait abusé de sa fille. C’est un cas à part car elle s’est dénoncée toute seule. Un exemple unique. Fanny se sentait très coupable. En général, ces femmes se défendent en niant. C’est toujours le mari le responsable. A les entendre, elles sont innocentes. Pas Fanny. Elle a accepté sa peine dès le départ. (…) elle a fini par rencontrer Guillaume (…). A un moment, cela a dérapé et ils ont abusé de la fille de Fanny qui devait alors avoir 8 ans » (Poiret, 2006, p 163). De ces dernières, mes interlocuteurs/trices m’ont peu parlé : l’existence d’incesteuses reste aujourd’hui peu connue, impensée. Hormis pour Patricia, bénévole associative, par exemple, qui, lorsque je lui demande « y’a-t-il eu des évolutions dans le temps ? » me répond qu’une nouveauté récente, c’est qu’ils ont eu un cas de grand-mère abuseuse, dont le fils, gendarme, pratiquait, comme cette dernière, des attouchements sur le même enfant. Cas resté sans suite, me précise-t-elle, du fait du statut professionnel de ce père. Commentaire de Patricia : « j’osais pas le dire (qu’il était gendarme) parce que c’est tellement moche ».
Globalement, les mères qui suscitent tant de répugnance (« je crois que c’est le pire », etc) ne sont donc pas ces incesteuses, pas encore connues, mais des mères coupables de laisser faire, de trouver ça normal.
Pourtant, quand une mère réagit, cela pose d’autres problèmes. Réagir, cela signifie quoi ? Surveiller l’incesteur, ne pas s’absenter, de peur qu’il ne recommence, comme le laisse entendre Francis ?
Dans les faits, du moins lorsque l’incesteur est le conjoint de la mère, réagir, cela consiste notamment à s’en séparer, et, dans l’idéal, à porter plainte contre lui.
Oui, mais voilà …
Micheline m’évoque, au passage, ces divorces où la mère, pour s’accaparer la garde des enfants, allègue des abus sexuels incestueux de la part du père, elle constate ensuite que lorsqu’elle travaillait auprès du juge aux affaires familiales, elle n’a en fait eu, elle, qu’un cas sur 50 dossiers. Un cas d’abus sexuels, ou d’allégations ? Dans ses dires, cela est indiscernable. Patricia, elle, est plus précise.
L’anthropologue -
Ouais, vous avez vraiment ce, ces histoires de parole contre parole …
Patricia, bénévole
associative - Oui. (…) C’est quand même la parole de l’enfant, parce qu’on voit
bien là y’a, ben y’avait un dossier (…) où la petite fille employait un langage
de, de grande personne : elle parlait de, de sodomisation, de, euh voilà,
de pénétration buccale, alors que les petits, les enfants ne savent pas forcément
ces mots. Et ça revenait toujours, et on avait l’impression que la maman la
briefait à chaque fois, enfin, y’a eu deux entretiens.
[X précise,
difficilement audible : elle affirmait devant le juge avoir eu des
relations sexuelles, et quand le juge lui demandait ce que c’était pour elle
des relations sexuelles, elle ne savait pas]
Patricia- Oui. Elle
savait pas, oui. Voilà. Donc déjà là ça nous éclaire
[X, difficilement
audible : elle ne savait pas le sens des termes qu’elle employait,
donc ça rendait suspect son témoignage]
Patricia - Oui. Oui
oui. Sans pour autant dire qu’elle ne subissait rien, hein
X (bien audible) – Ah oui oui. Bien sûr.
Patricia - mais on
voyait qu’elle était quand même sous l’influence de (…) sa mère, donc …
L’anthropologue - Mais
… comment, comment ça s’est vu dans ce cas là que c’était sa mère précisément
qui lui avait euh mis ces mots là en fait ?
Patricia – Ben parce
que elle, elle euh, avait pas d’autres contacts, y’avait pas d’autres personnes
qui pouvaient lui, lui parler. Elle allait en plus aux entretiens avec sa mère,
hein, de toute façon, elle était là.
Anthropologue – Ouais.
Ouais ouais.
Patricia – Et puis elle
regardait beaucoup sa mère, hein, je crois, aussi, dans le compte rendu, quand
elle parlait. Et heu … c’est … voilà (…)
Anthropologue – Hmmhmm.
Oui. Donc vous voulez dire, c’était la seule personne, dans son, dans son
entourage, qui était importante
Patricia – Oui
Anthropologue - euh, à
ce moment-là ?
Patricia - Oui. Ben,
c’est vrai qu’en plus, quand il y’a des choses comme ça, les gens veulent pas
aller le crier sur les toits, hein, donc ça se passe vraiment en petit comité
entre le, le, le parent signalant, et, et c’est pas l’autre qui, qui, qui, s’il
fait quelque chose va lui dire « je t’ai sodomisé », hein
Anthropologue – Hmmhmm.
Patricia - c’est pas,
ça peut pas se passer comme ça non plus, parce qu’au contraire, lui il étouffe,
il dit « ce que je te fais c’est normal », « tous les enfants
font ça avec leurs papas, ça veut dire que leur papa les aime », et, ils
vont jamais employer des mots comme ça, parce que pour eux ils font rien, c’est
pas grave ce qu’ils font, donc …
Oui, mais peut-être que ce n’est pas grave, d’être sodomisé/e ? Peut-être que l’incesteur explique que « ceci est une pénétration buccale, ou une relation sexuelle, c’est normal, tous les papas font ça, quand ils aiment leur fille : c’est un secret entre nous » ?
Comment s’étonner que l’enfant ne sache pas bien ce que cela veut dire, lorsque le juge ou un/e autre adulte le lui demande ? Ne faudrait-il pas s’adresser plutôt à l’incesteur pour avoir plus de précision sur le sens de ces mots tels qu’il les lui a « enseignés » ?
Le fait que l’enfant regarde souvent sa mère durant les entretiens, est-il indice de manipulation visant à se l’accaparer ? De confiance conservée en cette adulte qui fait de son mieux pour enfin, mieux vaut tard que jamais, la protéger de l’incesteur ? Comment le juge se forge-t-il ici son intime conviction ?
Irène, à l’inverse, relate le doute qui commence, précisément, pour le parent, lorsque l’enfant se met à employer des mots « pas de son âge ».
Irène, pédopsychiatre
libérale - ça peut être, ou bien des, ça peut être des enfants qui d'un seul
coup, revenant de chez la nourrice ou … revenant … d'un moment passé dans la
famille, rapporter telle scène qui paraît étrange aux parents, ou des propos
qui leur paraissent bizarres, pas de l'âge de l'enfant. Et là le doute est
installé, souvent d'abord au niveau de la famille.
Anthropologue -
D'accord. Quand vous dites de la famille ?
Irène - C'est des parents : le père, la mère qui entendent euh, une parole de l'enfant, et qui disent "mais comment il dit ça, pourquoi il sait ça ? Et de quoi il en parle ?"
Dès qu’il s’agit d’agir, et pas uniquement d’écouter, la parole et les attitudes des mères et de leurs enfants incesté/e/s sont en fait passées au crible de la suspicion par ceux et celles qui se proposent de les … aider ou protéger.
Ainsi, Francis, lorsque je lui demande s’il a déjà fait ou vu des signalements faisant suite à des paroles du/de la mineur/e, et non uniquement à des « signes d’alerte » détectés, me répond que c’est rare. Il cite, comme phrases possibles, aussi bien « j’ai vu la zézette à maman » que « ben mon papa, il joue avec mon zizi ». Et quand cela se produit, il n’y a pas forcément, me précise-t-il, de placement, car d’abord
Francis, éducateur en
service enfance - il va y avoir une enquête, une évaluation, avec l'assistante
sociale, et puis souvent la PMI maintenant (de, de, depuis quelques années, en
tout cas, c'est une enquête conjointe), heu, voilà. Essayer d'éclaircir un peu
plus entre ce qu'a dit l'enfant et puis ce qui globalement se passerait dans la
famille, ou en savoir un peu plus.
L’anthropologue –
Hmmhmm.
Francis – Parce que
après, ffff … on en arrive à "c'est une parole, quoi", hein.
C'est une parole, quoi,
hein.
Anthropologue –Ouais.
Oui. Hmmhmm.
Francis - C'est toute
la question de savoir est-ce que on va croire l'enfant jusqu'au bout, comme ça,
sans, sans, sans contrepoids. Heu … parce que y a aussi, hein, on sait très
bien qu'y a des enfants qui vont dire des choses parce que y'a leur père qui
leur a dit, et il est en conflit avec la mère, ou inversement. La mère qui est
en conflit avec le père et donc qui va dire « ben tu dis ça », ou tu,
voilà, et …
Anthropologue – Hmmhmm.
En conflit heu … ?
Francis - En conflit
heu, ils sont dans une phase de séparation, et puis voilà. (…) Enfin, c’est,
c'est déjà arrivé, des choses comme ça. Enfin c’est déjà arrivé.
Anthropologue – Hmmhmm.
Vous avez eu ce, ce genre de cas de figure ?
Francis – (…) Oui. Ca
c’est déjà arrivé. Des enfants qui ont été ... donc, nous on l'a vu d'ailleurs,
y'a pas très longtemps, dans les média. Une maman qui avait, euh … ben … qui
avait, je crois, donné un coup de couteau à sa fille, et qui avait fait accuser
son fils à sa place
Anthropologue – Ah,
oui. Oui oui. Oui.
Francis - Et le fils
s'était accusé à sa place.
Anthropologue - s'était
accusé.
Francis - Ouais. Il
s'accusait au départ. Et puis finalement, ils sont très vite arrivés à la
question de "mais c'est pas possible, il a pas pu avoir cette
force-là". (…) Mais des enfants qui font ça, qui protègent leurs parents,
ou qui sont manipulés par leurs parents. Mais manipulés, pas, heu, je ferais
bien la distinction entre des parents qui vont être dans de la manipulation,
mais continue, et des parents qui sont pris dans une phase de séparation, de
conflit, et qui vont laisser s'installer ça, en disant ben, qui vont faire
grossir des choses, et puis l'enfant qui, euh, qui va, par conflit de loyauté
avec l'un et avec l'autre, va dire à l’un et à l’autre ce que chaque parent a
envie d'entendre.
Lorsque je demande à Francis s’il a déjà eu ce cas de figure, d’enfant manipulé par un parent lors d’une séparation contre l’autre parent, nous voyons qu’il me répond finalement par un exemple vu à la télé, et qui, précisément, n’est pas ce cas de figure. En effet, le cas vu à la télé est une manipulation d’un enfant contre lui-même, pour qu’il « porte le chapeau » d’une agression, soit coupable, à la place de sa mère. Et non une manipulation pour rendre coupable le père de tous les crimes, dont par exemple le coup de couteau. Etrangement, cette manipulation pourrait d’ailleurs plutôt ressembler à celle qu’effectue un parent incesteur sur sa victime en lui faisant assumer ses sentiments de culpabilité à sa place …
Dans l’introduction d’un article de Paula Joan Caplan, professeure de psychologie à l’université de Toronto, traduit par Léo Thiers-Vidal, nous pouvons lire : « Il existe notamment depuis plusieurs années aux Etats Unis et au Canada, et de façon plus récente en France, un courant d’opinion qui s’est progressivement formé pour affirmer que de nombreuses femmes vont jusqu’à inventer des accusations de violence paternelle, manipulant au besoin les enfants. Ce courant fait souvent référence de façon acritique au « syndrome d’aliénation parentale » ou à « l’aliénation parentale ». » (Vidal et Caplan, 2007, p 59).
En Amérique, « L’allégation selon laquelle la mère souffrait de ce syndrome était souvent basée uniquement sur le fait que celle-ci avait déclaré que son ex-époux exerçait peut-être des violences sexuelles contre leur enfant (Chesler, 1986). Les juges ont alors souvent réagi aux allégations de violences sexuelles formulées par la mère en transférant au père le droit de garde et d’hébergement de l’enfant (même avant que les allégations n’aient été pleinement vérifiées), en arguant que la mère essayait de monter l’enfant contre le père (Chesler, 1986). » (Vidal et Caplan, 2007, p 60). Ainsi, en Amérique, pour une mère, relayer les paroles de son enfant et le protéger en se séparant de l’incesteur, peut conduire à une attribution exclusive du droit de garde de l’enfant … au parent incesteur !
Paula Joan Caplan relève que « il peut être difficile pour un père de déclarer à un juge : « Je n’ai jamais abusé sexuellement mon enfant. C’est ma méchante ex-épouse qui a tout inventé ». Alors qu’il peut gagner en crédibilité lorsqu’il déclare : « c’est réellement trop dommage que mon ex-épouse souffre d’une maladie mentale nommée SAP [Syndrome d’Aliénation Parentale] » et qu’à l’appui de cet énoncé, un psychologue établit officiellement un tel diagnostic. » (Vidal et Caplan, 2007, p 60). L’inventeur du SAP, Richard Gardner, « a ainsi rajouté une arme puissante dans l’arsenal des psychologues et des avocats qui plaident en faveur d’une personne accusée d’abuser sexuellement ses enfants. » (Vidal et Caplan, 2007, p 60). Caplan ajoute à notre information une citation extraite d’un écrit de Gardner, où ce dernier explique que la pédophilie peut avoir des buts procréatifs qui servent la survie de l’espèce … mais comment un syndrome conceptualisé par une telle personne a-t-il pu acquérir une telle audience, une telle légitimité dans les tribunaux états-uniens ?
Aucun/e de mes interlocuteurs/trices, ici en France, n’a employé le terme « syndrome d’aliénation parentale » : Francis évoque par exemple les « conflits de loyauté », qui sont une grille de lecture complètement différente, et présente dans sa formation d’éducateur[53]. En revanche, la croyance selon laquelle un enfant qui parle d’abus au moment d’une séparation, pourrait être en réalité manipulé par un des parents, de fait souvent la mère, est fréquente.
Pourtant, le « syndrome d’aliénation parentale » est bien cité, par exemple dans un dossier consacré aux maltraitances psychologiques, par une publication de l’association enfance et partage. L’enfant concerné y est alors décrit comme « Enfermé dans une relation tyrannique, il peut également tenir des propos absurdes, voire formuler de graves accusations mensongères, en profonde dissonances avec la réalité des faits, pour rejeter ledit parent » (Enfance et Partage, 2007, p 23). Le SAP est également cité, par exemple, par la Fondation pour l’enfance, dans sa lettre n° 53 consacrée aux maltraitances induites par les divorces conflictuels : l’éditorial est confié à Gérard Neyrand, qui signe en tant que sociologue, et évoque que « l’aliénation [souligné par moi] d’un enfant à l’un de ses parents y fait alors figure d’obstacle insurmontable [à la résidence alternée], auquel seule la violence d’une décision institutionnelle imposée semble pouvoir s’opposer. » (Neyrand et Fondation pour l’enfance, 2007, p 1). Bref, s’il n’est pas parvenu dans le quotidien des professionnel/le/s de l’enfance, le SAP, ou aliénation parentale, est en revanche un concept attractif en France également, parmi les personnes et groupements qui réfléchissent autour des questions de maltraitance.
Mais finalement, SAP ou pas SAP, une mère d’incesté/e peut adopter trois grands types de comportements :
- être l’auteure des abus ou y participer activement. Dans ce cas, être coupable.
- Ne pas se séparer de l’incesteur, éventuellement avoir du mal à croire son enfant, voir sans voir … et, ce que mes interlocuteurs ne pensent pas : être elles-mêmes sous terreur en même temps qu’elles relaient cette terreur et contribuent à y emprisonner les enfants, notamment les jeunes filles (qui restent semble-t-il majoritaires parmi les incesté/e/s, même lorsque l’incesteur est une incesteuse).
Dans ce cas, être coupable de n’avoir pas réagi, pas cru ou pas entendu, et d’être restée avec l’incesteur.
- Réagir, vouloir protéger son enfant et faire punir l’incesteur. Donc se séparer de lui et, dans le même temps, porter plainte contre lui. Dans ce cas, être coupable de vouloir probablement s’accaparer l’enfant et exclure le père du droit de garde.
Nous avions noté plus haut que Gregory Bateson évoquait, pour illustrer son concept de double contrainte, ce maître zen qui disait : « si vous dites que ce bâton existe, je vous frappe avec. Si vous dites qu’il n’existe pas, je vous frappe avec. Si vous ne dites rien, je vous frappe avec ».
Nous voyons, au terme de ce premier bout de chemin autour des mères d’incesté/e/s, qu’elles se retrouvent, clairement, lorsqu’elles s’aperçoivent des abus commis sur leur enfant, dans une situation de double-contrainte : coupables si elles disent que les abus existent, coupables si elles disent qu’ils n’existent pas ou sont de l’ordre du normal, coupables si elles ne font rien.
A cet instant, nous pouvons d’ailleurs nous souvenir de cet ex-incesté, cité par Patricia. Elle nous le décrivait tout d’abord comme voulant faire porter plainte pour sa nièce, abusée à son tour par son incesteur, afin de « régler ses histoires à lui par ce biais ». Coupable, donc, de vouloir régler ses comptes à lui. Puis coupable de non assistance à personne en danger, puisque finalement, il n’a pas voulu porter plainte … mais ici, Patricia prenait ensuite conscience que cela avait pu être difficile pour lui, de devoir ainsi « replonger » là-dedans. Les ex-incesté/e/s qui veulent agir pour protéger de nouvelles victimes de leur incesteur peuvent donc elles aussi se trouver prises dans une double-contrainte, Patricia étant loin d’être la seule interlocutrice à avoir cette réaction-réflexe ci.
Enfin, arrivé/e/s quasiment au terme de ce long parcours parmi notamment les travailleurs/euses sociaux (mais aussi les enseignant/e/s, les professionnel/le/s du psychisme, etc …), comment n’avons nous pas remarqué que :
- Le travailleur/la travailleuse social/e[54] qui effectue un signalement (pour inceste ou d’autres maltraitances) peut si facilement se voir renvoyer qu’il s’agit d’un signalement intempestif, qui a fait du mal à la famille et à l’enfant (Daligand). En plus, bien sûr, d’en subir les conséquences, dans ses relations avec les usager/e/s, et/ou avec sa hiérarchie comme la collègue de Christine …
- Le travailleur/la travailleuse social/e qui n’effectue pas un signalement peut si facilement se voir reprocher son silence complice, voire être inculpé/e pour non assistance à personne en danger ou non dénonciation de crime …
- Enfin, le travailleur/la travailleuse social/e ne peut pas « rien faire », puisque « rien faire », dans son cadre professionnel, est déjà en soi une action.
La double-contrainte s’applique donc également aux travailleurs/euses sociaux, et non pas seulement aux mères d’incesté/e/s.
Enfin, dans les quelques exemples de situations conflictuelles entre parents qui peuvent m’être cités en réalité, concernant des maltraitances non sexuelles, la manipulation, la pression sur les enfants, n’est pas nécessairement antinomique de la vérité … histoire de complexifier un peu le débat.
L’anthropologue - Mais
ma, ma question c’est en fait qu’est-ce qui fait basculer du faisceau d’indices
qui pourrait laisser penser que, à, euh, « on pense que », et, euh, à
« y’a » ?
Fabrice, assistant
social en service enfance – Ben si par exemple la, la, la jeune fille m’avait
dit « voilà, mon frère il a essayé de ». Ben, voilà. Voilà.
Anthropologue – Hmm. Ouais, ouais. Et ça ça, ça
arrive, ou ?
Fabrice – Ben moi ça
m’est pas arrivé, mais ça pourrait. Enfin, moi j’ai eu des révélations de
violences physiques, mais pas de violences euh … s ...
Anthropologue – Hmm.
Ouais. Ouais. De violences physiques que vous, dont vous n’aviez pas
connaissance au départ, c’est ça ?
Fabrice - Voilà. Ben la
mesure pour l’autre famille, là, que je suis, que j’essaie de suivre, premier
ent, deuxième entretien, les deux gamins m’en ont parlé, quoi.
Anthropologue – Hmmhmm.
Fabrice – Alors très
remontés par la mère, sans doute très instrumentalisés, mais c’était quand même
pas faux.
Anthropologue – Ouais.
Hmm. Hmm.
Fabrice – Sans doute
que, je vois bien pourquoi la mère leur a fait jouer ce jeu-là, mais en même
temps, c’était pas faux. Donc euh, voilà.
La séparation, par les discordes entre les parents qu’elle contient, serait-elle un moment où, via le conflit de loyauté, l’enfant étant tiraillé entre deux influences adverses, au lieu de n’être que soumis à une influence renforçant l’autre, va pouvoir dire des choses ? Et, surtout, être enfin entendu/e par l’un des parents, même si c’est pour utiliser ces « pièces à charge » contre l’autre ?
Mais dans le contexte où nous évoluons, la complexité est généralement occultée, quand une mère suspecte des abus sur sa fille et réagit. Et Christine nous donne un petit aperçu du parcours qui peut être nécessaire. Elle nous livre, au passage, ses suspicions à elle : puisque la mère « détestait » l’ex-mari, le considérant comme un « pervers », ses doutes sur son comportement vis-à-vis de leur fille ont moins de crédibilité aux yeux de Christine (qui n’est, pourtant, pas flic, nous répète-t-elle). Enfin, la réaction de cette mère (limiter les droits de visite pour « limiter » les abus) peut sembler elle-même étrange, même si Christine ne le relève pas.
Christine,
pédopsychologue en CMP – Ce que dit la mère n’est pas pris en compte par les,
les, par les juges des affaires, des affaires familiales (…). Parce qu’ils
considèrent que tout ce qui est dit par l’un, c’est pour dénigrer l’autre, et
compagnie. Ce qui fait que même quand il ou elle disent des choses qui peuvent
s’avérer fondées, si c’est pas re-vérifié par ailleurs, ça pose problème.
(…)
C’était une histoire avec une petite de 3
ans, dans le cadre d’une séparation, le papa était sur [ville située à
plusieurs centaines de km], donc évidemment c’était un peu compliqué, (…) donc
la mère aurait voulu qu’elle euh, qu’il prenne la petite que la journée, ce qui
aurait effectivement limité les choses, et le papa a revendiqué de la prendre
le week-end entier, en disant « mais moi je vais pas faire la navette »,
ce qui se comprenait en même temps. Bon.
Et donc la mère était inquiète, parce qu’elle la
trouvait bizarre quand elle rentrait, puis parce qu’après elle la trouvait je
sais pas quoi, ou excitée, ou triste, ou qu’elle avait un peu des marques, euh,
bon. Et alors le père aurait dit que, qu’elle s’était mis à cheval sur le
rebord de la baignoire ou je ne sais pas quoi. Bon. Pas impossible hein,
effectivement. T’as plein de choses comme ça tu sais pas. Moi je suis pas flic,
je peux pas. Puis je suis ni mouche, ni flic, et j’ai pas une caméra vidéo pour
savoir ce qui se passe. Donc la mère avait des doutes sur le comportement du
père, mais comme elle détestait le père, qu’elle considérait comme un pervers,
c’était très difficile de savoir ce qu’il en était. Donc moi j’avoue que j’ai
conv, j’ai convoqué le père, hein, pour essayer de discuter avec lui.
(…) Ce monsieur (…)
évidemment m’a soutenu mordicus que en tout bien tout honneur c’était vrai
qu’il dormait avec sa fille, mais oui, mais oui, mais oui, mais qu’il allait
faire attention, et que effectivement il avait l’habitude de faire comme ça.
Bon, donc avec moi il a fait le gentil évidemment. Après la mère est revenue me
dire qu’il y avait eu des trucs pas bien nets, et que, et que, et qu’elle voulait
que je dise quelque chose au juge. Je lui ai dit que moi je voyais pas bien ce
que je pouvais dire au juge, que j’étais pas mandatée pour ça. Donc, donc il
semblerait qu’il s’était passé quand même plus ou moins quelque chose, puisque
la petite avait fait des réflexions à l’école, à la maîtresse, alors je sais
plus ce qu’elle avait dit exactement, mais elle avait exprimé quelque chose,
que son papa lui avait fait mal. Voilà, et il semblerait qu’elle avait du
tripoter la quéquette du papa, alors est-ce que ça venait d’elle, ou de lui,
ça, on sait pas hein, ce genre d’histoires.
(…) A la suite de quoi
la maman était en colère parce que je lui ai dit que moi j’étais pas habilitée
à faire un rapport au juge, donc elle est allée dans, tu sais, je crois que je
t’en avais parlé, dans un espèce de centre où il y a des psys, mais qui doit
dépendre directement du ministère de la Justice et où les, donc les jeunes
enfants, en particulier, viennent comme ça un peu, enfin dans des
consultations-observation, mais où c’est clair que ça sera pour faire un
rapport au juge.
Anthropologue – Oui,
d’accord.
Christine – Donc moi je l’avais renvoyée sur des lieux comme ça, parce que nous c’est pas notre mission, les CMP.
Christine nous explique que les juges considèrent que suite à une séparation, « tout ce qui est dit par l’un, c’est pour dénigrer l’autre ». C'est-à-dire, implicitement, pas uniquement concernant des actes incestueux.
Or, à cet égard, feuilleter les posts sur quelques forums internet d’entraide entre mères divorcées peut être instructif : il est frappant d’y lire les conseils, qui sont du type « surtout, lors de l’audience, ne dis rien de négatif sur lui, car cela jouerait contre toi ».
Le « focus » fait sur les divorces dans les cas de violences sur l’enfant, notamment sexuelles, comme c’est le cas dans l’article de Caplan, pourrait alors laisser la place à un « grand angle », sur le divorce en général. En effet, nous n’avons toujours pas expliqué comment il était possible qu’un concept, le SAP, inventé par une personne en Amérique (et quelle personne, semble-t-il …), puisse avoir acquis autant d’audience si facilement, et ce, au détriment de la protection effective des enfants abusés, au détriment, donc, du bon sens le plus élémentaire, finalement.
Irène Théry, dans son ouvrage Le démariage, Justice et vie privée, évoque le modèle de la famille indissoluble, lorsqu’elle décrit les paradoxes de la médiation concernant le divorce : « En matière familiale, la force d’attraction de la médiation ne vient pas de la croyance en l’efficacité d’une meilleure méthode, mais de l’adhésion à un objectif qui donne tout son sens à sa conception de la Justice et à sa remise en cause du sujet de droit. (…) Car on ne peut s’accorder que sur un objectif commun. A cette question, jamais évidente en cas de divorce, la médiation apporte une réponse : cet objectif existe, il est commun, et ne peut être, si l’on donne la priorité aux enfants, que le maintien de la famille. » (Théry, 2001, p 387-388).
« Paulette-je me sentais complètement
piégée, et que, avec Jean [son fils aîné, adoptif] qui avait été adopté, qui
avait déjà eu une brisure dans sa vie, (…) je ne voulais pas causer une
deuxième brisure
M-Ouais
P-donc je me disais il
faut que je tienne, il faut que je tienne. Heu, jusqu’à ce que les enfants
soient grands, et après je pourrais faire ce que j’ai envie de faire. Et puis,
j’ai pas tenu.
M-Heureusement …
P-Heureusement, oui,
parce que j’aurais fini en piteux état. »
Irène Théry poursuit : « Cette famille maintenue est, finalement, aussi de l’intérêt des parents, qui peuvent trouver une issue à leurs dilemmes de conscience en comprenant que le divorce ne concerne qu’un tout petit segment de l’entité familiale, celui qui les liait affectivement et sexuellement. Si la disparition de ce segment ne touche rien au reste, l’essentiel des problèmes est réglé. (…) Leur seul intérêt réel, c’est de rester un couple de parents, et cet intérêt est d’abord celui de l’enfant. » (Théry, 2001, p 388).
Mais Paulette peut aussi parler du fait de devoir rester un couple de parents. Sa fille, adolescente, vient de commencer une psychothérapie.
« Paulette-Et
c’est comme ça qu’elle a commencé une psychothérapie, qui a duré un certain
temps, jusqu’à un jour où la psychothérapeute nous a téléphonés en
disant : « voilà deux séances qu’Hélène n’a pas ouvert la bouche,
alors je voudrais que vous veniez avec elle tous les deux et je voudrais vous
parler à tous les trois »[Hélène, sa mère et son beau-père], ce qui a été
fait. Et là, devant Hélène, elle a dit : « voilà, j’ai voulu
voir tes parents parce que je ne peux pas laisser la psychothérapie euh …
s’embourber dans le silence, donc je vais proposer une autre solution : je
vais proposer la psychothérapie institutionnelle ». Et on était dans [un
lieu] de la France, pas très loin d’un endroit où il y a trois cliniques de
thérapie institutionnelle qui sont connues, assez anciennes, tout ça.
Moi-Mmmhmmm
P-Donc elle avait en
vue une de ces cliniques. Et c’est comme ça que ma fille est entrée pour la
première fois dans une, dans une clinique euh psy.
M-D’accord.
P-Et Plusieurs années
après, c'est-à-dire après qu’elle ait craché l’inceste, puisque
« l’histoire d’Eva [Thomas] c’est la mienne », j’ai téléphoné à la
psychothérapeute pour lui dire euh, et bien il y a du nouveau, on savait pas
pourquoi Hélène allait mal, maintenant on sait au moins une chose, c’est qu’il
y a une histoire d’inceste. [voix de fausset :] « Aaah … oui, c’est
curieux, c’est vrai que, quand elle est, quand elle s’est enfoncée dans le
silence, le dernier mot qu’elle avait prononcé avant, c’était le mot
inceste ».
M-Mm. Donc elle l’avait
dit ?
P-Donc elle l’avait
dit. Mais … euheuh … la psychothérapeute l’avait virée vers une clinique, et
elle n’avait pas dit au directeur de la clinique : ça.
M-D’accord.
P-Le directeur de la
clinique n’a eu d’autre choix, mais dans les trois mois, que de vouloir
l’envoyer chez son père [qui est l'incesteur d'Hélène].
M-Pourquoi « aveuh
pas d’autres choix » ?
P-Ah ben il a dit
« faut qu’elle aille chez son père, on peut rien faire de plus pour elle,
faut qu’elle aille chez son père, il faut remettre de l’ŒDIPE dans cette
histoire.
M-D’accord. C’est … il pensait en fait que ça venait du fait qu’elle
était euh, chez sa mère ?
P-Oui. » [ces
faits se déroulent vers le milieu des années 80]
Pourtant, Hélène vivait avec Paulette et le nouveau conjoint de Paulette, désigné par cette dernière comme étant le « père nourricier » d’Hélène, qu’il avait de plus gardé depuis toute petite (c’est par cette garde d’enfant qu’il a connu Paulette). Les abus incestueux par le géniteur d’Hélène avaient commencé, semble-t-il, après le divorce, se produisant lors de l’exercice de son droit de garde par le père biologique-incesteur.
Quel est ce modèle de famille qui renvoie mordicus au père biologique, ici violent et violant ?
Le modèle idéologique de la famille indissoluble « a un impact considérable, car il répond au problème le plus difficile pour la société : donner sens au divorce. (…) Comment concilier la liberté reconnue aux adultes de mettre fin à une vie conjugale qui les opprime, ou les déçoit profondément, et la souffrance des enfants ? Le modèle prôné par la médiation répond en disant que le divorce n’est, et ne doit être, que la séparation du couple conjugal. Le « couple parental » est indissoluble, la famille peut survivre au démariage. Cette représentation dit aux adultes : « vous pouvez réparer », si vous acceptez que le lien qui vous a unis quand vous avez mis des enfants au monde est, lui, par nature indissoluble. Le couple conjugal meurt, mais la famille ne se rend pas. (…) Le divorce devient l’apothéose paradoxale de la famille, puisqu’elle résiste à tout, même à la séparation, même à la décohabitation. On achève ici aussi en le théorisant un mouvement très puissant de ce demi-siècle, celui qui identifie la famille à partir de l’enfant, et non plus à partir du couple. » (Théry, 2001, p 390-391).
Nous croyions peut-être en avoir fini avec le mariage indissoluble, depuis l’instauration du divorce. Mais pour la mère, par exemple, victime de violences conjugales, avoir des enfants en commun avec son agresseur de mari la liera, bien malgré elle, à vie à cet homme violent ? Et sur les forums internet d’entraide concernant le divorce, il faut donc que des plus expérimentées qu’elle lui apprennent à ne rien dire de mal sur cet homme, le père de ses enfants, au juge aux affaires familiales, de crainte que cela ne se retourne contre elle et eux ? Mais comment ne rien dire de mal sur un conjoint qui, précisément, a fait du mal ?
« On est « conjoints » désormais par l’intermédiaire des enfants, et donc à vie. La référence à la nature, malgré tous les travaux des ethnologues et des anthropologues, revient en force : contrairement à tout ce qu’ils ont démontré depuis un siècle, la parenté et la famille ne seraient pas des constructions culturelles, mais un donné naturel, biologique : la reproduction fait la famille, une famille aussi indissoluble que le lien biologique. Dans une société où le taux de divortialité atteint 30 %, quel soulagement ! » (Théry, 2001, p 391). Nous touchons là au nœud gordien du désaccord entre les professionnel/le/s qui voudraient réparer la famille, et les familles où ont eu lieu des incestes par exemple : lorsque Lydia dit « mon géniteur » ou « le mari de ma mère », elle refuse, précisément, de dire « mon père ». Pour elle, ce n’est pas un père. Lorsqu’Aurélie évoque son demi-frère incesteur, elle ne me dit pas « mon demi-frère », mais, comme beaucoup d’autres incestées dans ce cas de figure, « le demi-frère ». D’autres incesté/e/s gardent l’usage des termes de parenté, comme Agnès, qui dit « mon père ». Les incesteurs aussi, peuvent se mettre de la partie, comme ce frère cité par Cécile, qui, lorsque sa mère prend le parti de sa sœur victime, lui renvoie un, cinglant, « je ne suis plus ton fils ». Les autres apparenté/e/s peuvent également réagir, comme cette mère qui rejette son fils incesteur de leur autre fils … Bref, l’abus sexuel incestueux pose forcément, et de manière aiguë, une fois mis sur la table et sa réalité bien admise, la question de la dissolution de la famille autour de l’incesteur, d’une part, et de l’incesté/e, d’autre part. Question certainement encore plus difficile et douloureuse que celles qu’a du se poser Laurence, concernant la dissolution de son amitié avec un homme qui s’est avéré avoir commis un inceste.
L’idéologie de la réparation familiale « à tout prix », si elle est plus répandue parmi les professionnel/le/s que parmi les incesté/e/s qui fréquentent les associations d’entraide entre victimes d’inceste, ne fait toutefois pas l’unanimité parmi eux/elles non plus.
L’anthropologue - Et
c’est cette culpabilité qui empêche qu’elles se fassent suivre, qu’elles portent
plainte, des choses comme ça ?
Cécile, conseillère
conjugale en planning familial – Ouais, je pense qu’au départ c’est des f,
enfin c’est quelque part des freins, c’est. Je pense, après, cette culpabilité
qui empêche qu’elles portent plainte, je sais pas. C’est peut-être plus pour
préserver, moi je sens, à chaque fois j’ai senti quand même c’était plus pour
préserver les, les êtres chers. J’ai toujours senti ça, plus.
Anthropologue – Hmmhmm.
D’accord.
Cécile – Mais au début,
le fait de, de pas repérer que, qu’y a abus, cette culpabilité oui je pense
que, elle joue, dans le non repérage de l’abus.
(long silence)
Anthropologue - Et
après, cette idée de préserver la famille ?
Cécile – Ouais. sacro
sainte famille ….
Anthropologue – Sacro
sainte famille, hé hé (rires)
Cécile – Sacro sainte
famille. Ouais bon, on peut… envers et contre tout.
Quand on voit comment a
réagi le pape vis-à-vis de la situation au Brésil et tout, enfin [en
excommuniant la mère d’une enfant incestée, car elle avait fait faire une IVG,
sa fille étant enceinte de l’incesteur]
Anthropologue – Oui,
y’a eu cette histoire.
Cécile – On comprend
après que, enfin voilà.
Anthropologue -
« un viol, c’est quand même moins pire qu’un avortement » …(ton
parodique)
Cécile - Et là, c’était
aussi un, un inceste, hein.
Anthropologue - Oui, je
sais, et il a pas dit inceste d’ailleurs, il a dit viol. Et l’auteur n’est pas
excommunié, apparemment
Cécile - …donc on est
quand même dans une société comme ça, quoi, où la famille, les valeurs
familiales, ben, ça se casse pas, enfin c’est ….
Et là où le pape, précisément, a été obligé à dire publiquement, courant 2010, que concernant les prêtres (c'est-à-dire les pères de l’Eglise) pédophiles, « le pardon ne suffit pas, il faut la Justice », dans la famille, pour un certain nombre d’intervenant/e/s, voire également d’incesté/e/s, le pardon suffit, voire est souhaitable. La haine et le rejet entre incesteur et incesté/e/s, le fait que la révélation de l’inceste au sein de la famille crée des clans et que l’incesteur puisse donc être rejeté par une partie de ses apparenté/e/s, est conçu comme forcément synonyme de vengeance insupportable. En revanche, le statut quo, qui repose sur le « silence des symptômes » mais surtout celui de l’incesté/e, semble une bonne chose : plutôt la famille que la Justice !
Mais Delphy, sociologue tout comme l’était Neyrand, nous emmène un peu plus loin dans la critique, en évoquant la famille comme lieu de relations de pouvoir : « il est pris pour acquis que les enfants ont au mieux deux parents, ou au pire deux parents ; et que seul un parent peut les défendre contre l’autre si l’autre est mauvais [et encore, comme nous venons de le voir …]. On ne se demande pas pourquoi les enfants sont dans la dépendance d’adultes, et de deux seulement ; pourquoi ils sont si fragiles, si exposés à la violence. On attribue la cause des abus de pouvoir des parents au caractère des dits parents, et maintenant qu’il est prouvé [par certains courants du féminisme] que les femmes sont bonnes et les hommes méchants, à la mauvaise nature masculine, à la violence quasi biologique (…) des hommes.
On oublie ou on feint d’oublier qu’il ne peut y avoir abus de pouvoir que dans la mesure où il y a préalablement pouvoir. (…) On oublie ou on feint d’oublier que le pouvoir des parents sur les enfants n’est pas naturel, que rien n’est naturel dans une société humaine. Que c’est la société qui donne ce pouvoir aux parents, et le maintient par toute une série d’institutions positives et négatives, et d’abord par une institution négative en soustrayant les enfants de la catégorie des citoyens et en leur retirant ainsi d’un trait de plume toutes les protections de la loi et du droit commun. (…) Il me semble que les termes mêmes dans lesquels les femmes ont été opprimées par les lois auraient dû nous faire réfléchir à ce rapport de pouvoir. Dans le Code civil français et jusqu’en 1939, les femmes étaient assimilées à des mineurs. Elles sont mineures à vie dans le nouveau code de la famille algérien » (Delphy, 2009a, p 110-111).
Et, finalement, lorsque Francis nous dit, à propos de cette mère indigne :
Francis, éducateur en
service enfance - Et comment elle, elle a pas su protéger ses enfants, et
comment elle peut être aussi perçue par ses enfants puisqu'étant toujours avec
ce père abuseur ? Et comment elle elle se positionne, et qu'est-ce qu'elle en
dit de ça ? Qu’est-ce qu’elle en dit ? Est-ce qu'elle, est-ce qu’elle le
tolère, est-ce qu'elle le tolère pas ? Ou est-ce que … et puis comment elle
peut après par la suite se positionner auprès de ses enfants, parce qu'à un
moment ou à un autre, même si cette petite jeune, elle semblait, en tout cas …
ne pas être en rejet vis-à-vis de ce papa et puis de sa maman, à un moment ou à
un autre, elle va poser des questions. Et là, comment, qu'est-ce qui va en être
dit ?
Ne pouvons-nous pas retourner les questions : cette enfant qui a été rendue, par le juge, à ses pères et mères, donc à son père-incesteur et à cette mère qui ne s’en est pas séparée, à un moment ou à un autre, elle va en poser, des questions. Comme : pourquoi la société française, à travers ce juge et cette Justice, n’a-t-elle pas su me protéger ? Comment elle se positionne, et qu’est-ce qu’elle en dit, de ça ? Est-ce qu’elle le tolère, est-ce qu’elle ne le tolère pas ? Qu’est-ce qui va en être dit, quand cette enfant posera des questions ?
Devoir rejeter sa mère, après avoir subi les abus de son père et son impunité, c’est probablement difficile. Mais la société, comment peut-on la rejeter ? Et quelle place a-t-elle fait à cette enfant, à cette personne nouvellement arrivée dans le monde qu’elle est, en tant qu’enfant ?
Delphy a encore un mot, voire
deux, à ajouter : « Enfin, comment peut-on justifier par le
« besoin de protection » des enfants le fait de les livrer au pouvoir
discrétionnaire de deux individus, sans quasiment aucun contrôle de la
communauté ? Comment peut-on justifier par le besoin de protection le fait
de refuser la solidarité de la collectivité – ce qu’on appelle « l’égale
protection de la loi » - à toute une population ? Une population qui
non seulement n’est pas différente de nous, mais qui est nous, nous toutes et
tous, pendant les dix huit premières années de notre existence (ce qui fait
quand même un sacré bail) ? » (Delphy, 2009a, p 118).
Un/e mineur/e d’âge qui tente, comme David Bisson, de s’enfuir de chez ses parents, y est ramené/e, qu’il/elle le veuille ou non, par la police, qui croit le remettre à une mère aimante. D’ailleurs, où irait-il/elle sinon ? Un/e mineur/e d’âge, « Sauf exception prévue par la loi (ex : adoption, changement de nom, etc), (…) n’exprime en Justice qu’un avis. On ne lui a pas reconnu, [par exemple] dans une matière aussi sensible que l’éclatement du couple parental, un droit de véto sur les décisions qui le concernent. » (Rozencveig, 1998, p 117-118). En outre, « On relèvera que le droit de visite et le droit d’hébergement ne sont pas encore présentés comme des droits pour l’enfant mais pour les adultes. De telle sorte que l’enfant ne peut pas revendiquer de pouvoir visiter ou être hébergé par telle personne à laquelle il est attaché » (Rozencveig, 1998, p 119). Un/e mineur/e d’âge ne peut porter plainte : ce sont ses responsables légaux, alias son père et sa mère « biologiques », qui sont seuls habilités à le faire pour lui, sauf, depuis 1989, si ce sont eux les objets de la plainte. Mais si c’est un autre enfant de la fratrie, seuls les parents peuvent donc porter plainte … Le pouvoir parental apparaît ainsi comme étant, dans notre société moderne et civilisée, sans réels contre-pouvoirs. Et ceci, bien sûr, s’ajoute aux liens affectifs qui existent entre l’enfant, son incesteur et les autres membres du foyer, et à l’absence de mots alternatifs à ceux du parent incesteur : toutes choses que Delphy ne décortique pas, et qu’il me faut laisser ici en suspens, malgré leur importance, pour conclure ce chapitre par une question.
Sommes-nous prêt/e/s à construire de tels contre-pouvoirs ?
Un
cours de théâtre.
Discussion de couloir. Un
des participants, instituteur de 40-50 ans, explique le cas d’un enfant qui
avait appelé le 119 en disant que sa mère l’avait tapé, alors que c’était faux.
Son commentaire : « oui, mais maintenant que l’enfant sait que c’est
possible de faire ainsi à ses parents, ça a des effets irréversibles sur leur
autorité vis-à-vis de lui. C’est mauvais. » (notes du 05/01/2009).
La personne mineure d’âge, est pourvue de langage tout comme les adultes, puisque les adultes lui ont permis d’apprendre à parler. Elle peut effectivement utiliser le langage pour mentir, tout comme les adultes le font. L’incesteur/euse ment d’ailleurs effrontément à son enfant en « l’initiant » à ce qu’il appelle des « relations sexuelles », « comme le font tous les papas, tous les grands frères, etc, lorsqu’ils aiment leur victime ». Mais ce qui nous gêne le plus, spontanément, nous les adultes, est-ce ce mensonge qui nous reste invisible, ou l’éventualité qu’un/e enfant mente et nous fasse ainsi du tort, à nous, qui avons pouvoir sur lui/elle ? Ou bien, pire peut-être, sape, par son mensonge cru par le n°119, notre pouvoir lui-même ?
Et puis, au fait, comment l’instituteur sait-il de façon si certaine que ce qu’a dit l’enfant était faux ?
Une
semi-obscurité recouvre la table, que l’on devine ovale, de confection robuste.
Capable de supporter les objets les plus variés, de résister aux échauffements
des esprits … Autour de la table, mais on distingue mal, des sièges. De
couleurs et marques diverses, hétéroclites. Aussi hétéroclites, sans doute, que
leurs occupant/e/s.
L’éclairage
évoluant, on commence à pouvoir lire les noms de quelques un/e/s d’entre
eux/elles : Jean-Pierre Rosencveig, juge pour enfants et président de
tribunal, Lydia, violée des années durant par son géniteur, Christine Delphy,
sociologue et féministe, Didier Fassin et Richard Rechtman, qui viennent du
monde universitaire et médical parisien, Eva Thomas, psychopédagogue qui a
rencontré la petite Aline (juste à côté, sur la petite chaise), et a également
été violée par son père. Christine, pédopsychologue en CMP, Agnès,
« tripotée » par son père et violée par l’un de ses frères, Irène,
pédopsychiatre libérale, François Laplantine, anthropologue, Pierre Bourdieu,
ethnologue puis sociologue, Fabrice et Francis, employés au service enfance
d’une maison du Rhône, Florence Rush, assistante sociale qui a été parler aux
féministes américaines, Danielle, abusée par Monsieur Tromosh, Paulette, qui
aurait préféré retourner en ville sous les bombes, durant la guerre, que rester
auprès de son premier abuseur, Gérard Neyrand, sociologue révolté par
« l’aliénation parentale », Laurence Gavarini, sociologue, Aurélie,
« tripotée » par le demi-frère durant des années, Gérard Noiriel,
historien, Francine, enseignante en lettres-histoire dans un lycée professionnel,
David Bisson, assisté d’Evangéline de Schonen pour nous raconter sa sinistre
enfance, Micheline, assistante sociale en lycée professionnel, Georges
Devereux, anthropologue, Hélène et Françoise, assistantes sociales de secteur
en maison du Rhône, Claude Couderc et Anne Poiret, journalistes, Patricia,
bénévole associative, Delphine Serre, sociologue, Cécile, conseillère conjugale
en planning familial, Marcelo Viñar, psychanalyste et rescapé de la torture,
Georges Vigarello, historien, Laurence, assistante sociale en planning familial
…
La
liste est encore longue des intervenant/e/s. D’ailleurs, tou/te/s n’ont pas
encore parlé.
Sur
la table, divers objets, posés au fil des débats par différentes personnes,
pour appuyer leur propos.
Au
fil de la lumière croissante, ils se regardent, se découvrent les un/e/s les
autres avec surprise. Certain/e/s ne s’attendaient pas du tout à se trouver
attablé/e/s ainsi avec des personnes que, jamais, jamais, ils/elles n’auraient
rencontrées ailleurs ! Qui plus est pour débattre autour de la même
table ! « C’est une farce ? », s’exclame même quelqu’un.
Mais,
encore sous le coup des débats et de leur tournure inattendue, la plupart sont
silencieux/euses. Moi-même, qui tiens la plume qui écris ces lignes, je reste
sous le coup. J’accuse le choc, qui s’est fait à mesure. Je ne sais pas si mon
amertume, comme un nœud à l’estomac, une nausée, est partagée et par qui.
Certain/e/s ont l’air un peu blêmes, d’autres plutôt rouges … mais qu’expriment
ces colorations ?
La
table, qui nous réunit et nous sépare tou/te/s, elle, a tenu bon. Elle est
toutefois marquée de traces : ici, on devine un coup rageur (« taper
du poing sur la table »), là, une pile de livres apportés par un
sociologue, ici, d’autres livres, apportés par des incestées, sans oublier le
magnétophone et ses récits, et puis les présentoirs sur lesquels sont écrits
les noms et titres des différent/e/s intervenant/e/s.
L’une
d’eux/elles demande alors à parler : il s’agit de Pascale Molinier, qui
veut nous expliquer les problèmes rencontrés, autour d’une autre table, alors
qu’elle réfléchissait, avec les membres de son équipe de recherche, autour du
travail domestique.
« Travaillant
les questions théoriques et cliniques soulevées par la condition de bonne à
tout faire, plus largement le travail domestique, dans le cadre d’un séminaire
restreint aux membres de l’équipe de psychodynamique et psychopathologie du
travail, nous avons fait la découverte désagréable mais instructive de nos
propres résistances et censures. Nous nous sommes rendus compte que nous
étions tous concernés par ce que Dominique Memmi appelle la « domination
rapprochée » ; une domination qui ne se joue pas entre classes ou
dans l’espace public, mais dans la maison, dans l’intimité, et qui redéfinit
donc la topologie du politique clivé en privé/public (…) La « domination
rapprochée » ne peut être appréhendée avec les outils conceptuels et
méthodologiques classiques pour traiter des rapports sociaux.
Il est apparu que nous
adoptions des points de vue très différents non seulement en fonction de notre
sexe (homme ou femme) et de notre position de genre plus ou moins conformiste
vis-à-vis du service domestique, mais aussi en fonction de nos origines
sociales, c'est-à-dire de la classe d’appartenance de nos parents. Fils et
filles de maîtres ou fils et filles de serviteurs (ou assimilés), nous ne
réfléchissions pas tous et toutes à partir du même point de vue, et cela
générait, autour de la table, beaucoup d’irritation et de ressentiment. Bref,
les chercheurs aussi sont situés. (…) L’épistémologie du point de vue ou des
savoirs situés a mis en évidence que les sciences sociales ont été construites
à partir du point de vue « homme, blanc, bourgeois, du Nord
occidental » et que ce point de vue étant le seul considéré comme objectif,
les points de vue minoritaires étaient considérés comme
« subjectifs » ou « particuliers » et finalement rejetés
comme non scientifiques. (…) Aujourd’hui, plus clairement qu’hier, nous savons
que traiter de l’être humain en situation, c’est aussi rendre visible et interrogeable
la situation de qui produit des connaissances sur qui. Ainsi que le
soulignent Danielle Chabaud-Rychter et Delphine Gardey, « c’est le point
de vue adopté qui permet de faire science (...). L’idée est bien que si le
regard est multiple, si on opère une ‘’diffraction’’, le monde qui se dessine
est alors différent : il y a un déplacement conjoint des objets de
l’investigation, de ce qui est regardé et de la façon de produire de la
connaissance ».
(…) Ce qui manque aux
catégories dominées, quelles qu’elles soient, c’est la possibilité de se
reconnaître dans les façons dont les discours savants les représentent. Ce qui
pose problème est d’y être représenté seulement comme un objet dont on parle,
un objet fascinant et pourtant inférieur, et jamais comme un sujet qui parle et
théorise en son nom propre à partir de son expérience propre. » (Pascale
Molinier, 2006, p. 45-46).
C’est alors que, d’un
coin resté dans l’ombre, on entend le bruit d’une personne qui se lève de sa
chaise. Sur l’écriteau, que vient alors frapper la lumière, on peut lire :
« Osama ». Et rien d’autre. Osama est une fille de 9 ou 10 ans, vêtue
d’une très jolie robe manifestement orientale. Une robe de noces. A mesure
qu’elle s’avance, je me sens d’un coup honteuse : comment ? J’ai passé
200 pages à me pencher sur ces histoires d’inceste en Occident, pendant
qu’elle, voyait sa vie sauve au prix de son mariage à 9 ans avec un riche
taleban[55] ?
Autour de la table,
tout le monde, en se regardant, constate d’un coup que, hormis Osama, il y a là
uniquement des européen/ne/s et américain/e/s blanc/he/s.
Osama arrive vers moi,
qui étais chargée de donner la parole aux différent/e/s intervenant/e/s tour à
tour, tout en tirant les conclusions qui me semblaient adéquates. Sans un mot,
elle me tend le stylo qu’elle tient à la main : une belle plume. Et me
fait signe d’écrire le débat qui vient d’avoir lieu.
« Mais, et
toi ? Et ton histoire à toi ? Qui l’écrira ? Tu ne sais pas
écrire ? ». Je lui tends la plume qu’elle vient de me donner.
Elle me répond alors,
dans un arabe parfait, tout droit sorti de l’école coranique où elle a été,
alors qu’elle était travestie en garçon : « J’ai appris à écrire à
l’école coranique, mais ils/elles ne comprendraient pas ma langue, ici. C’est
un alphabet plus ancien que le leur, mais ils/elles ont oublié. Il faut
traduire d’abord. Et ton histoire traduit la mienne. Si tu écris la mienne,
ils/elles vont encore croire que ça ne les concerne pas, qu’il faut juste nous
civiliser nous pour que la barbarie s’arrête. Ton histoire d’occidentales dit
que la barbarie peut exister au cœur de leur civilisation aussi. Alors écris
l’histoire de ces enfants blanc/he/s de France pour qu’un jour, je puisse moi
écrire la mienne ».
Sur ces mots, Osama
retourne dans l’ombre, me laissant la plume. J’ai juste le temps de lui
demander : « et toi, que vas-tu devenir alors ? Tu vas rester
séquestrée dans ce château où tu es à la fin du film, toute ta
vie ? », quand j’entends le bruit de la porte, lourde, qui se referme
sur le silence, dans le coin d’ombre. L’homme-propriétaire a aussi emporté l’écriteau où il y avait
écrit « Osama ».
Le stylo qu’Osama m’a
laissé écrit d’une belle encre, de belles lettres : un stylo de
calligraphe. L’homme-propriétaire n’a
pu l’emporter dans l’ombre et le silence.
Il me reste alors à être à la hauteur de la, lourde, tâche de scribe qui m’est ainsi confiée, et à conclure.
En France, la Protection de l’Enfance, historiquement, vise des objectifs démographiques et d’ordre social : il s’agit de s’assurer que les enfants soient en nombre suffisant, en état de santé et de moralité qui leur permette d’être utiles à la nation, et de ne pas devenir dangereux, que ce soit par la délinquance ou encore la subversion révolutionnaire. Cette Protection de l’Enfance rencontre le souci humaniste envers les enfants, via la lutte contre l’exploitation du travail de ces enfants et, plus largement, la cruauté envers eux/elles. Cette cruauté est alors pensée comme une cruauté à dénoncer parmi d’autres : cruauté envers les esclaves, envers les animaux, etc.
C’est entre le milieu et la fin du 20e siècle qu’émergent les notions, d’une part, « d’enfance inadaptée », d’autre part, de maltraitance. L’idée d’enfance inadaptée est celle selon laquelle l’enfant déviant, délinquant, est avant tout « inadapté », et, partant, qu’il est possible de le ré-adapter au lieu de le punir. Elle émerge lorsque des résistant/e/s découvrent, à l’issue de la seconde guerre mondiale, les conditions de détention de ces mineur/e/s d’âge. La notion de maltraitance est portée, aux Etats-Unis puis en France, principalement par des pédiatres. Aux Etats-Unis, une assistante sociale, Florence Rush, provoquera l’émergence sur la scène publique des maltraitances sexuelles (abus incestueux) en prenant la parole lors d’une réunion de féministes américaines sur le viol. En France, cette rencontre n’a pas lieu et, hormis une médiatisation durant les années 80 (Eva Thomas), c’est le personnage du pédophile qui est connu, depuis l’affaire Dutroux (1996-1997).
Aujourd’hui, les enfants « en danger ou en risque de danger » constituent par suite un vaste conglomérat statistique, dont le contenu est difficile à cerner, le « danger » pouvant inclure aussi bien l’absentéisme scolaire dans un contexte de séparation parentale, que le/la mineur/e attaché/e au radiateur ou violé/e par un apparenté, ou encore le/la mineur/e auteur de viol par exemple.
L’affichage du mot « maltraitance » peut même servir de faire-valoir à la lutte contre … le danger que représenteraient les mineur/e/s ou leurs familles qui sortent des normes (scolaires, psychologiques ou médicales) par leurs comportements. A l’inverse, environ 80 % des personnes abusées sexuellement de manière répétitive durant leur enfance n’ont aucunement été détectées comme « en danger » par les services sociaux (Guyavarch, 2008) durant la période où elles étaient abusées, probablement du fait de leur normalité comportementale : comme cela m’a été dit « je voulais me fondre dans la masse », « avoir l’air comme les autres ».
Ces constats recoupent bien le caractère incongru, voire inaudible, de mes demandes dans la plupart des sphères professionnelles ciblées : la rencontre avec un/e anthropologue est exceptionnelle, celle avec un/e mineur/e victime d’abus incestueux également !
Dans un certain nombre de cas, « l’anthropologue » peut être assimilée en étant ramenée à des schémas plus habituels : l’étudiante en travail social et son mémoire professionnel, doublé bien sûr de son incontournable, et bien embarrassante, demande de stage, par exemple, ou autres figures existantes et dans lesquelles je me suis, de fait, laissée glisser.
Mon thème d’étude: les réactions des professionnel/le/s à ces situations d’abus incestueux que, pour la plupart, ils/elles ne rencontrent quasiment jamais, était lui-même difficilement audible.
L’emploi du terme « maltraitance » pour introduire ma demande dans un certain nombre de cas, m’a montré que même si la maltraitance est un problème social, contrairement à l’inceste, elle est un problème social souvent bien encombrant : une affaire de spécialistes. Par delà les affiches qui utilisent le terme de façon inspirée peut-être du marketing, en réalité, peu d’instances et d’associations s’occupent réellement des maltraitances.
L’anthropologue se trouve, finalement, aiguillée sur le circuit qui est indiqué aux incesté/e/s : vers telle association, ou telle profession, ou tel/le collègue, plus spécialiste, plus expérimenté/e en la matière. Mais une fois arrivée au bout du circuit, l’anthropologue, comme les incesté/e/s, se trouve d’une part devant de petites associations reposant intégralement sur le travail de bénévoles, d’autre part devant « les psys », qui s’avèrent parmi les plus silencieux/euses ou fuyant/e/s dès lors qu’il s’agit de parler de cela, ou, simplement, d’imaginer qu’un/e mineur/e reçu/e en cure pourrait être concerné/e.
Un fait frappant est par ailleurs la diversité des univers professionnels et associatifs traversés. Entre l’administration qui voit le monde à travers le prisme des procédures et de collectifs hiérarchisés les appliquant, l’association qui fonctionne comme un collectif collégial, l’enseignante autonome devant sa classe, il y a un monde, voire plusieurs.
Et c’est dans cet univers si divers, que la parole nommant les abus incestueux comme constituant des abus, va avoir à se trouver un chemin.
Or, malgré le sentiment d’un certain nombre d’interlocuteurs/trices qu’il en a été « trop fait » autour de la pédophilie auprès des enfants, les communications d’abus sexuels incestueux restent, durant cette première décennie des années 2000, en France métropolitaine, rares de la part des enfants, qui ont peu de recours auxquels penser dans ces cas : leurs parents, et c’est à peu près tout.
Ainsi, malgré l’opinion prégnante selon laquelle « maintenant, les enfants peuvent parler », ce sont surtout des adultes et des adolescent/e/s, à distance des faits (et de l’incesteur) qui y parviennent.
Pendant les abus, il est souvent impossible de penser par exemple « je suis en train de subir des viols incestueux ». A supposer d’ailleurs qu’on dispose de ces mots. La plupart du temps, c’est soit l’absence totale de mots, puisque personne n’en parle en dehors de l’incesteur, soit les mots de l’incesteur, qui définissent la situation : une « aventure » amoureuse avec papa ou grand-frère, et non des abus démolisseurs, par exemple.
La mise à distance souvent nécessaire pour commencer à penser aux abus comme à des abus peut être géographique (séparation des parents, etc), légale (majorité de la victime), temporelle. C’est seulement alors, que, la terreur et la sidération produites par la situation abusive s’atténuant, cette situation devient pensable et communicable, à soi-même pour commencer. Encore faut-il trouver des mots qui nomment les abus incestueux comme des abus démolisseurs. D’où le rôle de « l’annonciateur », qui peut nommer les actes comme abusifs, ou évoquer des émotions produites par ces actes (honte, culpabilité …) comme injustement placées, ou encore pointer l’absence anormale de certaines autres dans des relations pourtant choisies (plaisir sexuel).
Un moteur puissant de prise de conscience et de communication à l’extérieur est, dans ce contexte de distance entre soi et les abus, de comprendre qu’un autre enfant pourrait être, là, à son tour victime de l’incesteur.
Ces éléments font apparaître un non-dit fréquent chez les professionnel/le/s : la mise sous terreur des incesté/e/s est évoquée uniquement, dans mes entretiens, par les incestées elles-mêmes. L’absence de mots pour penser et dire les abus comme des abus est également évoquée uniquement par les incestées, et, cette fois, suite à question de ma part (« pourquoi n’as-tu pas pu en parler alors ? »).
Par ailleurs, les communications supposent des personnes présentes pour les recevoir : alors que les adolescentes peuvent rencontrer des professionnel/le/s se préoccupant de leur sexualité naissante (contraception, etc), autant d’occasions de comprendre qu’il s’est passé quelque chose, les enfants, eux, n’ont que leurs parents. En effet, les professionnel/le/s du psychisme n’imaginent pas que parmi les enfants qu’ils/elles ont en cure, certain/e/s pourraient être incesté/e/s. Les instituteurs/trices constituent une zone d’ombre de mon travail, dans la mesure où, étrangement, je n’ai pas pensé à en contacter : parce que je ne les avais pas, moi-même, imaginé/e/s comme interlocuteurs/trices possibles d’une communication ? Même s’ils/elles n’apparaissent pas comme des confident/e/s fréquent/e/s, à travers les récits des autres professionnel/le/s rencontré/e/s, cela reste un manque dans mon travail.
Les communications continuent ensuite à l’âge adulte, auprès des professionnel/le/s du psychisme au cours d’une cure, ou de travailleurs sociaux chargés de mesures de protection de ses enfants, par exemple.
En outre, le fait que pour le/la professionnel/le, l’abus incestueux soit une éventualité pensable, semble augmenter les chances que l’incesté/e lui révèle ce qu’il/elle a subi. En effet, dans ces cas, il s’avère que l’interlocuteur/trice lui pose des questions claires où cette éventualité est envisagée.
C’est dans les contextes où il y a possibilité de répétition des rencontres, « d’apprivoisement », et où le/la professionnel/le peut y « mettre de soi » dans ses relations avec les mineur/e/s, que se font souvent les communications.
Ces communications ont un impact souvent important sur les interlocuteurs/trices des incesté/e/s. Le/la professionnel/le peut ne pas se sentir compétent/e, et chercher alors à passer le relais à « plus spécialiste », alors que l’incesté/e revient obstinément vers son/sa confident/e … ou bien le/la spécialiste peut ne pas supporter la haine manifestée vis-à-vis d’apparenté/e/s, même s’ils/elles sont incesteur/euses de leur patiente. Les réactions oscillent par ailleurs entre la sidération, parfois proche de l’évanouissement physique, et le détachement, le « blindage ». Ce qui sidère, c’est, précisément, l’irruption dans le réel proche de soi de ce crime : « voir un abuseur » physiquement, en chair et en os, ou une victime, ce n’est pas comme en entendre parler à la télé ou dans des livres.
Il existe ici en France un « imaginaire du mal » qui le pense comme : loin de soi socialement, noir ou arabe, rural, ou encore populaire (chez les gens « pas cultivés »). Chez les incestées, cet imaginaire a été battu en brèche par les abus subis : pour elles, le mal est une éventualité toujours proche, le plus souvent imaginé comme potentialité chez des personnes ressemblant physiquement et/ou socialement à leur incesteur, et non pas dans un « ailleurs » noir ou arabe, rural, populaire.
C’est la présence de situations d’inceste vécues dans l’entourage personnel de deux des professionnel/le/s interviewé/e/s qui permet de comprendre l’interface entre ces deux imaginaires du mal : cette rencontre avec l’inceste dans le réel, de la part d’un ami à elles, les a fait basculer de l’imaginaire commun à un imaginaire proche de celui des incesté/e/s, où même son propre mari peut devenir suspect. Ce qui nous fait déboucher sur l’atteinte des liens sociaux confiants, produite par les actes incestueux, qui constituent dès lors non seulement un crime contre leurs victimes, mais aussi une attaque contre la société elle-même, par le basculement dans un univers où chacun/e devient suspect/e du fait des actes de quelques un/e/s.
Ce fait questionne la relation existante entre les « familles incestueuses » et une société qui, elle, serait indemne, comme si ces familles n’en faisaient pas partie : s’intéresser par exemple au « fonctionnement inconscient des familles incestueuses », n’est-ce pas également se désintéresser du « fonctionnement inconscient de la société où elles émergent » ? Ce, alors que l’industrie de la pédopornographie a un chiffre d’affaire colossal, et que la plupart des enfants impliqués dans cette pédopornographie le sont, précisément, par un parent … Dès lors, on peut poser la question, avec Marcelo Viñar, de la partition de la société entre victimes (ou acteurs tels « les familles … incestueuses ») et indemnes : parler des actes monstrueux, ce n’est, nous dit-il, pas parler de victimes et de leurs séquelles, mais dénoncer, via leurs témoignages, un ordre de vie en commun qui fonde son existence sur la destruction du semblable. Les actes monstrueux ne sont alors pas une maladie de la victime, mais un mal civilisationnel, qui nous concerne tou/te/s.
Et une fois le choc de la communication autour de ces actes monstrueux encaissé, se pose la question de l’action.
Aller porter plainte s’avère difficile pour les incesté/e/s, même adultes, même quand il s’agit de tenter de protéger d’autres personnes par cette plainte. L’accueil n’est pas toujours décent, la procédure inaugure, lorsque la plainte n’est pas classée sans suite, des années d’épreuve.
Porter plainte s’avère également difficile pour les parents d’incesté/e/s, surtout quand il s’agit de porter plainte contre … un autre de leurs enfants. Ou encore quand on a déjà été, en tant que mère, poser des mains courantes au commissariat concerné pour « violences conjugales » de la part de l’incesteur. Ces difficultés montrent le besoin de « béquilles » pour aider à porter plainte.
Mais les professionnel/le/s sont également en position difficile : le signalement, qui semblait un acte simple et bien cadré par les procédures, est en réalité souvent éprouvant à mettre en œuvre. Il peut mettre en péril les relations ultérieures avec les usager/e/s, les familles, ce qui motive des pratiques en écart parfois important avec les « procédures », d’association des parents, y compris maltraitants, au processus. Il s’avère souvent être le fait d’une réflexion collective entre collègues, alors qu’il doit être porté et signé par un individu. Il apparaît alors comme dépendant des normes collectives du lieu d’où il est issu, ce qui pose la question de ces normes. Bien souvent, elles sont en retrait par rapport aux textes, montrant en filigrane les choix inconscients de la société française : plutôt la non régulation, ou la moindre régulation, que risquer de surcharger la Justice et d’augmenter les coûts. Dit autrement, plutôt mettre les travailleurs/euses sociaux en position d’agents filtreurs, qu’en position d’agents pouvant être réellement protecteurs vis-à-vis de toutes les violences intra familiales, y compris sexuelles : le « signalement parapluie » existe peut-être en matière de « danger », mais pas en matière de maltraitance, et pas dans mon corpus d’entretiens. Il s’agit alors de réserver au juge les faits les plus graves, mais aussi les mieux prouvables, même si bien sûr, il n’est pas demandé au travailleur ou à la travailleuse social/e d’apporter la preuve, mais juste d’informer la Justice de ses soupçons … Les contradictions dans les demandes faites aux professionnel/le/s sont la règle : aux travailleurs/euses sociaux de s’en débrouiller.
Par delà les difficultés évoquées jusque-là pour porter plainte ou signaler, il faut mentionner une difficulté majeure, qui conduit à ne pas ébruiter le secret hors de la famille et, éventuellement, du lieu de thérapie : se représenter un père, une mère, un frère, un fils, etc, comme un violeur, produit un conflit intérieur difficilement négociable. Ceci, tant pour les professionnel/le/s que pour les incesté/e/s elles/eux-mêmes et leurs proches. Peuvent s’ajouter, pour la famille, des aspects économico-matériels (perte d’une source de revenus importante : l’incesteur), auxquels l’incesté/e peut être sacrifié/e. L’incesté/e, le/la professionnel/le ou bien la famille, vont alors choisir de maintenir les faits dans le secret, afin de préserver la famille.
Destitué/e une première fois de sa place de pair (si l’incesteur est un enfant) ou de son statut d’enfant (si l’incesteur est un parent) via les abus, l’incesté/e peut être jugé/e coupable de l’attaque des liens sociaux produite par les abus, si elle en parle. Surtout lorsqu’elle est une fille, elle peut alors être estimée « aguicheuse », avoir été « la femme du père » : autant de propos qui lui assignent de nouveau la place de coupable, reproduisant et reconduisant ainsi l’assignation faite par l’incesteur et ses soutiens intra familiaux.
Cette place de coupable peut également être assignée à un apparenté clef : les mères. Alors qu’elles apparaissent comme le principal interlocuteur pensé possible par les enfants durant les années où durent les abus, elles seront ainsi le moins crédible dans les croyances de leurs interlocuteurs/trices.
Coupables lorsqu’elles participent de la surdité active autour des incesté/e/s, coupables, également à juste titre, lorsqu’elles participent elles-mêmes activement aux abus, elles le sont aussi … lorsqu’elles soutiennent leur enfant en portant plainte et se séparant de l’incesteur !
Leur volonté de protection de leur enfant, devient volonté vengeresse de démolir leur ex-conjoint par les moyens les plus vils (l’accuser d’abuser sexuellement leurs enfants), afin de l’évincer de sa place (droit de garde, autorité …) auprès de l’enfant en « l’aliénant ».
Finalement, quoiqu’elles fassent, les mères sont coupables de ce qu’elles font ou ne font pas : elles apparaissent donc prises dans une double contrainte. Double contrainte qui pèse également sur les professionnel/le/s vis-à-vis des signalements, et peut peser sur les anciennes victimes d’inceste lorsqu’elles viennent signaler que leur incesteur s’en prend à d’autres personnes maintenant.
Cette double contrainte apparaît liée à notre pensée de la famille, qui est chez nous conçue comme biologie : être géniteur/trice, c’est être parent. Etre issu/e/s du même sang, c’est être germains. Il y a confusion entre l’engendrement et la filiation, les rôles de géniteur, de pater/mater, de parents nourriciers, de tuteurs en ce qui concerne la transmission d’attitudes morales et de connaissances techniques, sont tous concentrés entre les mains des géniteurs. Et cette biologie est indissoluble. Dire l’inceste apparaît alors comme mettant en cause cette idéologie de la famille indissoluble, et, de surcroît, à se confronter d’une part à l’éclatement douloureux pour soi de la famille autour de soi, d’autre part à se confronter au vide laissé là : si un père (ou une mère) incesteur n’est pas un père (ou une mère), l’incesté/e est-elle/il condamné/e à vivre sans père ni mère, alors que même les orphelins ont ainsi des ancêtres ? Un fils incesteur d’un germain doit-il être renié ? Le reniement n’existe pas en France, le rejet explicite d’un enfant y est inacceptable. Existe en revanche la possibilité de déchéance de l’autorité parentale, mais un parent, même violeur de son enfant, reste, dans l’idéologie dominante, son parent parce qu’il l’a généré … Dès lors, comment s’étonner que, puisque ce n’est pas l’incesteur qui va communiquer le secret à d’autres, ce soit la personne qui le fait, l’incesté/e, qui soit jugé/e coupable de cette attaque contre la famille indissoluble ?
Ces fragments de la réalité, rendus visibles par les interactions entre moi et les personnes interviewées pour cette recherche, ne constituent pas une « vérité » définitive et absolue, c’est pourquoi je les verse, à mon tour, à contribution au débat.
Débat qui de mon côté pourrait se continuer :
- Dans l’examen de ce que peut devenir cette famille « brisée » dans la vie des incesté/e/s, d’une part, aux yeux de la Justice, d’autre part.
- Dans l’étude des écarts entre les différentes représentations de l’inceste, cette violence sexuelle qui, nous l’avons vu à travers certains discours, peut si aisément être ramenée à être une « simple » sexualité. Dès lors, quelles sont les relations, dans notre société, entre sexualité et violence, le cas de l’inceste pouvant apparaître comme caricatural, et donc central, à cet égard ?
|
Pseudonyme Pour le mémoire |
Contact via |
Profession ou qualité |
Lieu de travail ou d’activité |
Lieu de l’entretien |
Durée |
Age de l’interviewé/e |
|
Laurence |
Intermédiaire employée dans la structure et rencontrée via l’université |
Assistante sociale |
Planning familial |
Planning familial |
1h15 |
Non demandé – proche de la retraite |
|
Cécile |
Idem |
Conseillère conjugale |
Planning
familial |
Planning
familial |
1h20 |
Non demandé – la cinquantaine |
|
Francis |
Courrier |
Educateur en service enfance |
Maison du Rhône n°1 |
Son bureau |
2h20 |
Non demandé – entre 35 et 45 ans ? |
|
Fabrice |
Courrier |
Assistant social en service enfance |
Maison du Rhône n°1 |
Son bureau |
50 minutes en deux fois (30 min + 20 min) |
Non demandé – entre 35 et 45 ans ? |
|
Françoise (la plus âgée) et Hélène (la plus jeune) |
Courrier |
2 assistantes sociales de secteur |
Maison du Rhône n°2 |
Entretien collectif, salle « parents-enfants » |
35 minutes |
Environ 50 ans Entre 35 et 40 ans |
|
Irène |
Courrier |
Pédo-psychiatre libérale |
Cabinet (individuel) |
Dans sa salle de consultation |
1h15 |
Non demandé – autour de 50 ans ? |
|
Christine |
Courriel (connaissance personnelle) |
Psycho-logue clinicienne |
CMP, en pédo-psychiatrie |
Chez elle |
1h40 |
Non demandé – autour de 50 ans |
|
Micheline |
Recommandation par le CPE d’un établissement dont j’avais été élève |
Assistante sociale scolaire |
Lycée professionnel et auparavant collège |
Son bureau au lycée professionnel |
1h15 |
50 ans environ |
|
Francine |
Rencontre et discussion par hasard dans un lieu militant (connaissance personnelle) |
Professeure de lettres – histoire |
Lycée professionnel |
Chez moi |
1h30 |
Non demandé. A la retraite cette année. |
|
Patricia |
Courrier suite à présentation de l’association par son trésorier après premier contact téléphonique |
Bénévole |
Association |
Pendant la permanence de l’association, dans ses locaux |
1h35 |
Non demandé. Est retraitée, ce qui semble fréquent dans l’association. |
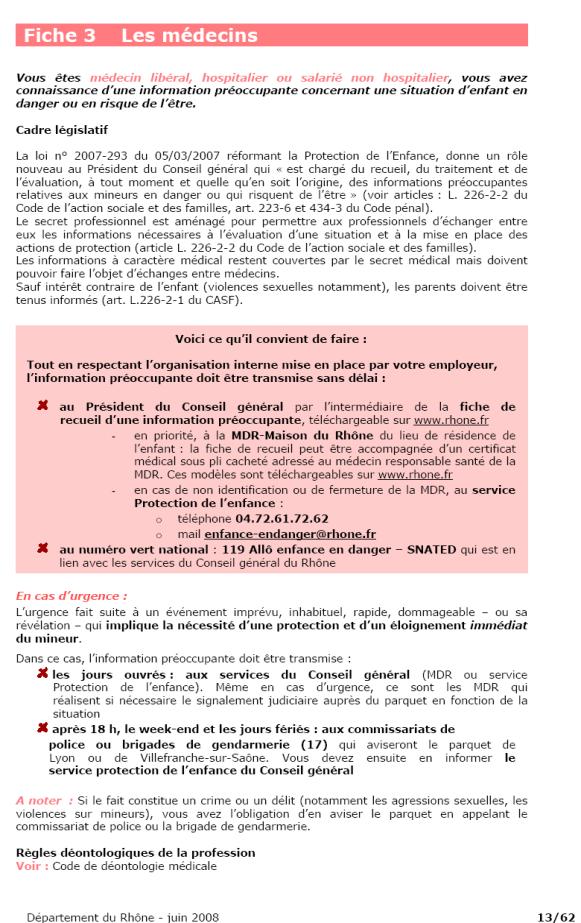
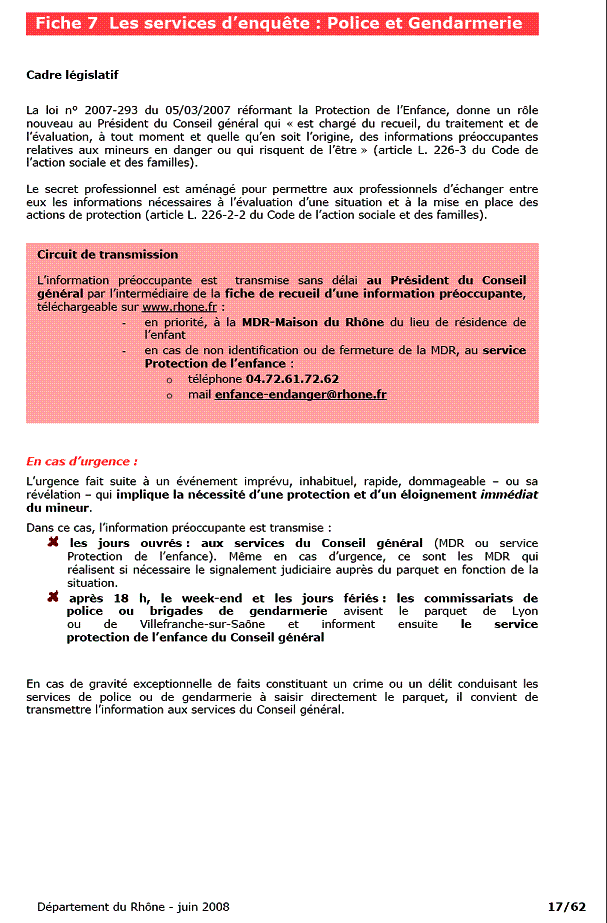
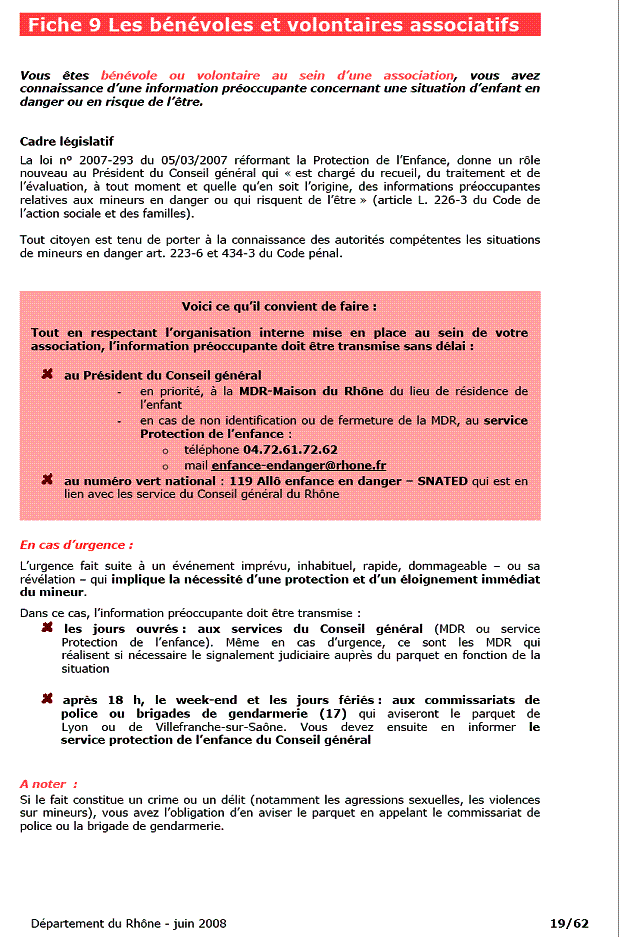

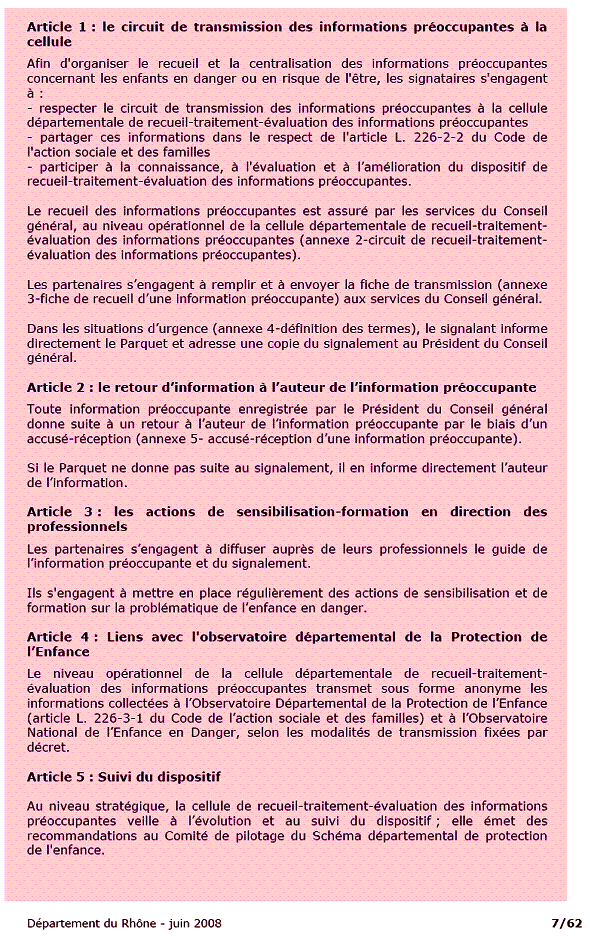



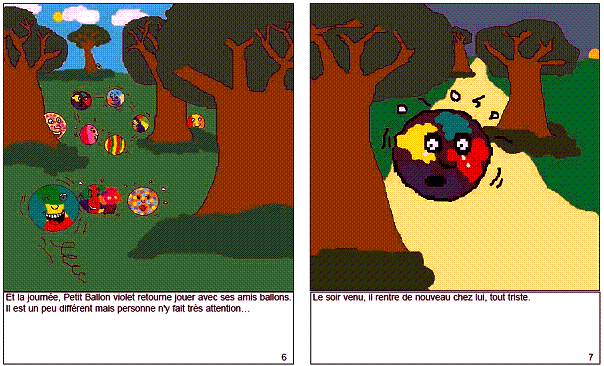
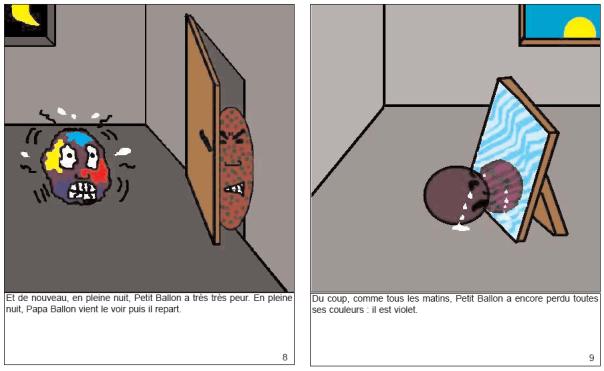
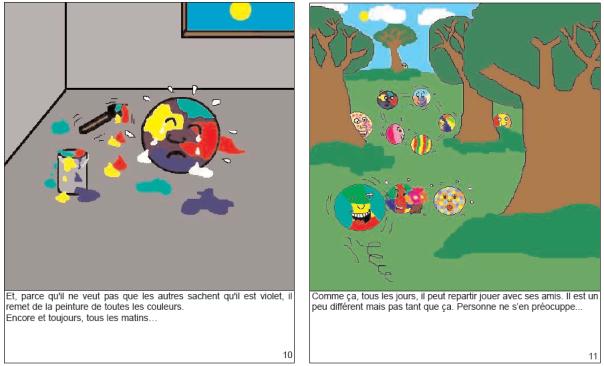
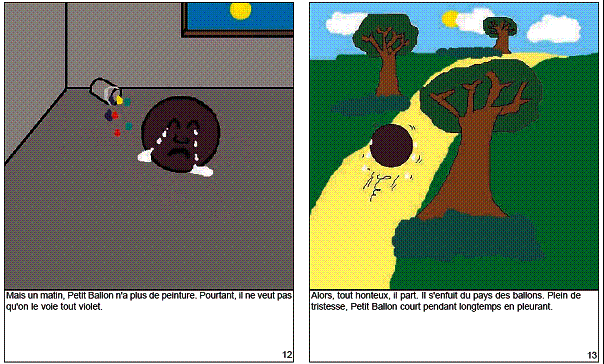
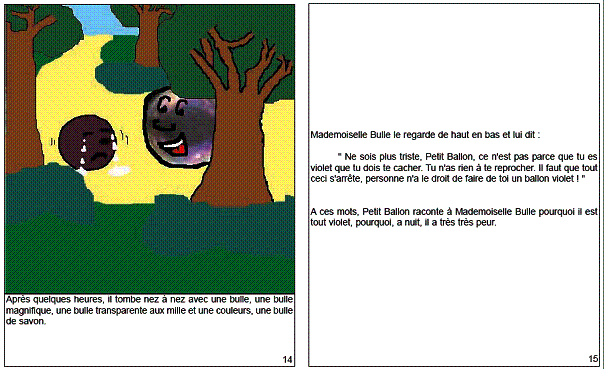
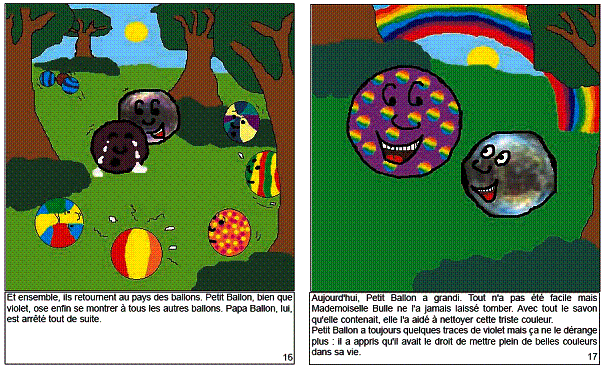

Bibliographie
Michel Agier, « La
force du témoignage - formes, contextes et auteurs des récits de
réfugiés », in Crises extrêmes, face aux massacres, aux guerres
civiles et aux génocides, ouvrage sous la direction de Claude Vidal,
Ed. La Découverte, 2006, pp 151-168
Anne-Claude Ambroise-Rendu, « L’expertise psychiatrique dans les cas d’abus sexuels sur enfants de 1860 à 2000 : Foucault analyste et prophète »
in Michel Foucault, savoirs, domination et sujet, sous la direction de J-C. Bourdin, F. Chauvaud, V. Estellon, B. Geay, J-M. Passerault, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp 67-77
Christine Angot, L’inceste, Le livre de Poche, 2003
Isabelle Aubry, La première fois, j’avais six ans, Oh ! Editions, 2008
Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit, Seuil, 1980
David Bisson et Evangéline de Schonen, L’enfant derrière la porte, Le livre de Poche, 2008
Alain Blanchet, Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes – l’entretien, 2e édition refondue, Armand Colin, Collection 128 sociologie, 2007
Pierre Bourdieu, « L’objectivation participante », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°150, 2003, pp 43-58
Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques, Fayard, 1982
Michel Bozon et Nathalie Bajos, « Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère », Population et Sociétés n°445, INED, mai 2008
Michel Bozon, « orientations intimes et constructions de soi. Pluralité et divergences dans les expressions de la sexualité », in Sociétés Contemporaines n°41-42, 2001, pp 11-40
Paula Joan Caplan, « Le « syndrôme d’aliénation parentale » », Introduction et traduction de Léo Thiers-Vidal, Recherches et prévisions n°89, CNAF, septembre 2007, pp 59-63
Claude Couderc, Mourir à dix ans, Pocket, 2003
Liliane Daligand, L’enfant et le diable, accueillir et soigner les victimes de violences, Ed. L’Archipel, 2004
Alice Debauche, « Enquêter sur le viol : entre sexualité et violence », in Violences envers les femmes : trois pas en avant, deux pas en arrière, éd. L’Harmattan, Collection bibliothèque du féminisme, sous la direction de Natacha Chetcuti et Maryse Jaspard, 2007, pp 75-93
Christophe Dejours, Souffrance en France, Ed. Points, 2000
Christine Delphy, L’ennemi principal, Tome 1 – économie politique du patriarcat, Syllepse, 2009
Christine Delphy, L’ennemi principal, Tome 2 – penser le genre, Syllepse, 2009b
Christine Delphy, « L’état d’exception : la dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée », in Nouvelles Questions Féministes Vol. 16, n°4, Nations, nationalismes, privé et public, 1995, pp 73-114
J. Desabie, Théorie
et pratique des sondages, Dunod, Coll. Statistique et programmes
économiques, ENSAE, Volume 10, 1965
Georges Devereux, De
l’angoisse à la méthode, éd. Aubier, 1980
Roland Doron et Françoise Parot (sous la direction de), Dictionnaire de psychologie, PUF, Quadrige, dicos poche, 2003
Dorothée Dussy, « Inceste :
la contagion épidémique du silence », in Anthropologie et sociétés
Volume 33 n°1, 2009, thème « enfances en péril », sous la direction
de Chantal Collard et Isabelle Leblic, pp 123-139
Dorothée Dussy et
Léonore Le Caisne, « Des mots pour le taire, de l’impensé de l’inceste
à sa révélation », revue « terrain », n° 48, février
2007, thème « la morale », pp
13-30
Dorothée Dussy, Marc Shelly, « Inceste : faut-il réagir ou désinformer ? », tribune libre, L'humanité, 25 mars 2005
Dorothée Dussy, « Construire une anthropologie de l’inceste », intervention à l’occasion du séminaire hors série du Laboratoire d’anthropologie urbaine, 18 novembre 2004
Dorothée Dussy, « La honte qui cache la honte qui cache la honte … », Sigila n°14, octobre 2004a
Didier Fassin et Richard Rechtman, L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, Ed. Flammarion, 2007
Jeanne Favret-Saada,
Les mots, la mort, les sorts, folio essais, 2005
Gilberto Freyre, Maîtres
et esclaves, la formation de la société brésilienne, Ed. Gallimard,
1974
Laurence Gavarini, La
passion de l’enfant, Hachette littératures, 2004
Erving Goffman, Stigmate, Ed. de Minuit, Coll. Le sens commun, 1975
Emmanuelle Guyavarch, « Une estimation du « chiffre noir » de l’enfance en danger par le biais des enquêtes de victimation », Note n°1 de l’ONED, 2008
Frédérique Gruyer, Martine Nisse, Pierre Sabourin, La violence impensable, inceste et maltraitance, Ed. Nathan, 2004
Ian Hacking, L’âme
réécrite, étude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire,
Les empêcheurs de penser en rond, 2006
Marie-France
Hirigoyen, Le harcèlement moral – la violence perverse au quotidien,
Pocket, 2001
Maryse Jaspard, Les
violences faites aux femmes, Ed. La Découverte, collection Repères,
sociologie, 2005
Stéphane La Branche, Mondialisation et terrorisme identitaire (ou comment l’Occident tente de transformer le monde), Ed. L’Harmattan, logiques sociales, série sociologie de la modernité, 2003
François Laplantine, Le sujet, essai d’anthropologie politique, Ed. Téraèdre, Collection l’anthropologie au coin de la rue, 2007
François Laplantine, De tout petits liens, Ed. Mille et une nuits, 2003
François Laplantine, Anthropologie de la maladie, Bibliothèque scientifique Payot, 1997
Sharman Levinson, « La place des enquêteurs dans une enquête sensible », in Enquête sur la sexualité en France – pratiques, genre et santé, Ed La Découverte, sous la direction de Michel Bozon et Nathalie Bajos, 2008, pp 97-113
Samuel Lézé, L’autorité des psychanalystes – l’espace politique de la santé mentale en France (1997 – 2007), thèse de doctorat en sciences de la société sous la direction d’Alban Bensa, EHESS, Paris, soutenue le 3 juin 2008
Philippe Liotard, « Fictions de l’étranger : le corps soupçonné », in Fictions de l’étranger, Quasimodo n° 6, printemps 2000, pp 61-87
Pascale Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Petite bibliothèque Payot, 2009
Pascale Molinier, Les enjeux psychiques du travail, Petite bibliothèque Payot, 2008
Gérard Neyrand, « La protection des enfants au cours des séparations parentales conflictuelles », La lettre de la Fondation pour l’Enfance, n° 53, 2007, 1er trimestre, p 1
Gérard Noiriel, « De l’enfance maltraitée à la maltraitance, les voies de la construction d’un objet historique », Point critique, in Genèses, n°60, septembre 2005, pp 154-167
Mary Odile, L’inceste, de l’autre côté du miroir – du fil du rasoir au fil de la tendresse, Ed. Quintessence, Coll. Croissance et développement, 2006
Sophie Perrin, L’inceste : anthropologie d’une
entreprise de démolition systématique de la personne, Mémoire de master 1 anthropologie, université
Lyon 2, sous la direction de François Laplantine et Axel Guioux, 2008
(disponible
via : http://sophia.perrin.free.fr/telechargement.htm)
Anne Poiret, L’ultime tabou : femmes pédophiles,
femmes incestueuses, Ed. Patrick Robin, 2006
Paul Claude Racamier, L’inceste et l’incestuel, Ed. du Collège, 1995
Christiane Rochefort, « Définition de l’opprimé », in Valérie Solanas, SCUM manifesto, Edition de la cuisinière à la photocopieuse à la …, 1998, première édition By Valérie Solanas, 1967
Jean-Pierre Rosenczveig, Dispositif français de protection de l’enfance, Editions Jeunesse et droit, 1998, Paris – l’auteur est juge pour enfants
Catherine Sellenet, L’enfance en danger, ils n’ont rien vu ?, Ed. Belin, 2006
Delphine Serre, Les coulisses de l’Etat social, enquête sur les signalements d’enfant en danger, Editions Raisons d’agir, Collection Cours et Travaux, 2009
Georg Simmel, Secret et sociétés secrètes, Ed. Circé, 1991
Françoise Sironi, Bourreaux et victimes, psychologie de la torture, Ed. Odile Jacob, 1999
Françoise Sironi, « les enfants victimes de torture et leurs bourreaux » : http://www.ethnopsychiatrie.net/actu/Dinan.htm
Irène Théry, Le
démariage, Justice et vie privée, Odile Jacob Poche, 2001
Eva Thomas, Le
sang des mots, éd. Desclée de Brouwer, coll. Psychologie, 2004
Eva Thomas, Le
viol du silence, Ed J’ai lu, 2003
Georges Vigarello, Histoire
du viol, XVIe-XXe siècle, Éd.
du Seuil, 1998
Marcelo
Vinar, « Homo Homini Lupus : une destinée inévitable ou comment
travailler pour dire non », in De la violence politique au
traumatisme, errances et solitudes, éd. L’Harmattan, sous la
direction de Véronique Bourboulon et Eric Sandlarz, 2007, pp 49-62
Marcelo Vinar, « La spécificité de la torture comme source de trauma. Le désert humain quand les mots se meurent », in Revue française de psychanalyse, 2005/4, volume 69, pp 1205-1224
Vivienne
Wee, « Children, Population Policy, and the State in Singapore »,
in Children and the politics of culture, Sharon Stephens editor,
Princeton University Press, 1995, pp 184-217
Monique Wittig, La pensée straight, Ed. Amsterdam, 2007
Christiane Thouvenin, « Sévices sexuels intrafamiliaux – du secret à la révélation : le doute, sa répétition comme signal d’alarme », in AFIREM, L’enfance maltraitée, du silence à la communication (actes du congrès de Toulouse, janvier 1990), Ed. Karthala, 1991, pp 103-119
Andras Zempléni, « Secret et sujétion, pourquoi ses « informateurs » parlent-ils à l’ethnologue ? », Traverses n° 30 131, 1984, pp 102-115
Guide Pratique [1] – Protection de l’enfance, « L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé », Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007
Guide Pratique [2] – Protection de l’enfance, « La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation », Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007
Protection de l’enfance : Statistiques 2007, Département du Rhône et Ministère de la Justice, 2008
Du traitement de l’information préoccupante au signalement, guide à l’usage des professionnels, département du Rhône, 2008
La lettre de l’ODAS, « feuille de parcours en protection de l’enfance : un outil d’avenir », avril 2008
Le site internet du n°119 : www.allo119.gouv.fr
L’historique d’enfance et partage : www.enfance-et-partage.org/spip.php?article22
« Enfance et partage 2006-2007, aider un enfant, c’est sauver un adulte », Enfance et partage, 2007
Charlotte, "Petit ballon violet" : http://canacircus.gnomz.com/livres-sur-l-inceste/
[1] L’Histoire dit juste que jusqu’à la loi du 4 juin 1970, l’autorité sur le foyer était détenue par un « chef de famille » : le père. En particulier, les mineur/e/s étaient donc dépendant/e/s de la « puissance paternelle », et non, comme c’est le cas aujourd’hui, d'une « autorité parentale » conjointe des père et mère.
[2] L’estimation pour les hommes n’est pas calculable à partir des chiffres disponibles dans le 4 pages co-rédigé par Nathalie Bajos et Michel Bozon. Les agressions par des femmes de la parenté n’apparaissent pas non plus de manière distincte.
[3] Cette restriction n’était pas un choix, aucun homme victime ne s’est trouvé alors volontaire pour participer à cette recherche.
[4] Au sens où il suppose d’effectuer une sorte de visite guidée d’une partie des enfers de l’humanité, dont il est difficile de ressortir indemne.
[5] Du moins francophone.
[6] Jusqu’en 2009, où une loi spécifique est votée suite au travail d’une députée en lien avec des associations d’anciennes victimes d’inceste
[7] La violence impensable, Gruyer, Nisse, Sabourin, 2004
[8] Mais l’est-elle réellement, ou, du moins, uniquement, contre-nature ?
[9] Récit que je me permettrai pourtant, un peu plus loin, quant à moi, sans pour autant le réduire à n’être qu’un texte ou un prétexte à texte.
[10] Marie-France Hirigoyen est médecin psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute familiale, animant depuis 1985 des séminaires de gestion du stress en entreprise, nous dit sa présentation, faite dans l’ouvrage, dont la première édition date de 1998.
[11] Nota : il doit y avoir une erreur quelque part dans ces statistiques, car 425/1192x100, cela fait 35,7 % et non 27 %, écart important.
[12] Voir dans le protocole mis en annexe le nombre élevé et la diversité des organismes signataires
[13] Voir exemples de fiches en annexe
[14] Beaucoup d’associations de défense des droits de l’enfant ont un site internet les présentant, mais enfance et partage est la seule à avoir choisi d’inclure son historique dans cette présentation, parmi les sites que j’ai visités.
[15]une autre
association de défense des enfants, contactée localement fin
2007 pour un éventuel stage, me donnait exactement la même proportion.
[16] L’autre association contactée fin 2007 me précisait de même ne jamais rencontrer les enfants directement, leurs interlocuteurs/trices étant la personne qui y était désignée par le terme « parent protecteur », équivalent du terme « famille » employé dans l’ association dont je développe ici la présentation.
[17] « Our discourse on children, childhood, the
value of children, children’s rights, and so on belies the context of the state
society in which we live. “Parents” and “children” emerge as marked categories
through their transformation from dyadic interpersonal relations to mediated
relations, monitored and ultimately controlled by a third party, the state. »
[18] « Politically uncentralized, nonhierarchic,
nonstate societies have their own cultural interpretations of children’s
biosocial vulnerability. Such tribal populations tend to subsume childhood
vulnerability under human vulnerability. Therefore, children are treated
violently in those tribal societies where interpersonal relations are violent,
such as the Yanomamös (see Chagnon 1983), or non violently in those societies
where interpersonal relations are non-violent, such as the Semais (see Dentan
1978). I would argue that in such
societies, children are not treated as a marked category of beings, distinct
from other human beings, with whom special relations must be maintained. ».
[19] Lydia, interviewée pour mon mémoire de master 1, et qui a gagné son procès, avait d’ailleurs trouvé son avocate en passant par une telle association de défense des enfants maltraités.
[20] Ce résumé de l’histoire de la profession d’assistant/e social/e est entièrement inspiré du début de l’ouvrage de Delphine Serre.
[21] Psychothérapeute durant plusieurs années – dont celles où se déroulaient les abus, psychomotricienne, psychologue scolaire, assistantes sociales …
[22] Toute interaction où je révèle cette partie de mon passé est en effet fréquemment sujette à une brusque évolution de ce type à ce moment-là.
[23] Plainte posée, et classée sans suite, depuis longtemps déjà.
[24] Néanmoins, ces « cas » constituent un corpus varié de situations où se sont produits des abus sexuels incestueux, c’est pourquoi il serait intéressant, à mon sens, de joindre les récits de ces situations au présent mémoire, ce qui n’a pu être fait faute de temps.
[25] Et ce, que les suspicions des travailleurs/euses sociaux/ales soient justes ou non. Il faut rappeler ici que les consignes données aux travailleurs/euses sociaux/ales sont de signaler dès qu’ils suspectent des maltraitances, et non d’attendre d’avoir des preuves fermes, afin, précisément, de ne pas empiéter sur le rôle du judiciaire ( !). Et ces consignes ne leur sont pas données par les média, mais par leur hiérarchie en application des textes.
[26] A l’exception du livre L’inceste, de Christine Angot, déjà reconnue alors comme écrivain. Et, ultime subtilité, elle ne nous précise (même) pas s’il s’agit d’un témoignage sur sa vie réelle ou d’une œuvre de fiction : aux lecteurs/trices de deviner …
[27] Pour un descriptif de ces hiérarchisations et de leurs évolutions contemporaines, voir Lézé, 2008, Chapitre « Politiques du freudisme : la juridiction des problèmes personnels en France », p 106-201
[28] Bien sûr dans un travail aux options différentes, elle pourrait sans doute être considérée comme vraie, et les citations d’entretien faites selon cet axiome-là. Mais alors, il s’agirait d’un mémoire de sociologie se situant dans la « mouvance » de Blanchet et Gotman, et non du présent mémoire d’anthropologie.
[29] toutes mes prises de notes
sont, évidemment, sujettes à d’éventuelles déformations dues au fait que ma
mémoire est une mémoire humaine, et non informatique, d’où l’absence d’encadré
afin de bien les distinguer des citations d’entretiens enregistrés, et la
précision systématique de l’écart entre la date de prise de notes et
l’événement noté, lorsqu’il y a un écart.
[30] Au niveau local. Au niveau national, en consultant les sites internet et la documentation de ces associations, il est possible de trouver des éléments d’une réflexion de fond.
[31] Peut-être parce que les
premiers récits publics d’incesté/e/s ayant marqué, en France, parlent d’abus sexuels commis en
silence :
ainsi, « Pour Marie, tout s’était passé hors du
langage, hors les mots. Il avait couché avec sa fille. Il avait fait l’amour
avec elle dans le silence de la nuit, sans bruit. » (Eva Thomas, 2003, p 13).
[32] Source : mes notes prises lors de la journée atelier du 13 mars 2010, organisée par SOS inceste pour revivre Grenoble, sur le thème « secret et secrets ».
[33] Une autre histoire de jalousie, semblable, m’a été communiquée par une personne, à titre personnel, à l’occasion d’un café bu en tête à tête à une sortie de réunion à l’université …
[34] Euphémisme surprenant, puisqu’en réalité, il s’agit de fait de campagnes de détection, les abus étant déjà en train d’être commis, voire déjà passés.
[35] Voir en annexe le livret « petit ballon violet » ; le site internet d’où il est issu se trouve en bibliographie
[36] Certaines incestées font, à l’inverse, des mères perfectionnistes, tout en continuant à se ressentir « nulles », « mauvaises », « médiocres » en tant que mères – source : échanges et discussions sur des forums internet d’entraide entre victimes d’inceste.
[37] Nous en parlerons plus loin.
[38] Sauf si elle ressemble à Lydia.
[39] Le « parent protecteur », quand il existe, étant la première personne répondant à ces caractéristiques, remarquons-le.
[40] Rappel : toutes mes prises de notes sont, évidemment, sujettes à d’éventuelles déformations dues au fait que ma mémoire est une mémoire humaine, et non informatique, d’où l’absence d’encadré afin de bien les distinguer des citations d’entretiens enregistrés, et la précision systématique de l’écart entre la date de prise de notes et l’événement noté.
[41] Hormis par l’amnésie, ce compromis fréquent tant chez les incesté/e/s que parmi leurs interlocuteurs/trices et leur entourage familial.
[42] Comme dans ce chapitre, il s’agit de situations rencontrées hors contexte professionnel, mes interlocutrices seront, exceptionnellement, désignées uniquement par leur prénom (fictif), sans leur titre professionnel.
[43] Au lieu de diviser en deux à chaque fois, il aurait pu diviser en 3, en 4, etc … ou bien refuser tout simplement d’entrer dans une démarche catégorisante.
[44] Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
[45] Association Internationale des Victimes d’Inceste
[46] Ou bien auteure des mauvais traitements, comme c’était le cas pour David Bisson.
[47] Le juge pour enfants est en effet un juge aux multiples rôles. Il est le seul juge à cumuler ainsi des compétences pénales et civiles. Ses compétences pénales font de lui le juge des mineur/e/s auteur/e/s d’actes de délinquance ; ses compétences civiles font de lui le juge pour protéger les mineur/e/s par des mesures qu’il est seul à pouvoir imposer en passant outre la souveraineté parentale : placement, AEMO, IOE, etc.
[48] Ce qui n’était pas le cas au milieu du XXe siècle, en France.
[49] Cette transformation, dans notre imaginaire, des incestées en femmes adultes, m’a concernée moi aussi puisque dans les cauchemars que je faisais encore, plus de quinze jours après mes derniers entretiens pour ce travail, je disais à mes interlocuteurs/trices, cauchemardesques : « il faut croire les femmes violées », et non « les filles violées » …
[50] Même Micheline, assistante sociale scolaire, n’est en réalité pas isolée : elle voit régulièrement, en réunion, des collègues assistantes sociales scolaires sur un secteur déterminé, c’est d’ailleurs par l’intermédiaire d’une de ces collègues que j’ai pu la joindre pour un entretien. Delphine Serre évoque également l’évolution des normes de travail de signalement chez les assistantes sociales scolaires, en fonction des changements de responsables, dans son chapitre « Une norme locale d’évaluation du travail » (Serre, 2009, p 245 et suivantes).
[51] La notion de « carrière », au sens sociologique du terme, serait probablement intéressante à creuser, concernant les incesteurs : qu’est-ce qui fait entrer le frère d’Aurélie dans cette « carrière », qu’il poursuivra ensuite jusqu’à aujourd’hui ? Sachant que la majorité des incesteurs cités par les victimes que j’ai vues en entretien, s’avèrent être entrés dans cette « carrière » avant leurs 18 ans.
[52] C’est pour cela que je critique, avec régularité, certains aspects de leur travail : parce qu’il me semble suffisamment solide pour être intéressant à questionner.
[53] Sur des forums internet de travailleurs/euses sociaux, il est courant de lire de la part d’éducateurs/trices : « ce/tte jeune agit ainsi car elle est loyale à … (sa mère, son père, etc) ».
[54] En pratique, dans mon corpus, seul/e/s les travailleurs/euses sociaux se posent la question du signalement.
[55] Osama réalisateur Sedigh Barmak, Afghanistan, 2003, durée 1h23, distributeur : haut et court, raconte l’histoire d’Osama, déguisée en garçon car sa mère doit être accompagnée d’un homme pour pouvoir sortir dans la rue et aller faire ses courses, travailler, etc. Découverte, elle est condamnée à mort par le tribunal taleban, mais celui qui l’a dénoncée rachète sa vie en la prenant comme épouse. Il l’emmène alors rejoindre ses autres épouses dans sa maison, à la campagne, fermée et isolée du reste du monde. Le film est resté peu de temps à l’affiche, en France.